Retrouvez nos ancêtres, l’origine de notre patronyme, notre histoire familiale, depuis 1470 en Périgord
Plus de 5 siècles d’archives privées et publiques, de documents historiques, des centaines d’actes et de patronymes.
Archive - source
Archives Départementales de Dordogne, Loire-Atlantique, Hérault, Corrèze, la Réunion, Ile Maurice, Quotidiens Australiens, Archives de la ville de Rotterdam.
Etat civil et registres paroissiaux, tables décennales, -matricules militaires, cartes de Belleyme et Cassini,
cadastre Napoléonien.
Archives notariales, cahiers de doléances,
dénombrements de population, archives communales, archives des cours et
juridictions.
Sites : Société Historique et
Archéologique du Périgord, Guyenne.fr, Geneanet et Gallica
Découvrez votre généalogie gratuite, après plus de 37 années de recherches à la découverte des patronymes
Meyssensas, Neyssensas, Neycensas, Neycenssas, Neyssensac, Neycensac, Neyssensat et autres orthographes
Décembre 2025
1843 - Marguerite dans l'enfer carcéral de la prison de Cadillac en Gironde
1939 - 1940
La correspondance oubliée d'un marin du Dunkerque retrouvée 90 années après …. à Amsterdam
Lettres à Vicky… extraits
Pensées et sentiments à la veille de la 2ème guerre mondiale
1915 - Une correspondance de guerre
Joseph Gouzou parle d'Adrien Neyssensas
1876 - Marie et Anne Neyssensas sous tutelle
********
Si par inadvertance, des images ou textes soumis à des droits d'auteurs ont été introduits, prévenez-moi, ils seront effacés dans les plus brefs délais sur simple demande des ayants droits.
Les données concernant l'état civil - série 5E - sont extraites des données numériques des Archives Départementales de la Dordogne.
Origine du patronyme
Notre patronyme - un gentilé occitan dérivant d'un nom de lieu - une énigme : Meyssensas ou Neyssensas ?
1526 - Acte notarié entre Guillaume Meyssensas et le prieur de La Faye
1526 - 1630 - Les premières familles et les premiers actes paroissiaux
1633 - Annette Meyssensas, épouse de notaire royal
Les Grandes épidémies à Léguillac
Pestes entre 1600 et 1616 - 1628 à 1632 - 1631 - 1644 à 1657 - 1747 à 1749
Disettes céréalières entre 1617 et 1622 - 1625 et 1626 - 1629 à 1630 - 1636 à 1639 - 1738 à 1742 - 1771 à 1775
Famines - 1709 à 1710
1789 - La Révolution à Léguillac
1548 - Rôle de la taille et patronymes Astériens - annexe 8
1714 - Procédure judiciaire Montozon témoins les frères Meyssensas d'Armagnac
1770 - Plainte de Martin, maître tailleur d'habits pour homme
1791 - Un mariage à Besançon, un mystérieux témoin
1855 - 1875 - Documents de familles Astériennes - traces du passé ... livre de raison - 1ère partie
1863 - Bail à colonage de Martial Neyssensas
1869 - Donation-partage de Martial Neyssensas.
1874 - 1875 - Documents de familles Astériennes, traces du passé ... livre de compte - 2ème partie
1875 - Employés au Paris-Orléans de père en fils.
1975 - Rémy Neycensas et la Patrouille de France
.
1870 - Alliance avec François Salmon, fabricant de conserves alimentaires
1875 -1877 - Faillites de l’armateur Alfred Neysensa et de l’entreprise de menuiserie de Pierre
1855 - Pierre, mousse à 15 ans, premier naufrage
1856 - Voyages vers l’Uruguay, le Brésil, la Réunion, la Guadeloupe
1866 - le navire trois-mâts le Lucie
1868 - L’ouragan des 11 et 12 mars sur l’ile de la Réunion
1876 - 1879 - Capitaine à bord de transatlantiques – les Caraibes, Panama, Cuba, Mexique, Venezuela
1883 - 1894 - Patron de pêche
Le capitaine Pierre Neyssensa et la tentation de l’engagisme
1876 - Les procès d’Alfred, son arrestation à Paris
1862 - Hippolyte, mousse à 15 ans
1868 - Son décès à bord du trois-mâts le Lucie - baie de Saint-Paul à la Réunion
Implantations
1630 - Rôle de la taille royale - Mensignac
1710 - Jean Messinsas, Sieur de la Combe à Martizay dans l'Indre
1733 - Jean, boulanger à Clermont l’Hérault
1790 - Une famille Mencencin dit "Messensac"dans le Bas-Rhin ?
Autres lieux avec présence d'homonymies ou phonétiquement proche
1495 - "Les Messinsards" dans la Drôme - un lieu-dit à Donzère
1630 - Un Meysenbach à Saverne - Bas-Rhin
1678 - Léonard Meyzinsas Affieux en Corrèze
1770 - Une famille dans les Ardennes - Charleville.
1770 - Familles Essensa implantées aux U.S.A. et Canada
1936 - Des cousins vignerons dans le Bordelais - Familles Taix - Neycensas et Bressolles
Guerres
1793 - La campagne de 1793
1957 - La guerre d'Algérie
Arbres
Arbres généalogiques et photos de famille - (Saint-Astier - Tamarelle) -
Photos des Familles Neycensas (Henri et Lucie) - Bressolles (Joseph) et Taix (Gabriel) - 1910 Paris
Annexe 1 - Étude sur le patronyme Neyssensas
Annexe 8 - Les Neyssensas mentionnés dans le Journal Officiel entre 1900 et 1945
Nous les retrouvons au fil d’actes notariés ou de registres paroissiaux, « hostelier » en 1526, avant les guerres de religion, puis vers 1598, laboureurs à bras, à Font-Chauvet, les Granges, ou fermier du prieur de La Faye en 1638, commune de Léguillac de l’Auche, laboureurs à Tamarelle en 1677, métayers à la Combe de la Garmanie, sous le regard du château de Saint-Astier, ou journaliers pour les plus modestes, à Armagnac, Faucherie.
Une famille est présente à Périgueux Saint-Front, dès 1598, puis deux, tout au long du 17ème siècle.
Mon frère avait obtenu ce petit congé presque par faveur car, à cette époque, les patrons ne les distribuaient pas à la pelle. Robert, peintre accompli, était reconnu dans la capitale périgourdine pour son maître coup de pinceau à réaliser les enseignes des magasins avec des lettres parfaites, même en gothique.
Il peignait des tableaux, des paysages, dont certains étaient fort jolis, comme celui qui décore une pièce de ma maison. Il représente notre douce rivière avec, en arrière-plan et surélevée, la très vieille église de St Astier.
C'est un peu de lui qui reste dans mon chez moi et dans mon coeur. Il avait une vraie tête d'artiste Robert, avec sa crinière longue, noire, aux belles ondulations, et sa lavallière souple qu'il portait si bien."
Extrait : Maurice Neycensas - 1992
En lai sur lous termeis, barris de la plano, louchapiau d’un chatèu deicimo la boueissièro, e dins l’en bas, quilhat coumo un jaiant sur sous peds de luchaire, lou viei cluchiè mounto la gardo.
Si, ribas, au pluviau, per la coto de Tamerèlo, e si restas un moumen pincat à la quincarolo, veses se deiboujâ uno eipandudo deleitouso : termeis pigassats, ranvers frurits vetats de bouis e d’agrafèis, coumbo verdo, e, dins loucros de la baisso, lou viei cluchié que semblo qui pausat per lou poudei de quauco fagilhèro, coumo une pèiro d’anèu dins soun chatou ».
A travers l’onomastique et l’étude des noms propres, nous allons découvrir l’origine mystérieuse et insolite de notre patronyme et tenter de résoudre l’énigme de sa formation.
1877 : Sous la 3ème république de Mac Mahon, le président du Conseil, Jules Armand Dufaure propose la création du livret de famille. Son successeur Jules Simon (1814-1896) valide la circulaire. Le livret de famille contribuera à la fixation orthographique des patronymes.
Le patronyme n’est pas donné par les intéressés eux-mêmes ni leur famille. Afin d’en connaître la signification il est nécessaire d’en découvrir la forme la plus ancienne, car après être consacré par l’ensemble du hameau, le patronyme est souvent malmené, estropié par le curé, qui écrit sur les actes paroissiaux de Saint-Astier, en 1674, Yefassinas, ou Eyffensas en 1695.
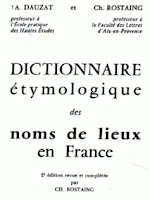 Aussi peut-il s’agir du nom de personne
attesté dans le nom de Saint-Naixent ou Naixans, d’après Dauzat du nom de
personne latin Naxentius ; or adjectivé au féminin pluriel *Naxentias (villas
ou terras sous-entendu) = les domaines de Naxentius, il donnerait effectivement
en occitan Naissensas (cas de -ti- latin devant voyelle : comme Laurentia a
donné en oc Laurensa, en français Laurence) toponyme (4) qui a pu devenir par
la suite nom de famille.
Aussi peut-il s’agir du nom de personne
attesté dans le nom de Saint-Naixent ou Naixans, d’après Dauzat du nom de
personne latin Naxentius ; or adjectivé au féminin pluriel *Naxentias (villas
ou terras sous-entendu) = les domaines de Naxentius, il donnerait effectivement
en occitan Naissensas (cas de -ti- latin devant voyelle : comme Laurentia a
donné en oc Laurensa, en français Laurence) toponyme (4) qui a pu devenir par
la suite nom de famille.23 mars 2012
Petit supplément de grammaire occitane - le pluriel de Neyssen
Précision apportée par Monsieur Leveque J.L. président de Novelum.
« Participe présent substantivé du verbe nàisser (naître), l'occitan "naissent" (phonétique française = [neyssin]) désigne effectivement le point de naissance d'un cours d'eau, et spécifiquement l'endroit où l'eau sourd (plutôt que ruisselle). Cette idée de naissance se retrouve aussi dans le terme "mair-font" (littéralement la source mère), qui désigne la source principale d'un cours d'eau qui en comprend plusieurs. En général, on utilise le terme "naissent" (ou tout simplement "nais") lorsqu'on fait référence à une source en tant que point de naissance d'un cours d'eau, et "font" lorsqu'on désigne une source en général.
Le pluriel de "naissent" est tout simplement "naissents" (en occitan périgord, ce mot se prononce de même au singulier et au pluriel).
Il en va de même du pluriel de tous les mots terminés en « en », « ent » ou « enc ». |
| Mr Astor |

L'origine de ce nom de famille est, selon toute apparence, un nom de lieu passé à l'habitant, et spécialement un ancien nom de domaine gallo-romain en -ac formé sur l'anthroponyme (10) latin Maxentius (connu avec le nom de l'empereur Maxence du début du 4ème siècle) : Maxentiacu, où le x latin a normalement évolué en occitan en -ayss / -eyss (cf. l'occitan tais, prononcé "taïss" sur le latin de basse époque taxo).
1) - à partir d’un hameau antique nommé « Meyssensas », d’un hameau « Las Neissensas », aujourd’hui disparus, dans ce cas, le patronyme ne subit que peu ou pas de transformation.
2) - ou d’un lieu-dit comme « Neyssen » près d’Agonac.
3) - de villages existants comme Saint-Nexans en Périgord ou Saint-Mexant en Corrèze, à condition que cette migration ait lieu au tout début de la guerre de Cent-ans.
Dans les deux derniers cas il est fait appel à une construction linguistique délicate et « laborieuse » mais cependant possible.
J. Tosti, généalogiste auteur d’un Dictionnaire en ligne des noms de famille et A. VIATGÉ - Généanet.
Analyse : si l'attribution de notre patronyme était en lien avec une particularité hydrologique, la présence d'une source, pourquoi n'y aurait-il pas d'autres patronymes identiques en Occitanie, comme il existe de nombreux "Fontaine" ?
a) un ancien nom de domaine gallo-romain « Meyssensas »
 |
| Maxentius |
Le premier évêque de Périgueux, Paternus est nommé en 360.
b) Un ancien nom de hameau « Las Neyssansas »
 |
| Plan cadastral actuel |
 |
| Carte de Cassini |
 |
| Cadastre Napoléonien - 1808 |
 |
| carte de Belleyme |
Remerciements à Madame Royle : 2 octobre 2015
 |
| Restauration du logis du 15ème. |

 |
| Vue d'avion - Neyssen |
 Un
Saint-Astier, marié à un Chamberlhac d’Agonac, se réfugie à Agonac où il meurt
en 1395 sans postérité, laissant tous ses biens à la famille de sa femme, dont
expressément le fief, alors important, de Crognac. Ce point est historiquement
prouvé. Un des fils de Jeanne de Chamberlhac et d’Arnaud de Bourdeille, au 15ème,
fonda la branche de Montanceix-Crognac et s’y fixa. Il peut très bien avoir
emmené avec lui des habitants d’Agonac- neyssen - pour repeupler ses domaines
dévastés par les guerres comme cela s’est passé pour Montagrier.
Un
Saint-Astier, marié à un Chamberlhac d’Agonac, se réfugie à Agonac où il meurt
en 1395 sans postérité, laissant tous ses biens à la famille de sa femme, dont
expressément le fief, alors important, de Crognac. Ce point est historiquement
prouvé. Un des fils de Jeanne de Chamberlhac et d’Arnaud de Bourdeille, au 15ème,
fonda la branche de Montanceix-Crognac et s’y fixa. Il peut très bien avoir
emmené avec lui des habitants d’Agonac- neyssen - pour repeupler ses domaines
dévastés par les guerres comme cela s’est passé pour Montagrier.a) Le village de Saint-Nexans à proximité de Bergerac
 |
| Carte de Belleyme |
Evénements qui pourraient justifier un mouvement migratoire, lors d’une période de trêve, à partir d’une petite communauté transportant le nom de lieu originel « Neyssen ».
b) Une migration Corrézienne - trois pistes de réflexion
1) Saint-Mexans à proximité de Tulle
2) La paroisse Saint-Julien de Tulle
Saint-Augustin - hameau de Mezinges
Patronymes Meygingeas - Meyssensas
Intéressons-nous à présent au hameau de Mezinges, commune de Saint-Augustin en Corrèze, à la présence du patronyme Meygingeas et sa ressemblance avec le patronyme Meyssensas.
Mezinges est situé sur le plateau des Monédières à 569 mètres d’altitude, au cœur du Limousin, entre Egletons et Uzerche, à 1 km 56 de Saint-Augustin, à 19 km au nord-est de Tulle, 94 km de Périgueux et 106 km de Léguillac de l’Auche.
Quelques petits groupes humains se sont installés bien avant la naissance du hameau de Mezinges dans un rayon de quelques kilomètres.
Ainsi, à 14 km, au lieu des Jaillants commune de Pradines, sur le site de « Champ Tuilier », un important matériel archéologique est mis au jour dans les années 1960, des fragments de meules de moulins à bras, des lissoirs, un petit aqueduc, des bronzes, des poteries sigillées, un col d’amphore et des têtes, très rares en Corrèze, de Gorgone en terre cuite ; seuls vestiges visibles aujourd’hui de l’occupation Gallo-Romaine des 1er et 2ème siècles avant Jésus Christ, la présence de deux temples. Joudoux R. In revue archéologique du Centre, tome 2, fascicule 4, 1963.
A 2 km de Saint-Augustin, une parcelle dite « Comble-Noble », à 400 mètres du hameau des Boiroux, abrite une riche sépulture aristocratique masculine Gauloise du dernier tier du 1er siècle avant Jésus-Christ, découverte en 1992, avec présence d’une fosse, d’un coffre de bois, du mobilier funéraires, céramiques - bols, écuelles, assiettes, jattes et pots, trois amphores, des ferrures, une lance, un couteau, un manipule, une fibule, des armes et de nombreuses céramiques. L’étude pollinique permet une représentation du paysage en l’an moins 20. « Un paysage relativement ouvert, des zones prairiales à graminées, se situant probablement en fond de vallon où une aulnaie se développe, les côteaux sont occupés par des zones boisées peu denses avec le hêtre, le bouleau, le tilleul, accompagnées de bruyères. Les cultures sont présentes avec les céréales et le sarrazin ». Dussot, Lintz et Vuaillat in Aquitania - 1992
D’autres sites antiques de moindre importance sont répartis autour de Saint-Augustin comme à Mezinges, avec la présence de tegulae et d’une sépulture.
Un habitant de Saint-Augustin, Monsieur C. Guillaume s’est particulièrement intéressé à l’histoire de son village, (voir articles dans la revue Lémouzi).
Monsieur Guillaume, dans son courrier du 30 octobre 2019, note « qu’un groupe de clercs s’est installé sur le site du bourg, à 200 mètres de la vieille voie gallo-romaine reliant les Cadurques aux Lémovices, sans doute un peu avant 950, mais reconnu comme tels à cette date. Installés ou bien seulement officialisés par le grand Turpion, évêque de Limoges, issu de la grande famille des vicomtes d’Aubusson.
Ces clercs, peu nombreux, une petite dizaine, ont constitué ensuite un prieuré, ce qui est assez commun aux 10ème - 11ème siècles.
Il a bien aux archives départementales de la Corrèze un dossier sous la côte G 35 liasse dite « prieuré Saint-Augustin », composée de 122 pièces-papier pour la période 1494 - 1516.
Ce prieuré semble avoir donné quelques bons théologiens installés à Limoges : les « Jauvions » dont une rue de Limoges porte le nom. Au moyen âge il y avait à Saint-Augustin un quartier du bourg entièrement dit de la « Jauvionderie ». Que le prieuré ait disparu vers 1500 c’est possible vue les désordres de la guerre de cent-ans ».
Naissance d’un village
Au début du 10ème siècle, l’évêque de Limoges, Turpion, fonde l’abbaye de Saint-Augustin de Limoges, et, vraisemblablement avant 944, « officialise le prieuré de Saint-Augustin ».
Selon d’autres sources, non vérifiées, avec l’expansion du christianisme, il semble qu’une première église (d’origine privée ?) faite de bois était érigée à environ 1,5 km au nord du hameau de Mezinges. Devint-elle possession des clercs de Saint-Augustin lors de la création du prieuré après donation ?
Les terreurs de l'an mille, plus exactement entre 1030-1033, millénaire de la mort du Christ, sont marquées par le mal des ardents (parasite du seigle), et une grande famine.
Les épreuves, la peur de l'imminence du jugement dernier, sont mêlées d’élans et d’espoirs.
La fin du 11ème siècle annonce de longues décennies d’épidémies, famines, pestes, et lèpre.
La vie quotidienne devient si difficile que bientôt les habitants vont migrer vers le prieuré ; peu à peu se créé un nouveau village autour d’une église dédiée à Saint-Augustin, (hagiotoponyme : nom de lieu donné en référence à un Saint) à l’emplacement que nous connaissons aujourd’hui près de la route médiévale reliant Barsanges à Saint-Augustin. La construction de l’église est vraisemblablement achevée avant la fin du 12ème siècle à l’apogée du rayonnement de l’abbaye Saint-Augustin de Limoges.
Le village marque ainsi sa dévotion à l’un des quatre pères de l’église d’Occident, Saint-Augustin d’Hyppone en Tunisie au 5ème siècle.
A présent, l’église est un petit édifice rural à nef rectangulaire fait d’éléments du début du 13ème siècle sur lesquels furent ajoutées, au 14ème siècle, trois chapelles voûtées.
Quelques traces de la seigneurie de Saint-Augustin :
Le cartulaire de l’abbaye de Beaulieu sur Dordogne, en Corrèze, dont les possessions monastiques sont immenses entre les 9ème et 10ème siècle, mentionne la présence d’une soixantaine d’églises, chapelles, une centaine d’exploitations rurales et tenures paysannes, dont une tenure paysanne ou portion de seigneurie à Saint-Augustin, objet d’une donation.
A cette époque-là, la Corrèze est partagée en quatre vicomtés : Limoges, Turenne, Comborn et Ventadour.
Alliances obligent, dans le courant du 14ème siècle les Comborn possèdent quelques domaines taillables et détiennent justice sur la paroisse.
Anthroponymie d’un patronyme
Aux alentours de la guerre de cent-ans, vers 1337, découvrons la naissance d’un nouveau patronyme à Mezinges, ou, en provenance de Mezinges : Meygingeas.
Tout d’abord étudions la toponymie « Mezinges » : par comparatif, il existe en Haute Savoie un village nommé Mezinges ou Mézinge, pour lequel il est communément fait référence à une origine burgonde, dérivant probablement de Miesingus, du germanique meusa, musa, désignant un lieu marécageux, « où pousse la mousse » - Le Régeste Genevois mentionne l'ancienne paroisse sous les formes Messinges ou Mezinges.
Monsieur C Guillaume note à ce sujet « il faudrait dire Mezange (cacographie) on trouve en Corrèze plusieurs formations de cet ordre ; Fressinges pour Fressanges - le domaine des frênes, ou Palazinges, le village de Mezinges - Mézanges - le domaine des marais ? a repris le nom gallo-romain de la villa qui se trouvait au nord du village ».
Difficile de découvrir l’écriture originelle du patronyme sous la plume des curés du 16ème siècle, Meigenjas, Meigingeas, Meyzingas, Meyzinzas ou Meissengeas, formés avec assurance à partir du nom du hameau « Mezinge » suivi du suffixe « as » ; en effet, il est fréquent que des communautés familiales aient été désignées de leur patronyme suivi du suffixe - as - ou - ias - (collectif).
1) Le nom du hameau est ainsi passé à l’habitant, la communauté nomme alors un groupe familial, habitant Mezinges, « las Mezingeas ».
2) Le patronyme peut être issu d’une migration ; un groupe familial nouvellement arrivé à Affieux, (présence du patronyme attestée dès 1650), est appelé par la communauté, les « Meyzingeas », habitants en provenance de Mezinges. Il s’agit d’une courte migration de 14 km - voir article dans « Implantations ».
Remarque de Monsieur Jacques Astor, conférencier et spécialiste en onomastique, le 17 septembre 2015 :
« Les rapprochements avec le nom de famille Meyzinzas et avec les noms de lieux Mezinge / Meissengeas sont tout à fait intéressants et vont permettre d'ouvrir une autre issue aux recherches ».
Autre remarque de Monsieur Astor qui semble cependant douter de l’origine Corrézienne de notre patronyme quant-il écrit :
« Par contre, il est évident que l'on a régulièrement 2 s doux avec Meyzinzas (qui passe normalement à j = ge, d'où Meygingeas) qui n'ont rien à voir avec avec les 2 s sourds de Neycensas / Meyssensas ».
Cependant on rencontre quelques entorses à la phonétique et l’orthographe originelle du 16ème siècle, ainsi « Meissengeas », on peut donc se poser la question …… le G central passant à 2 SS.
On est en présence d’une double évolution du patronyme à travers les siècles.
A partir d’une migration de la Corrèze vers le Périgord, en considérant que l’écriture du patronyme ai évolué au contact des habitants de Léguillac de l’Auche avec un parler occitan et un accent différents, voir l’ouvrage de Pierre Monteil, « le parler de Saint-Augustin » où, plus tardivement, sous la plume des notaires et curés successifs pour passer finalement de Messingeas à Meyssensas, puis, par attraction paronymique, et définitivement dans le courant du 17ème siècle, de Meyssensas à Neyssensas.
La paronymie est un rapport lexical entre deux mots dont le sens diffère mais dont la graphie ou la prononciation sont très proches, de sorte qu'ils peuvent être confondus à la lecture ou à l'audition. Il s'agit donc d'une homophonie proche ; on pourrait dire également qu'il s'agit d'une homonymie approximative.
Selon Mr Guillaume, « l’attraction paronymique du premier vers le second, du premier on en a perdu le sens mais le second pour nos ruraux a lui un sens ; il veut dire naissance, mot familier pour les oreilles de nos pagani. Il ne faut pas y chercher une explication rationnelle mais simplement une évolution phonétique, peut-être donc une branche de vos ancêtres provient de notre région ».
Pourquoi quitter la paroisse de Saint-Augustin ?
La guerre de cent ans se termine et laisse derrière elle un pays meurtri par des décennies de conflits entre la dynastie des Plantagenêt à celle des Valois et, à travers elle, le royaume d'Angleterre et celui de France.
Le prieuré de Saint-Augustin semble avoir souffert d’avantage et ne peut à peine se relever, on va donc négliger sa restauration, car ce sont bien les plus petits établissements qui ont le plus à souffrir des malheurs de ce temps. Le prieuré disparait ainsi à l’aube du redressement économique du pays.
S’engage, en parallèle, après 1453, de grands mouvements de populations, des femmes et des hommes avec de vrais motivations, par trop de bras, quittent les terres froides et déshéritées du Limousin, terres d’élevage et de culture du seigle, quittent aussi les trop fréquentes épidémies de peste de 1455 ou 1478, les hivers trop rudes comme cet hiver de 1463….
Les dernières compagnies ont fui le Périgord, le pays est déserté, les Meyssingeas de Mezinges ont-ils répondu aux campagnes de repeuplement engagés par les seigneurs locaux, ecclésiastiques ou pas …. Les d’Abzac, les Pompadour, ?
Nous avons quelques exemples de repeuplements au sein de la paroisse de Léguillac de l’Auche :
L’une des tenances du prieuré de la Faye, courant 17ème siècle, se nomme tenance des « limouzains », lieu aujourd’hui disparu, gérée par quatre tenanciers, une preuve supplémentaire de migrations en provenance du diocèse de Limoges.
Le hameau de Perpezat né peut-être après migration d’une communauté provenant de Perpezac (domaine de Perpetius ?), en Corrèze, village qui verse cens et rentes au 14ème siècle à la seigneurie de Treignac à quelques kilomètres de Saint-Augustin.
De même, le hameau d’Armagnac, dont l’auteur Monsieur Higounet-Nadal attribue l’origine à une migration d’origine gasconne, in « Mouvements de population dans le midi de la France du XI au XV siècle d’après les noms de personne et de lieu ». Article de notre blog « implantations ».
Tout comme nous avons analysé la possibilité d’une migration en provenance de la région Gasconne avec les d’Abzac de la Douze, un autre personnage important gravite autour d’une nouvelle migration des Meygingeas / Meyssengeas, mais cette fois, de Corrèze vers le Périgord après la guerre de cent-ans ; il s’agit de Geoffroy 1er de Pompadour, né en 1430 au château de Pompadour en Corrèze, fils de Golfier, vicomte de Pompadour, et d'Isabelle, vicomtesse de Comborn, fille de Guichard, vicomte de Comborn. Pompadour se situe à quelques 50 km du village de Saint-Augustin.
Ce que nous savons : dès le milieu du 14ème siècle les alliances de lignages deviennent prestigieuses, les Pompadour s’allient, par mariages, aux lignées vicomtales de la région, les Comborn, Ventadour et Turenne. La mère de Geoffroy est une Comborn, c’est elle qui apporte les seigneuries de Chamberet et de Treignac aux Pompadour en 1426, dont une partie du village de Saint-Augustin.
Serait-ce le lien nécessaire d’une migration possible, le prieuré et l’église de Saint-Augustin en Corrèze sont sous obédience Augustinienne, tout comme le prieuré de la Faye à Léguillac de l’Auche ou le couvent de pères Augustins de Périgueux ?
Pontifical à l’usage de Périgueux de la seconde moitié du 15ème siècle,
enluminé pour l’évêque Geoffroy de Pompadour.
En effet, Geoffroy de Pompadour, surnommé « Chasteau-bouchet » devient évêque de Périgueux en juillet 1470. S’il fait son entrée solennelle plus tardivement, en 1480, après semble-t-il des démêlés avec le chapitre cathédral, Geoffroy gouvernera presque 16 années, jusqu’en mars 1486.
Il devient gestionnaire du prieuré de La Faye à Léguillac de l’Auche en 1473, de l’abbaye de Chancelade en 1478, du prieuré de Saint-Jean de Cole en 1482 et s’investit dans la fondation d’un couvent de pères Augustins hors la ville de Périgueux en 1483, couvent bénit par Geoffroy, en présence de Pierre d’Abzac, de la maison de La Douze, religieux de Saint-Augustin, évêque de Rieux, puis de Lectoure ; il fut fait archevêque de Narbonne en 1494.
Le grand aumônier de France, Geoffroy, tout à la fois seigneur et évêque, va accroître rapidement ses revenus…. Il faut à tout prix repeupler les terres du diocèse.
Est-ce sous l’épiscopat de Geoffroy que les Meygingeas / Meyssengeas vinrent en Périgord, à Périgueux tout d’abord et Léguillac de l’Auche peu de temps après ?
Périgueux, ville frontière pendant la guerre de cent ans, fidèle au roi, Périgueux en véritable petite république conserve son statut de ville libre. Les habitants, sous le règne de Louis XI, ne paient d’ailleurs ni la dîme ni le denier du culte. Franchises fiscales qui finalement ont de quoi convaincre bon nombre d’artisans, commerçants et laboureurs des provinces voisines.
« Tisserands, marchands drapiers, merciers, opèrent en liberté. Même lorsqu'ils ont été attirés dans la ville à prix d'argent, les artisans restent libres. Les consuls donnent-ils 50 écus à trois teinturiers de Toulouse pour obtenir leur établissement à Périgueux - du côté de la Limogeanne, semble-t-il - ils n'exigent d'eux que l’engagement, d'y faire draps et teintures » - Arch. mun. Périgueux, CC 90, f° 27 v°.
Le Registres des Comptes du consulat de Périgueux note la présence du maçon Martí Jordà de Treignhac (14 km de Saint-Augustin) et sa participation à la reconstruction de la tour Mataguerre qui tombe en ruines en 1477.
Est-ce après Pâques de l’an 1482, que les Meyssensas quittent à nouveau Périgueux pour se réfugier en campagne à Léguillac de l’Auche, à proximité du prieuré Augustinien, car la lèpre, le mal-chaud et les fièvres pestilentielles parcourent la ville, la famine sévit dans les provinces voisines, c’est bientôt un afflux de pauvres étrangers attirés par la renommée de la ville qui envahissent les rues, « on meurt partout en masse, tant alz hospitlalz que aillours en la dicha villa, en bladarias et per las estables et charieias, de faim autant que de maladie » - Arch. mun. Périgueux, BB 14, f° 37.
En fin d’année 1482, la ville est désertée par ses habitants, le mal revient encore plus violent en juin 1483……
Geoffrey est à nouveau Périgueux, de 1500 à 1504, mais cette fois en qualité d’administrateur du diocèse.
 |
| Charles VIII |
 |
| Louis XI |
Sous les monarchies de Louis XI et Charles VIII. Geoffroy devint conseiller d'état sous. Accusé de trahison avec Georges d'Amboise, évêque de Montauban, et Philippe de Comines, pour avoir favorisé le duc d'Orléans, il reste deux ans en prison. Libéré sur la recommandation du pape, Geoffroy meurt en mai 1514, à Paris.
Liens avec le Périgord : Antoine de Pompadour se marie avec Catherine de la Tour le 4 juillet 1489, sont présents les Comborn, les Pompadour de Château-Bouchet à Angoisse, Geoffroy de Pompadour, évêque de Périgueux et du Puy, mais aussi Jean 1er de Talleyrand, seigneur de Grignols, à quelques lieux de Léguillac de l’Auche, époux de Marguerite de la Tour.
La cuve baptismale de l’ancienne église de Saint-Augustin, (époque Carolingienne ?) et une ancienne croix située à l’entrée de Mezinges conservent peut-être encore le souvenir des Meygingeas / Meyssengeas.
 En
1691, le jeune clerc de Montrem, Jean Meissenssas, orthographie son nom
« Meissenssas ». La famille prononce donc bien la première syllabe
[mé] et non [né].
En
1691, le jeune clerc de Montrem, Jean Meissenssas, orthographie son nom
« Meissenssas ». La famille prononce donc bien la première syllabe
[mé] et non [né].Remarques en marge :
https://www.facebook.com/leguillacdelauche/
Patron Saint Grégoire
Nous découvrons Guillaume sur un acte daté de 1526 référencé 12 J 162 aux archives départementales de Périgueux. L’acte est conclu entre le prieur de La Faye et quatre habitants du village, tous « hosteliers » et concerne l’un des droits de ban, le droit « d’estang » ou le prieur à la possibilité de vendre son vin, tout au long du mois d’août.
« Sachez tous présents et à venir, qu’aujourd’hui, huit août 1526, en ma qualité de notaire, et en présence des témoins ci-dessous désignés, personnellement constitués et habitants le bourg de Léguillac de l’Auche, diocèse du Périgord, maître Jean de la Coste, clerc, procureur et receveur de l’honorable homme maître Martial de La Coste, bachelier en droit canon, prieur-commendataire et seigneur de La Faye et de Léguillac, d’une part, et Hélie Rapnouil dit Cappe, Pierre Chabanes dit le Masson, Guillaume Meyssensas et Catherine de Célérier, habitants et hôteliers du bourg de Léguillac, d’autre part.
 Après la victoire Italienne de Marignan en 1515, François
1er, le « Prince de la Renaissance », est le premier à renforcer
de façon radicale l’autorité monarchique. Les habitants de Périgueux rendent
hommage au Roi.
Après la victoire Italienne de Marignan en 1515, François
1er, le « Prince de la Renaissance », est le premier à renforcer
de façon radicale l’autorité monarchique. Les habitants de Périgueux rendent
hommage au Roi.et 1630 à Léguillac
Ivanne Moreau est présente en 1672 au village de Davaland - Saint-Astier.
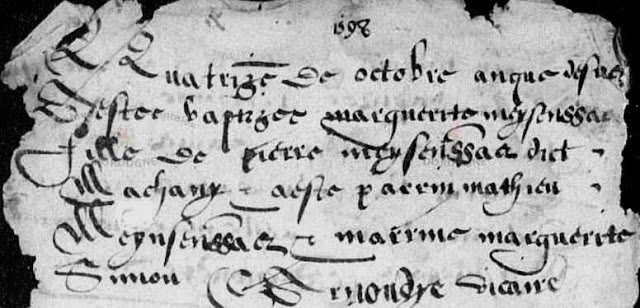 |
| Baptême de Marguerite - 1598 |
 |
| Baptême de Girou - 1599 |
 |
| Mariage de Charles - 1677 à Tamarelle - Saint Astier |
Nous retrouverons Charles dans « Gros plan sur les familles de Saint Astier » - acte de mariage ci-dessus. Au moins 3 générations, connues, ont vécues à Font Chauvet, ; Adrieu, Girou, et Charles.
 Font Chauvet se situe à environ 1 km 500 à l’ouest du bourg de Leguillac. Le plan cadastral de 1808 nous éclaire sur la répartition du terroir : Outre un petit près à l’arrière des maisons, 50 % de terre sont cultivées, 20 % en châtaigneraies, le restant, 10 % en vigne, 10 % en prés, 5 % en futaies, et 5 % en friches. Les deux habitations existantes en 1808, ont disparues en 2011 sur le plan cadastral. La source se situe à 100 mètres au nord des deux anciennes habitations. Aujourd’hui on retrouve le même petit massif de châtaigner, entourant le vallon de Font Chauvet, à l’ouest et au sud. Les autres parcelles sont essentiellement des près. Les parties boisées se situent sur un sol argilo-sablonneu, les parties cultivées sont appelées dans le parler local « blancairas »
Font Chauvet se situe à environ 1 km 500 à l’ouest du bourg de Leguillac. Le plan cadastral de 1808 nous éclaire sur la répartition du terroir : Outre un petit près à l’arrière des maisons, 50 % de terre sont cultivées, 20 % en châtaigneraies, le restant, 10 % en vigne, 10 % en prés, 5 % en futaies, et 5 % en friches. Les deux habitations existantes en 1808, ont disparues en 2011 sur le plan cadastral. La source se situe à 100 mètres au nord des deux anciennes habitations. Aujourd’hui on retrouve le même petit massif de châtaigner, entourant le vallon de Font Chauvet, à l’ouest et au sud. Les autres parcelles sont essentiellement des près. Les parties boisées se situent sur un sol argilo-sablonneu, les parties cultivées sont appelées dans le parler local « blancairas »La condition paysanne, dès le 13ème, évolue en Périgord
L’ambitieux Vigier, parfois violent, habitant la Font-de-l’Auche, accroît son patrimoine foncier au détriment de ses bailleurs, refuse de payer la dîme aux fermiers du prieur et la restitution des rentes du prieuré. Le prieur de La Faye et Pierre d’Abzac de la Douze, son beau-frère, vont profiter des tensions politiques du pays pour tenter de nuire à Vigier en envoyant quelques gens d’armes à son domicile.
L’aliénation des rentes du prieuré de La Faye
 |
| Henri IV |
Depuis l’assassinat d’ Henri IV, en 1610, le contexte politique n’est pas favorable aux protestants. Des menaces de guerre apparaissent à nouveau, Henri de Bourdeilles (1560-1641), sénéchal et gouverneur de la province, mobilise à partir de 1615 des compagnies de gens d’armes qui vont loger à de nombreuses reprises à Léguillac.
 |
| Louis XIII |
Le témoignage de Mathieu
« Mathieu Meyssensas laboureur habitant du village d'Armanhac paroisse de Lagulhac, agé de cinquante cinq ans ou environ, dict - sur ce enquis - cognoistre les parties, desquelles nest parent, allié, grand amy, familher, domestic ni ennemy Apres, enquis sur le contenu esditz faictz , suyvent lettiquete a nous envoyée de ce … …, dict que pandant et durant ces dernieres guerres et esmotions - dont il aura trois ans en lhiver prochain - il fust faict tant de logementz de gens de guerre, a pied et a cheval , en ladite parroisse de Lagulhac et autres circonvoysines que ledit deposant ne scauroyt bonnement specifier.

Car il advint que durant quelques moys que lune nestoyt deslogée dudit lieu de Lagulhac que lautre ne survint pour y loger et presuppoze luy depposant : que durant lesdites guerres [.. pli de la page...] fust faict plus de vingt et cinq ou vingt et six logis en ladite parroisse, vivantz les soldatz desdites compagnies a discretion sur ladite parroisse et y exerceantz tous les ravages et pilheries que gens de telle sorte ont acoustumé uzer. Tenentz les champs en telles occurrences - ainsin que ledit desposant auroiyt veu et pour son particulier, senty et experimenté lesditz ravages et pilheries que luy ont esté faictes. Et comme ladite paroisse de Lagulhac estoyt ainsin foulée par tant de logementz de gens de guerre, entre autres un nommé le cappitaine Latour que lon disoyt estre sergent majeur du regiment du Sieur de Bourdelhe, y vint fere logis, avec toutes les compagnies dudit regiment et aulcuns des soldatz desdites compagnies dudit regiment estant logés en la maison dudit depposant, dirent que ledit cappitaine Latour sestoit là rendu - heure de nuit - pour adviser le moyen de surprendre le prieuré de Lafaye appartenant audit deffendeur que est situé en ladite parroisse de Lagulhac dont ledit Sieur prieur heust advertissement par quelcun de ses amicz. Que fust cause quil se pourveust de plus grand garde quil navoyt acoustumé de y faire au paravant. Tellement, que par le moyen
Traduit par Paléo-FGW le 8 octobre 2016
Mathieu Meyssensas, âgé d’environ 55 ans, laboureur au village d’Armagnac, commune de Léguillac de l’Auche, est sollicité en qualité de témoin lors du procès opposant le Sieur Vigier, riche propriétaire, et le prieur de La Faye.
Mathieu après avoir pris connaissance des faits, reconnaît « ne pas être ni parent, allié, grand ami, familier, domestique ou ennemi » du défendeur, Bernard Jay, prieur et du demandeur Vigier et note que « pendant et durant ces dernières guerres et esmotions, cela fera trois ans à Noël, qu’il y eut tant de logement de gens de guerre, à pied et à cheval, qu’il est impossible d’en connaître le nombre ; que sur Léguillac il y eut bien 25 ou 26 logis de soldats vivant à discrétion sur la paroisse et excercant ravages et piheries ».
Mathieu souligne « qu’il aura vu pour son particulier senty et expérimenté les dits ravages et pilheries ».
Mathieu, dit Ramonet, va héberger à son domicile les soldats de l’un des régiments du Sieur de Bourdhelhe commandé par un certain Capitaine Latour.
 Mathieu entend fortuitement les propos
de quelques soldats concernant l’échec de leur capitaine dans l’attaque du
prieuré, le prieur ayant « heust
advertissement par quelcun de ses amicz et qu’il pourveust le prieuré de plus
grande garde ».
Mathieu entend fortuitement les propos
de quelques soldats concernant l’échec de leur capitaine dans l’attaque du
prieuré, le prieur ayant « heust
advertissement par quelcun de ses amicz et qu’il pourveust le prieuré de plus
grande garde ».Mathieu, sa femme, ses fils, Félibert, Marot, et Antoine, décident alors de ne pas quitter leur habitation dans la crainte d’exactions et « qu’elle ne fut du tout ruynée et pilhée ».
En effet, le bruit courait, qu’à Agonac, les hommes du Capitaine Latour avaient commis « forcementz de femmes, perte de papiers jettés au feu, plume de lits jetées au vent ».
Mathieu, à décharge du prieur, indique qu’il n’a jamais été obligé de transporter du blé ou du vin à Périgueux, que les tenanciers du prieuré ou lui-même, s’ils ont été employés par le prieuré pour des gardes de nuit comme il était convenu au début des guerres, c’était bien de leurs propres grés.
En effet, Mathieu et les « tenanciers, au commencement des guerres, avaient convenu de faire garder par le prieur, leur biens, vivres et ustensiles, et leurs propres personnes, ne tenant que bien peu en leurs maisons ».
Le précieux témoignage de Mathieu se situe dans un contexte de révolte larvée fondée sur la présence et les interventions incessantes des gens de guerre dans les villages et les exactions des receveurs des tailles, auxquels s’ajoutent parfois les pillages.
Henri, parent du célèbre écrivain et chroniqueur Pierre de Bourdeilles, nait vers 1570 et décède le 14 mars 1641. Il est qualifié de vicomte et baron de Bourdeilles, marquis d’Archiac, seigneur de La Tour-Blanche, conseiller d’Etat, capitaine de 50 ou 60 puis 100 hommes d’armes des Ordonnances, Sénéchal et Gouverneur du Périgord en 1597, conseiller du Conseil Privé du Roi en 1572 et chevalier des Ordres en 1619. Il épouse le 14 janvier 1604 Madeleine de La Châtre.
Les compagnies d'ordonnance sont les premières unités militaires permanentes et donc professionnelles à disposition du roi de France. Les hommes d’armes se déplaçaient à cheval.
1621 - Marguerite Meyssensas, épouse d’un soldat du Roi Louis XIII
Le registre paroissial de l’année 1628 est le premier document de la paroisse de Léguillac de l’Auche a évoquer l’existance d’un soldat au service du roi. Il s’agit de Giraud Simon, habitant du bourg, époux de Marguerite Meyssensas, mariés avant 1620.
Mme Raluy - Léguillac de l’Auche - page 262.
Peu d’information sur l’ascendance de Marguerite ; cependant deux choix s’imposent en consultant le registre paroissial :
Marguerite, fille de Pierre dit « Mchany » et Marguerite Simon, est présente sur le 1er acte de baptême du 1er feuillet du registre paroissial de Léguillac de l’Auche, en octobre 1598. La famille Simon est présente régulièrement dans l’entourage des Meyssensas par mariages ou parrainages, ainsi à la fin du 16ème siècle, au moins 4 épouses Meyssensas sont nées Simon.
Ou est-ce Marguerite, fille de Mathieu dit « de Ramonet » habitant le hameau d’Armagnac, sœur d’Annet et épouse du notaire Charles Rondet mariés avant 1615 ? Pierre Rondet père, notaire, est parrain lors du baptême de la petite Marie, fille de Giraud Simon et Marguerite en 1621. Charles Rondet appose de même sa signature au bas de l’acte.
Le 26 octobre 1621, la petite Marie nait au bourg, en l’absence de son père Giraud, soldat piquier du roi. Giraud, le 26 octobre, participe au siège de Montauban. Deux soldats de Léguillac on rencontré Giraud près de Libourne, début décembre, de retour du siège de Montauban. Marguerite vraisemblablement a connaissance du sort réservé à son mari, en effet les témoignages sur son état de santé laissent peu d’espoir sur un possible retour.
A la fin du conflit, le 27 juin 1629, Richelieu accorde aux protestants la paix d'Alès, le maintient de l’Edit de Nantes et la suppression des privilèges accordés aux protestants.
Marguerite n’attend pas la fin du conflit et sollicite le 30 septembre 1628 le curé Charrière pour « le sacrement du mariage, sept ans après l’absence de Giraud Simon, son mary ». « La Sainte Eglise suivant l’ordonnance et les décrets » requiert la parution devant le curé de deux témoins. Voir paragraphe - Le siège de Montauban.
Marguerite se marie ce 30 septembre avec Jiriou Simon, veuf depuis à peine 3 mois. Jiriou dit « le Jeune », laboureur à bras, habite le hameau de Merlet. Il est fils de Marsalou Simon et Thonio Linard (décédée le 21 mai 1629, peut-être victime de la peste ou d’une disette céréalière).
Jiriou est peut-être frère du défunt. Le registre paroissial nous apprend que son épouse Sicarie Simon est décédée le 27 juin 1628, peut-être elle aussi victime par la peste.
 Le Royaume de Louis XIII fait face depuis 1628 à de graves épidémies de peste. Le curé de Léguillac de l’Auche enregistre en 1627, 13 personnes « ensevelies » puis brusquement 23 en 1628, la peste est arrivée à Léguillac et les villages voisins. En 1629, la mortalité s’atténue avec 14 décès, puis 14 en 1630.
Le Royaume de Louis XIII fait face depuis 1628 à de graves épidémies de peste. Le curé de Léguillac de l’Auche enregistre en 1627, 13 personnes « ensevelies » puis brusquement 23 en 1628, la peste est arrivée à Léguillac et les villages voisins. En 1629, la mortalité s’atténue avec 14 décès, puis 14 en 1630.
Marguerite, la fille du couple, Marie, Jiriou et sa fille Mondine née en 1624, et Peyronne, enfant à venir (1629-1650) vont dorénavant vivre à Merlet. Jiriou décèdera au village de Merlet le 18 novembre 1670 à l’age de 90 ans.
Les Simon sont bien implantés à Merlet, « Jean de Chaumont donne à titre de bail le mainement de Puyprebastre en 1598 » à deux frères Simon habitant Chantemerle ou Merlet (domaine appartenant aux Chantemerle de Saint-Aquilin). « Un siècle plus tard, les Simon sont des laboureurs prospères, en 1702, la vente de biens immobiliers entre membres de la famille Simon confronte la maison des hoirs de Marsoudou Meyssensas ». En italique - extraits Mme Raluy.
Mme Raluy note la présence d’au moins 5 habitations en 1702. La rente est payée au seigneur de Gréziniac. En 1808 l’unique maison de Merlet appartient encore aux Simon, présents aussi lors du recensement de 1886. On remarque les trâces de batis très anciens en façade.
Les raisons du départ, être soldat au temps de Louis XIII
Après la régence mouvementée et pro-espagnole de sa mère, Louis XIII et Richelieu rétablissent progressivement l'autorité royale en brisant les privilèges des protestants. C'est par un coup de force, le 24 avril 1617, que Louis XIII accède au pouvoir. Il ordonne l'assassinat du favori de sa mère, Concino Concini et exile Marie de Médicis à Blois.
Le roi se rend à Pau en Béarn, dont il est le souverain, pour y rétablir la religion catholique comme religion officielle. Dès lors, il entend mettre fin aux privilèges politiques et militaires dont bénéficient les protestants depuis l'édit de Nantes et imposer le catholicisme d' État à tous ses sujets. De 1621 à 1628, il combat les protestants puis détruit les fortifications de leurs places-fortes.
Malgré la promulgation de l'édit de Nantes en 1598 par son père Henri IV, Louis III mène une première campagne contre les protestants en 1621 et permet la prise de Saint-Jean-d'Angély en juin, puis soumet la Guyenne.
Le régiment de La Douze, levé le 7 juillet 1621 par Charles d'Abzac marquis de La Douze, participe à la répression organisée contre les Huguenots. En 1621, il participe au siège de Montauban. Giraud Simon, Bernichou Veyssière, tailleur au bourg, et Jehan Barthoulomé du hameau de Merlet appartinrent-ils à ce régiment, étaient-ils présents devant Bergerac le 16 juillet 1621 lorsque Louis XIII entre dans la ville, en proie à de vives révoltes.
Présent lors des massacres de la Saint-Barthélemy, perpétrés à Paris dans la nuit du 23 au 24 août 1572, il raconte : « Mon père, mon frère aîné et moi-même, avec d'autres membres de la famille de Caumont, étions venus à Paris pour assister au mariage d'Henri de Navarre avec Marguerite de Valois. Nous habitions rue de Seine dans le faubourg Saint-Germain-des-Prés. Protestants, nous figurions parmi ceux qui devaient être éliminés. Le temps mis par les soldats pour aller au faubourg avait été suffisant pour que les protestants soient prévenus et pour que la plupart puissent s'enfuir. Ce ne fut pas notre cas, le 24 aout, je fis semblant d'être mort entre les corps de mon père, François de Caumont, et de mon frère. Couvert de sang, je fus ensuite sauvé par un marqueur de jeu de paume qui me mena chez ma tante, Jeanne de Gontaut, sœur du maréchal de Biron et protestante. Ce dernier, catholique modéré, me cacha à l'Arsenal ».
La Force suivit le parti d'Henri de Navarre aux côtés duquel il fait ses premières armes et dont il resta toujours le fidèle compagnon et lui resta dévoué jusqu'à la fin. Il était dans le carrosse royal lorsque, le 14 mai 1610, Ravaillac porta le coup mortel au roi.
Le 17 août, le roi entame le siège de la ville de Montauban. Le roi catholique tente en vain de venir à bout de la ville huguenote et le siège ne cesse que quatre mois plus tard par la victoire des Montalbanais en novembre. (Nombre de coups de canons lors du siège par Jean de Natalis)
 |
Le recrutement :
Le recrutement des soldats pose le problème le plus sérieux à Richelieu et Louis XIII car il n’y pas de conscription comme nous l’entendons aujourd’hui. La création des régiments se fait par levée de volontaires ou racolement à « prix d’écus ». Le recrutement s’effectue aux échelons des Généralités, Pays, Baillages, Sénéchaussées et Paroisses, parmis les « pauvres, les désoeuvrés, les fainéants…… » réf : L'armée depuis le moyen âge jusqu'à la Révolution - Louisy et Jacob - 1889.
Le système des Milices Paroissiales et du tirage au sort n’est créé qu’au début du règne de Louis XIV - voir Jean Meyssensas, milicien de la paroisse de Léguillac en 1688.
La mode vestimentaire :
Giraud est munie d’une longue pique, d’où son nom de piquier, sa compagnie est alors disposée en carré en rangs serrés afin de repousser les charges de cavalerie et d’infanterie. Les armes tels les hallebardes et les pertuisanes sont encore utilisées. Comme les officiers, Giraud utilise aussi une arme de duels telles les rapières et les dagues de main gauche pour les engagements au corps-à-corps.
Le siège de Montauban :
Giraud, Bernichou, 21 ans, Jehan tout juste agé de 15 ans, quittent Léguillac aux alentours du mois de juin 1621 et rejoignent le régiment de la Douze. Les trois Léguillacois vont devoir parcourir les 170 km qui les séparent de Montauban, en 8 ou 11 jours par étapes de 15 à 20 km par jour de marche.
« S'ils tombaient malades en route, s'ils étaient blessés à la guerre, ils se voyaient exposés à mourir abandonnés dans les champs…… », pourtant tel ne fut pas le cas de Giraud.
Selon le témoignage de Jehan, 22 ans environ, habitant Merlet le 20 septembre 1628 auprès du curé Pierre Charrière, « en venant du siège de Montauban en compagnie dudit Simon, ll l’avait laissé grandement malade dans un champ de terre a une lieu de Libourne (4 km) et ne scavoir nullement de quoy il étoi devenu ». Giraud a-t-il été atteint de la fièvre qui causa le départ de l’armée du roi lors du siège de Montauban après un grand nombre de pertes ?.
Le second témoignage est celui de Bernichou, agé de 28 ans environ, tailleur du bourg, qui déclare le 28 septembre 1628 « que se retirant du siège de Montauban, il avoi rencontré le dit Simon dans l’hopital de la ville de Libourne en danger et probabilité de mort et a dit ne scavoir de quoy il était devenu ».
En 1621, il n’y a pas de service médical dans les armées. Richelieu l’organise par une ordonnance en 1629 et établit que tout régiment doit avoir une infirmerie et des chirurgiens.
La troupe de retour de Montauban fait halte à Libourne tout début décembre 1621. Giraud est admis à l’hopital de Libourne ou il meurt en fin d’année.
Les archives de l’hopital de Libourne conserve un document mentionnant le passage des soldats après la fin du siège de Saint-Jean-d’Angély le 21 juin 1621. « On envoya à Libourne 400 soldats malades ; les estropiés, pendant le siège, furent logés à l’hopital par ordre du roi ; puis, par arrêt du conseil d’Etat du 12 aout 1621, il fut accordé aux maire et jurats 300 livres sur les deniers de l’épargne du monarque pour les indemniser des soins dont ils avaient entouré ces soldats. Cette somme ne fut payée qu’en 1627 ».
Annecdote
Les soldats qui après la guerre avaient été licenciés, revenaient, en mendiant, dans leurs villages, et, s'ils étaient estropiés et infirmes, ils ne pouvaient plus gagner leur vie par un travail quelconque. On les rencontrait demandant l'aumône le long des chemins ou dans les rues des villes ; quelques-uns portaient les débris de leur uniforme, et d'autres, qui ne tardaient pas à devenir des voleurs dangereux, mendiaient l'épée au côté. Ils étaient si nombreux, à Paris, sous Louis XIII , qu'on les enferma, comme vagabonds, dans l'hôpital de la Pitié.
 A la fin du 19ème siècle, dans sa notice consacrée
à la paroisse de Léguillac de l’Auche extraite de « L'ancien et le nouveau Périgord », l’abbé Brugière note
la naissance de Jeanne, fille d’Antoinette Maissensas et de Charles Rondet,
notaire royal.
A la fin du 19ème siècle, dans sa notice consacrée
à la paroisse de Léguillac de l’Auche extraite de « L'ancien et le nouveau Périgord », l’abbé Brugière note
la naissance de Jeanne, fille d’Antoinette Maissensas et de Charles Rondet,
notaire royal.Annette est fille de Mathieu, marguillier, habitant du village d’Armagnac à Léguillac. Les archives paroissiales ne nous permettent pas de connaitre ses dates de naissance, vers 1590 - 1595, et de mariage avec Charles Rondet, avant 1615.
Le statut de notaire royal est développé dans le paragraphe "Léguillac de l'Auche - les plus anciens actes notariés : 1684 à 1703".
Les archives notariales restent encore le passage obligatoire pour découvrir et comprendre le monde rural ancien. Ce fond très riche permet de connaître précisément les pratiques foncières des Meyssensas des 17ème et 18ème siècles. Si les archives de Charles Rondet ne nous sont pas parvenues, les archives départementales de Périgueux détiennent, par contre, celles de Maître Reynaud qui établit en 1684 le premier acte mentionnant notre patronyme.
Le 10 mai 1612, Charles et son frère Pierre, notaire royal, apposent, pour la première fois, leurs signatures sur un acte de baptême.
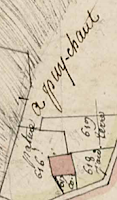
Charles Rondet n’officie que très rarement à son domicile de Puychaud - Puychal en 1633. Son activité de notaire rural est tributaire des saisons. Il se déplace le plus souvent au domicile des demandeurs, lorsque, par exemple, il s’agit de recevoir les dernières volontés d’un mourant, ou parfois même, à l’auberge du village, chez « l’hoste ».
On imagine Annette observant Charles ranger dans ses sacoches accrochées à la selle de son cheval, son encre, son papier et sa plume, et, le perdant du regard, partir au trot et parcourir le kilomètre le séparant du village.
La signature de Charles avec l’initiale de son prénom, « C » à l’intérieur de la boucle du R majuscule, suivi de son prénom abrégé.
Charles Rondet est le personnage le plus important de Léguillac avec le seigneur-prieur Bernard de Jay, et le curé Courcellaud. Il cumule plusieurs fonctions, celles de banquier, marieur, médiateur, ou agent immobilier. Son statut social le situe sur un même plan que le bourgeois ou le marchand.
 |
| le curé Courcellaud |
Charles Rondet fait partie des familles de notables bien établies depuis le début des registres paroissiaux en 1598, comme les Janailhac, les Chabanas ou les Linards. Ces notables sont affiliés à des titres divers aux prieurs de La Faye comme d’ailleurs quelques Meyssensas, mais aucun d’eux n’accèdera au statut de notable dans le courant du 16ème et début du 17ème sur Léguillac.
Mathieu, père d’Annette, est témoin, comme Charles Rondet dans l’affaire Vigier en 1618, Thomas sera fermier du prieur Jean d’Abzac de la Douze en 1638, Jean d’Abzac de la Douze sera parrain de la petite Catherine en 1647 …..
Charles Rondet en se mariant avec Annette Meysensas infirme la règle de l’endogamie pratiquée chez les notaires.
Si les enfants nés du couple et les liens avec quelques anciennes familles ne sont pas tous enregistrés sur les registres paroissiaux, on note cependant.
Mary Rondet, fille d’Annette nait en 1625.
Entre 1625 et 1639 les épidémies, disettes, famines et pestes se succèdent en Périgord, Léguillac ne sera pas épargné par la disette céréalière de 1625 - 1626.
« Le huitième jour du mois de décembre 1620 » la naissance de Pierre Rondet, au village de « Puychal », le parrain se nomme Pierre Rondet, notaire royal, la marraine, Marguerite Meyssenssas. Le prêtre Arnouldie, et Dalesme, Janalhac, Chazote signent au bas de l’acte.
Le 18 avril 1626, nait Jehan Rondet, fils de Pierre Rondet, notaire royal, et de Marguerite Blanchard, parrain, Jehan de Laporte, marraine, Marguerite Sailhac, demoiselle du lieu, en présence des patronymes Puyferrat, Chazotte, De Valbrune, Charles Rondet, frère de Pierre, et le curé Charrière.
Annette est marraine de Nardou Chazotte en 1627, cette même année, le bruit court à Léguillac que la famine a atteint Sarlat.
Charles Rondet est parrain de Charles Meyssensas, fils de Marot et d’Anne Simon de Léguillac le 6 février 1625.
Le Royaume de Louis XIII, fils d’Henri IV et de Marie de Médicis, fait face depuis 1628 à de graves épidémies de peste. Le curé de Léguillac enregistre en 1627, 13 personnes « ensevelies » puis brusquement 23 en 1628, la peste est arrivée à Léguillac et les villages voisins.
En 1629, la mortalité s’atténue avec 14 décès puis 14 en 1630.
En 1631 la peste sévit à nouveau à Périgueux, le registre de 1631 sur Léguillac a disparu, comme une partie de celui de 1632 qui enregistre cependant encore 6 décès en novembre et décembre. 1633 est incomplet et 1634 a disparu.
Le « dixième jours du mois de janvier 1633 », Charles Rondet déclare le décès de son épouse Annette Meysensas, fille de Mathieu d’Armagnac, « marguillier de la présente église de Lagulhac, famme de Maitre Charles Rondet, notere royal, ladite Annette a été enterré au semantière de la paroisse, et son mary a appellé pour son épouse a selebrer le divin service, Monseigneur Geoffroy du Soulier, prêtre et moyne du chapitre de Saint-Astier, le prieur du prioré d’Annesse Maitre Jehan ….. prêtre prébandier, curé de las Texinras ( ?), Jehan du Soulier, clerc, Jehan Barzac, Thoumieu Meyssensas, Pierre Lagueyrie, Léonard du Mas, ……… ».
D’autres membres Meyssensas sont mentionnés mais restent illisibles.
Annette n’a donc pas été victime de l’épidémie de peste.
Note : Charles Rondet de sa belle signature déclare la naissance de Gabriel Bibaud en juin 1632, à partir de cette date, peu avant la naissance de son fils Charles et du décès d’Annette, Charles ne signe plus avec la même application, ainsi en aout 1632, le « C » majuscule est inversé et précéde le nom de famille.
A nouveau entre 1636 et 1639 une nouvelle disette céréalière s’installe sur l’ensemble du Royaume.
Charles Rondet, Thomas Meissenssas du bourg, Pierre Gailhardon de Mensignac, et Simon Bournet de Gravelle sont nommés fermier du prieuré en 1638.
Charles signe à nouveau de sa belle signature à partir de septembre 1634.
Autres liens entre les Meyssensas et la famille Rondet les décennies suivante
En 1687, Jean Meyssensas, boucher au bourg de Laguilhat vend à Monde Fournier veuve de feu Pierre Rondet, bourgeois de Périgueux, et « habitante du bourg de Laguilhat de l’Auche, tous les bâtiments, ayzines, jardins, et biens à lui appartenant, sis dans le bourg de Laguilhat » acte passé au domicile du notaire Soulhier.
1647 - L’autorité seigneuriale au temps de Girou Neyssensas
 |
| Château Prieuré de La Faye |
Quelques siècles plus tard, en 1647, la contrée autour de Leguillac, est soumise à une double autorité. Jehan d’Abzac de la Douze est prieur de la Faye, et seigneur de Leguillac de l’Auche. Le patrimoine foncier du prieuré se compose de tenures paysannes.
 |
| Blason des d'Abzac |
On notera, aussi, comment les prénoms «passent» d’une paroisse à une autre ou d’un groupe social à un autre. Si l’on regarde de plus près les prénoms présents à Leguillac et Saint Astier, très peu de prénoms sont communs entre les deux villages jusqu’au début du XVII. Le prénom Sicaire ou Sicarie par contre est présent dans les deux villages, dès les années 1600.
Sicaire Meysensas dit « garçon » au temps de Louis XIV
L’article retrace quelques évènements de la vie de Sicaire Meysensas dit « garçon », laboureur à bras, habitant le hameau de Leypine à Léguillac de l’Auche entre 1676 et 1748, témoin de la fin des révoltes paysannes et du début de nouvelles crises de subsistance en Périgord. Il s’agit de l’un des Meyssensas pour lequel nous possédons le plus grand nombre de documents d’archives. Sicaire est l’ancêtre commun des Neycenssas relevés par Monsieur Georges Vigier, il y a quelques années.
Les évènements importants de sa vie
1676 : naissance
avant 1698 :
décès de son père, Marsoudou, peut-être en 1688
1698 : mariage avec Annette Labrue
1709 : testament de sa mère, Guilhoune Bibaud
1713 : conflit avec Pierre d’Abzac de la Douze, prieur de la Faye
1730 : bail de ferme
1748 : décès et partage de biens, la disette de 1747 en Périgord
Sicaire nait le 3 décembre 1676 à Leypine, à Léguillac de l’Auche, des époux Marsoudou, laboureur, et Guilloune Bibaud. Ses parents se marient le 11 juin 1651, soit 25 ans avant la naissance de Sicaire.
Le prénom Marsoudou est issu de Marsaud en lien avec le prénom Martial, devenu nom de famille avec la popularité du 1er évêque de Limoges, Martial au 3ème siècle ; quant à son épouse, Guilloune, le prénom est tout particulièrement utilisé dans un triangle Ribérac, Bergerac et Brive. Il dérive de Guillaume.
Lieu de vie du couple : Leypine se situe à quelques 500 mètres de Léguillac de l’Auche.
« Le hameau est habité, au début de 18ème siècle, par la lignée des Meysensas avec Martial dit Marsoudou, Marsoudou ou Marsaudon. A l’époque du prieur César de Mongrand, (1754-1757) Leypine est un ténement composé de plusieurs parcelles de terre appartenant à plusieurs propriétaires, parmi lesquels des laboureurs et des bourgeois, Messieurs Pontard et Soulhier ». Réf : Mme Raluy - Du paléolithique à l’ère numérique - 2016.
Quelques années après le décès de son père, Sicaire passe contrat de mariage en 1698, référencé aux Archives de la Dordogne sous la cote - 3 E 5266, n°8.
26 janvier 1698
Contrat de mariage entre Sicaire Meysensas et Annette Labrue
Le 1er acte notarié concernant Sicaire, 22 ans, (1er contrat de mariage connu dans notre famille), est rédigé le 26 janvier 1698 au village de la Martinie, à la métairie du Seigneur de Montozon, entre Sicaire Meysensas, et Annette Labrue.
La transcription est effectuée par un membre bénévole du site Geneanet en octobre 2014 et respecte la graphie du 17ème siècle.
1er feuillet :
« Ce jourd'huy vingt sixiesme du mois de janvier
mil six cent nonante huit au vilage de la
Martinie parroisfe de Lagulhiat de l'Auche en Périgord
et maison de la mestrerie du Seigneur Demontozon et ou
habitte Jean Labrue dit Chalard laboureur par devant moy
notaire royal soussigné et présents le tesmoins bas nommés
ont eftes présents le dit Jean Labrue dit Chalard laboureur
et Sicarie Jassalhiat conjoints et Annette Labrue
leur fille naturelle et légitime les dits Jassailhat et
Annette Labrue mère et fille dumeme authorizees du dit
Jean Labrue leurs mary et père pour l'effet des présentes
tous habitans du dit présent vilage de La Martinie pour eux
et les leurs a ladvenir d'une part et Sicaire Meysensas
laboureur fils naturel et legitime de feu Marsoudou
Meysensas et de Guilhoune Bibaud habitant du lieu de
Leypine prest le bourg du dit Lagulhiat aussy pour luy
et les siens d'autre part par lesquelles parties a este
dut mariage aussi este proparlé par parolle de futur
d'entre le dit Sicaire Meysensas de luy d'une part et de
la dite Annette Labrue d'elle d'autre lequel s'accompliras
s'il plaist a Dieu en fasce de Nostre Sainte Mere Esglize
Catholique apostolique et Romaine toutes fois et quantz
que l'une des dites parties en sera sommée et requize par
l'autre a peyne de tous despans dommages et intérêts
pour supporter les charges du dit futur mariage
les dits Labrue et Jassailhat conjoints ont de leurs
bon gré et libérale volonté conjointement et solidairement
2ème feuillet :
constitué comme constituant par les présents a la dite
Annette Labrue leur dite fille future expouze y presente
comme dessus et aceptante scavoir en la somme de
deux cent livres plus un lit garny de coyte et cuissin
depl(...) sans estre garny de plume plus un tour de lit
avec ses franges et coutures de toile de boyradis une
couverture de sarge de vilage grize, deux plats et une
assiette d'estain moyens, six linceuls scavoir cinq d'estoupe
grosses et un de boyradis deux napes scavoir une de
boyradis et l'autre d'estoupes grosses pl(...) de la longueur
chacune de deux aulnes, une douzene de f(...) de
boyradis triolées, un coffre ferré ferman a clef
de bois de noyer fait en menuizerie de la contenance de
huit boissaux de bled ou environ, le tout neuf
plus la somme de cinq livres pour avoir un chalit
et aussi la somme de six livres pour avoir de la
plume le tout pour tous les droitz et pretantions
que la dite future expouze pouvoit avoir et
pretandre sur les biens de ses père et mère et
payable la susdite somme de deux cent livres susdits
meubles effet et susdite sommes pour avoir le dit
chalit en plume scavoir la somme de cent cinquante
livres dans un an prochain venant a contre du jour
et d'acte de présents et les susdits meubles effet et susdite
sommes de cinq livres d'un costé et six livres d'autre
pour avoir le dit chalit et la dite plume le jour de la
bénédiction nuptialle et la somme de cinquante livres
restants dans un autre an après le dit jour et d'acte
des présents qui sera dans deux ans le tout sans
3ème feuillet :
donner interest qu'a deffaud du payement de ses pactions
a peyne de tous despans dommages et intérêts
recepvant laquelle constitution des susdites sommes et
susdits meubles et effets le dit Meysensas après la
réception du tout l'assignera sur tous de chasuns
ses biens meubles y meubles présents et advenir comme
demeuré assisgné des a présent (...) et
demeureront ces dits futurs expoux entre eux associes
moytié meubles et acquets qu'ils fairront pendant et
constant leutr dit futur mariage desquels acquets ils ne
pourront dispozer qu'en fabveur des enffants ou filhes
qui proviendront d'yceluy pacte acordé entre ces dits
parties que cas advenant le depces dudit Meysensas
futur expoux avant la dite Labrue sa future
expouze auquel cas elle gaignera sur les biens d'yceluy
par droits du sole et agensement la somme de soixante
livres et au contraire cas advenant le depces
de ladite Labrue future expouze avant le dit Meysensas
son futur expoux auquel cas il gaignera sur les biens
d'ycelle par mesme droit du sole et agensement la
somme de trente livres et pour l'entretien
de tout ce que dessus les dites parties ont obligé et
hypothéqué tout et chasuns leurs biens meubles
ymeubles présents et advenir et ont renoncé aux
ren(...) a ce contraires et de leurs vouloir et du
consentement ont estés condampnes? soussigne Lefel
Royal en présences de Coulaud Bouleibe laboureur
habitant dudit present vilage de la Martinie et de
4ème feuillet :
Francois Desmaisons aussy laboureur habitant du vilage
de Sirieys, Letout habitant la paroisse de Lagulhiac
qui nomé signé ny pour ne scavoir
de enquis par moy Reynaud Notaire Royal
En marge : contrôlé au tribunal - fol II n.b. à Saint-Astier - Ce 1er février 1698 - J Bonhomme Notaire Royal
Contenu de l’acte :
On retrouve les anciennes « tournures » du 17ème siècle et leurs orthographes approximatives, cependant on saisit le sens général du texte en français moderne.
L’acte est rédigé durant l’hiver 1698, au mois de janvier, période de faible activité agricole, à la métairie située au lieu-dit « Martinie » l’une des 5 métairies appartenant au Seigneur de Montauzon, à « Laguilhat ».
Quelques décennies plus tard, en 1740, une seule métairie, appartenant aux héritiers de Monsieur de Montauzon, entretenue par Jean Bouyer, est taillable à hauteur de 7,1 livres. Elle se compose de 12 journaux de terre, 2 journaux de vignes, 1 journal de bois, 1 journal de pré.
Les Dames de la Visitation et Jean Breton, propriétaires habitant Périgueux, possèdent les deux autres métairies de la Martinie, pour une taille respectivement de 14 et 10,10 livres.
Lors de la vente des biens des Dames de la Visitation, en 1789, la métairie de la Martinie est évaluée à 18 900 livres, pour un revenu de 450 livres.
Jean Labrue dit Chalard, laboureur, habite avec sa famille à Martinie.
Sicaire Meysensas, futur époux, est laboureur domicilié à Leypine.
Les futurs mariés convolent pour la première fois et sont légitimes et naturels. Le père de Sicaire, Marsoudou est décédé. Annette est sans emploi ou sa profession est tue comme souvent.
L’origine géographique des futurs époux :
Leypine se situe à 2 km 300 de Martinie. L’écrasante majorité des contrats dont nous disposons concernent des hommes et des femmes habitants la paroisse de Léguillac de l’Auche.
Le choix des conjoints :
Le premier critère est l’endogamie, les jeunes hommes et femmes fréquentent les mêmes lieux, fêtes locales, activités agricoles et artisanales, vie religieuse. C’est donc sur la paroisse que les jeunes gens se rencontrent.
Le deuxième critère, l’homogamie, permet aux jeunes et leurs familles de choisir leur conjoint dans un même milieu social. Le père de la mariée est laboureur, Sicaire le futur marié est aussi laboureur comme Martial dit Marsoudou, son père.
La dot ou « le prix de l’exclusion des terres »
Très longtemps la dot exclut presque totalement les filles de la succession et leur accorde un minimum forfaitaire. « le tout pour tous les droitz et pretantions que la dite future expouze pouvoit avoir et pretandre sur les biens de ses père et mère ».
En 1791 l’exclusion des enfants dotés disparait et les renonciations à l’héritage mentionnées dans les contrats de mariage sont supprimées en 1793 ; la coutume dotale perdure cependant jusque dans le courant du 19ème siècle et disparait peu à peu après 1850. Dans les années 1930, seules les filles de familles bourgeoises sont encore dotées.
Le paysan ne consent à la dot qu’avec ressentiment, il suffit de lire les proverbes traditionnels « le bon vient quand naît le garçon, le bien s’en va quand naît la fille ».
Ainsi la dot « machine à déshériter les femmes » laisse la part belle à l’ainé, héritier du domaine, car bien ancré dans la mentalité paysanne, la transmission de l’exploitation doit se faire sans morcellement.
En Périgord la dot est régie par le droit coutumier.
L’argent liquide est rare dans la société paysanne : « les dits Jassaillaht et Labrue, de bon gré et libérale volonté, conjointement et solidairement constitué la somme de 200 livres …. ».
La dot d’Annette est composée de sommes d’argent et de biens matériels :
1) Une somme de 200 livres dont 150 livres versée dans un an à compter du 26 janvier 1698 et 50 livres versées dans deux ans.
2) Une somme de 5 livres pour l’achat d’un châlit et 6 livres pour obtenir de la plume, versée le jour de la bénédiction nuptiale.
3) Un lit garni de plume.
4) Un coussin sans plume.
5) Un tour de lit frangé avec couverture de toile de « boyradis ». Le boyradis est un tissu de chanvre mêlant fils d’étoupes et fils de brins.
6) Une couverture de sarge grise, tissu fin peut-être de laine.
7) Deux plats en étain moyen.
8) Une assiette en étain moyen.
9) Six linceuls (draps) dont cinq en étoupe (tissu grossier fait de chanvre) et un en boyradis.
10) Deux nappes, une en boyradis et une en étoupe, chacune de deux aulnes (2m40).
11) Une douzaine de boyradis.
12) Un coffre ferré fermant à clef en bois de noyer pouvant contenir huit boisseaux de blé soit 240 litres, mesure de Périgueux. Le coffre apparait vers 1610 dans les dots.
Quelques éléments de la dot :
Les parents de Sicaire
Martial dit Marsoudou est laboureur décédé avant 1698, sa mère Guillonne Bibaud teste le 20 septembre 1709 chez le notaire Reynaud - voir ci-dessous.
Le mariage de Sicaire se déroule trois mois après la signature du contrat de mariage chez le notaire Reynaud. Référence du mariage - Archives de Périgueux (1681 - 1735) page 111/ 259.
Les témoins Jean Labrue dit Chalard, laboureur et père de la mariée, Pierre Dutard, Linard, Martial Linard, Marie Meysensas, Marie Chabanat, Blaise Pecou, époux de Mariotte, sœur de l’époux, François Lacroix, époux d’Anne, sœur de l’époux, ne savent signer.
La famille Janailhat est une famille de sergent royaux habitant la Martinie depuis quelques décennies. L’un des leurs, Jean, sera enseveli dans l’église paroissiale en 1625.
Sicaire se marie, le 14 avril 1698 avec Anne Labrue, fille de Jean Labrue dit Chalard et Sicarie Janailhat habitants le village de la Martinie, le curé Le Beau leur donne la bénédiction nuptiale.
Le couple met au monde 3 enfants :
Jean, né en 1706, il se marie le 25 septembre 1733 avec Thoinette Neyssensas, fille de Jacques Neyssensas, voiturier, et de Lucie Delubriac tous deux habitant Tamarelle.
Catherine, née en 1711, elle marie le 25 septembre 1733 avec Jacques Neyssensas de Tamarelle, frère de Thoinette.
François dit Francillou né en 1720. Il décède en 1765. Réf Mr Philippe Lagorce - Généanet
11 ans après son mariage, Sicaire, 33 ans, prend connaissance des dernières volontés de sa mère.
20 septembre 1709
Testament de Guilhoune Bibaud
Le testament du 20 septembre 1709 est reçu par le notaire Reynaud, notaire à Léguillac-de-l'Auche (AD Dordogne - 3E 5266 Acte 12) Il est établi sur un papier fiscal avec timbre fixe de la généralité de Bordeaux.
Le papier timbré est un papier tamponné d'un sceau soumis à paiement qui est ensuite utilisé pour enregistrer les actes authentiques, notariés, ou encore les registres paroissiaux regroupant les actes comprenant les baptêmes, mariages et sépultures.
Le timbre doit obligatoirement comporter un symbole royal (fleur de lys et couronne double en « L », en l’honneur des monarques) et une valeur faciale. La valeur faciale est fonction de la dimension des documents à l’intérieur de chaque catégorie d’actes, mais aussi de la matière première des actes (parchemin ou papier). Le papier utilisé, ici, est en parchemin. La taxe s’élève à 4 sols la feuille.
Repère historique
Le testament est enregistré quelques semaines après l’appel du roi Louis XIV, l’appel du 12 juin 1709 :
Le royaume, entre crises et conflits de 1700 à 1709, voit sa population s’effondrer de faim, de froid, d’autres mourir sur le front, les frontières du Royaume sont au bord de la rupture !!
Le roi tente un dernier coup politique en s’adressant directement à ses sujets en les consultant sur l’avenir du royaume. Son appel est lu dans chacune des paroisses, devant chaque église, et, alors que la paix semble inaccessible, malgré la disette, une foule immense de volontaires se mobilise…. La fin de la guerre n’interviendra cependant qu’en 1714.
Extrait de la traduction effectuée le 1er octobre 2022 par M. Françoise de PaléoFGW.
« Au nom du pere, du fils et du Sainct
Esprit, amen. Scachent tous quil apartiendra que
aujourdhuy vingtiesme du mois de septembre mille
sept cens neuf, au village de Leypine parroisse de
Laguliac de Lauche en Perigord, environ les deux
heures apres midy et maison de Guilhoune Bibaud
veufve de feu Marsoudou Meysensas dit de la Marcou,
pardevant moy notaire royal soubzsigné et presents les temoins
bas nommés, a esté presente ladite Guilhoune Bibaud
veufve dudit feu Marsoudou Meysensas habitante dudit
present village de Leypine, susdite parroisse de Laguliac.
Laquelle estant au lit, couchée, mal dispozée de sa
personne. »
Afin d’en rendre la lecture la plus aisée possible, l’acte est transcrit en français moderne avec sa ponctuation.
« Au nom du père et du fils et du Saint-Esprit, amen.
Sachent tous qu’il appartiendra qu’aujourd’hui, vingtième du mois de septembre 1709, au village de Leypine, paroisse de Laguliac de Lauche, en Périgord, environ les deux heures après midi, Guilhoune Bibaud, veuve de feu Marsoudou Meysensas, dite de « la Marcou » (sa mère se nommait Marguerite dite « la Marcou »), laquelle est au lit couché mal disposée de sa personne. Toutefois, par la grâce de dieu, étant en ses bons sens, mémoire et entendement et considérant qu’il n’y a rien en ce monde si certain que la mort ni rien de plus incertain que l’heure d’icelle et ne voulant décéder ab in testât, (sans avoir testé) a fait et ordonné son dernier et perpétuité testament nuncupatif * extrême et dernière volonté en la forme et manière qui s’en suit.
Premièrement a fait le signe de la Sainte Croix sur elle disant « In nomine patris et filii, et spiritus sancti, amen ».
Et a recommandé son corps et âme à Dieu le créateur et à la benoite Vierge Marie et à tous les Saints et Saintes du paradis. Les priant d’intercéder pour elle auprès de Notre Seigneur Jésus-Christ, ladite Bibaud testatrice, que lorsqu’il aura plu à Dieu séparer l’âme de son corps, son corps être porté et ensevelit au cimetière de l’église paroissiale du bourg de Laguliac de Lauche dans les tombeaux de ses feux prédécesseurs trépassés et qu’il soit appelé à son enterrement et sépulture, deux prêtres, pour prier Dieu pour la sauvegarde de son âme, payables par ses héritiers bas nommés.
Item déclare avoir été mariée ladite testatrice avec ledit feu Marsoudou Meysensas. Et duquel mariage il en est provenu plusieurs enfants et filles et être présentement en nature seulement, Sicaire Meysensas, son fils, et dudit feu Marsoudou, et avoir marié feue Mariote Meysensas son ainée, avec Blaise Pecou menuisier, et feue Anne Meysensas sa seconde fille, avec François Lacroix.
Lesquelles feues Mariotte et Anne Meysensas auraient laissé à elles, survivants, plusieurs enfants ou filles, icelles les représentant et avoir donné en paiement au dit Blaise Pecou en déduction des meubles dus à ladite Mariotte sa femme, les meubles et effets qui s’ensuivent.
Premièrement : le bois pour faire un coffre, une couette neuve, une barrique et un barricou, onze serviettes de brin, plus sept aulnes de brin et un linceul aussi de brin et un autre linceul aussi d’estoupes. Ledit linceul de brin neuf et celui d’estoupes mi usé, plus cinq livres de laine, savoir trois livres filx et deux en rame, plus un plat et une chopine d’étain, plus cinq pintes d’huile, plus un xxx presque neuf tenant dix pintes ou environ, plus un chaxxxx de xxxx.
Et avoir donné au dit Lacroix, aussi, en paiement en même déduction : deux plats d’étain moyens, plus deux serviettes d’estoupes primes, plus un linceul d’estoupes grosses. Et déclare aussi la dite Bibaud, testatrice susdite, quelle est débitrice envers Marion Bibaud sa cousine et envers Léonard Boutier, belle sœur et beau-frère, habitants du Mayne, de cette paroisse, de la somme de vingt-quatre livres qu’ils lui ont prêtée il y a huit ou neuf ans.
Plus déclare avoir aussi emprunté il y a deux ans passés du nommé Léonard Veyssière dit de Leyliane demeurant lors au moulin de Razac, la quantité de cinq boisseaux de mesture (méteil), a raison de trente sols le boisseau, montant sept livres dix sols. (Plusieurs générations de Veyssiere, meuniers se succèdent au moulin de Razac entre 1670 et 1793)
Lesquelles susdites de vingt-quatre livres d’un côté et sept livres d’autre, ladite testatrice veut et entend être payée aux susnommés et aux leurs, incontinent après son décès, sur ses biens, par ses héritiers bas nommés.
Item, donne et lègue la dite Bibaud, testatrice susdite, au dit Sicaire Meysensas son dit fils :
La somme de cinquante livres qu’elle s’était réservée sur ses biens, par les contrats de mariages de ses dites filles, ensemble les autres droits et prétentions a elle obtenus par le décès de feu autre Mariotte Meysensas, sa fille la plus jeune, qui n’avait pas été mariée, comme aussi les fruits et revenus de ses biens, la présente année.
Voulant et entendant ladite testatrice que ledit Sicaire Meysensas, son dit fils, ait à jouir et disposer, après le décès de ladite testatrice, comme de son bien et chose propre, sans que ses autres héritiers n’y puissent rien avoir n’y prétendre.
Et au résidu de tous et chacun ses autres biens, tant meubles qu’immeubles présent et à venir, la dite Bibaud, testatrice sus dite, a fait, créé, institué et de sa propre bouche nommé ses héritiers universels, savoir, le dit Sicaire Meysensas, son dit fils, pour un tiers, outre et par-dessus le sus dit légat, les enfants et filles de la dite feue Mariote Meysensas mariée avec le dit Blaise Pecou pour un autre tiers, et les enfants et filles de la dite feue Anne Meysensas mariée avec le dit François Lacroix, pour un autre tiers.
Par lesquels veut et entend ses dettes et dégâts être payés et accomplis. Et avec ce, la dite Bibaud, testatrice sus dite, a dit et déclaré :
Le présent testament être son dernier et perpétuel testament nuncupatif, extrême et dernière volonté, en la forme sus dite et a cassé, révoqué et annulé tous autres testaments, codicilles ou donations qu’elle pourrait avoir si devant fait.
Voulant et entendant que le présent testament soit le sien dernier et qu’il soit de son plein et entier effet, suivant sa forme et teneur, et qu’il vaille par forme de testament, codicille ou donation, ou autrement en la meilleure forme que de droit pourra.
Et a requis à moi dit, notaire, lui vouloir rédiger son présent testament par écrit, que lui ait concédé, sous le sel royal, en présence de Jean Lavignac, marchand habitant de la ville de Saint-Astier, Jean Pecou dit Landrieu, Jean Rapnouilh dit Vieux, Etienne Chabannas et Guillaume Garrau, laboureurs, tous habitants de bourg du dit Laguliac de Lauche, témoins connus.
Le dit Lavignac a signé et non la dite Bibaud, testatrice sus dite, ni les dits Pecou, Rapnouilh, Chabannas et Garrau, autres témoins sus dits, pour ne savoir, de ces interpellés par moi.
Plus un coffre de bois de noyer fait en menuiserie, de la contenance d’une charge de bled ou environ, neuf, sans être ferré.
Signatures : Lavignac présent, Reynaud notaire royal.
* Nuncupatif : testament solennel réalisé in extremis, à « l’oral et de vive voix », par simple déclaration de nature testamentaire, devant témoins, avant d'être établi par écrit, plus tard, après le décès.
Un conflit
Le 15 mai 1713, oppose Sicaire dit « garçon », 37 ans, à Messire Pierre d'Abzac de la Douze, seigneur prieur commendataire du prieuré de La Faye depuis sans doute 1685, litige portant sur un bornage de terres - réf B1064. Il s’agit de la première mention du surnom de Sicaire, « garçon ». Hélas la conclusion du litige n’est pas parvenue jusqu’à nous.
Un prieur habitué des procédures :
1692. - Procédures criminelles à la requête de parties civiles. – « Messire Pierre d'Abzac abbé de La douze et prieur commendataire du prieuré de Lafaye, situé dans la paroisse de Léguilhac-de-Lauche et y habitant, se plaint de ce que depuis quelques mois les habitants des villages du Chalard, de la Chabanne et de Chignac, sis dans les paroisses de Mensignac et de Beaulieu, qui sont voisins de la forêt de Lafaye, vont y commettre des dégâts considérables, y coupent beaucoup d'arbres par le pied, chênes et châtaigniers, en ébranchent d'autres, emportent beaucoup « de bois de brasse » et des fagots de chêne. Le plaignant veut avoir réparation d'un si grand préjudice ».
En 1742, « Guillaume Saunier, prêtre, vicaire perpétuel de la paroisse de Léguillac-de-Lauche, et en conflit pour les dimes novales avec Pierre d'Abzac de Ladouze, seigneur prieur de La Faye, et gros décimateur de ladite paroisse de Léguillac ».
1744-1750. - Sentences civiles et criminelles condamnant : « Jeantou Pontard et Jacques Lamy à payer solidairement à messire Pierre d'Abzac de Ladouze, seigneur abbé, prieur commendataire du prieuré de Lafaye, les arrérages de la rente due sur le tènement appelé du Puy du Tirat, en la paroisse de Mensignac ».
Les actes notariés, décrits ci-dessous, vont permettre de découvrir l’origine sociale de Sicaire Meysensas, et par quels moyens Sicaire tirait parti de son travail, par extension, d’imaginer pour une époque donnée, dans quel type de bâti vernaculaire Sicaire et les membres de sa famille vécurent.
Repère historique
En 1730, le deuxième acte notarié concernant Sicaire est enregistré huit années après le sacre de Louis XV, dit « le Bien-Aimé », arrière-petit-fils de Louis XIV. Il lui succède à l’âge de 5 ans sous la régence de Philippe d'Orléans, neveu du roi défunt, et ce, jusqu'en 1723.
Louis XV est sacré à Reims le 25 octobre 1722 et demeurera roi jusqu’en 1774.
Le troisième acte notarié, en 1748, est enregistré en pleine période de disette.
Remerciements à Messieurs B. Bardon et P. Lagorce qui m’ont communiqué ces deux actes.
1730 - Afferme ou bail de ferme
Entre Sicaire Meysensas dit « Garçon », 54 ans, et François Lacroix
Traduction effectuée en mai 2022 par Monsieur Sandy M. Françoise membre de France Gen Web, Paléo FGW, référencé aux Archives du Périgord, 3e14274 - 581.
Définition de l’affermage
L'affermage est un contrat par lequel les propriétaires, François Lacroix et fils, bailleurs d'un bien sis au Tabac, paroisse de Léguillac de l’Auche, en confient l'exploitation à un fermier, Sicaire Meysensas, 54 ans. Sicaire tire sa rémunération du produit de la ferme et verse à François Lacroix, un fermage d’un montant de vingt une livre annuellement pendant huit années. Le loyer est ferme et indépendant du résultat d'exploitation ; l'affermage représente donc un bail plus risqué que le métayage.
D’autre part, François Lacroix confie à Sicaire le soin de régulariser ses dettes directement à ses créanciers, Pierre Laronze dit Guarramond du village de la Martinie et Jean Serre dit Barbazar, laboureur à bras et journalier habitant Montanceix.
Les Lacroix ont déjà confié en 1729 une autre partie de leurs biens, maison, grange, ayzine, jardin, dépendances, terres et vignes dans le bourg, en affermage pour une durée de 5 années à Pierre Soullier et autre Jean Meysensas, laboureurs, habitants du bourg de Léguillac de l’Auche.On note que le fermier Soullier appose sa signature au bas de l’acte.
Les protagonistes
Sicaire Meysensas dit « Garçon ».
Jean Meysensas, dit « de Marot », ou « Jeandillou », fils de Marot Meysensas, tisserand aux Tabacs, décédé en 1684 - voir acte dans rubrique « les plus anciens actes notariés : 1684 à 1703 ».
Marot « teste environ les dix heures du matin en sa maison, lequel est couché, mal disposé ».
En 1696, le notaire se déplace en la maison d’un autre Jean Meysensas, pour y rédiger un contrat de mariage, « au lieu-dit les Tabas près du bourg » - réf Françoise Raluy.
A la même époque on rencontre un autre Marot Meysensas, laboureur, né à Annesse, habitant des Mailloques, marié le 12 février 1675 à Saint-Léon sur l’Isle avec Sicaire Boisset, habitante de Puypinsou à Saint-Léon sur l’Isle. Le couple, de confession protestante habite Léguillac de l’Auche lors de la naissance d’un de leur enfant, Pierre, en mars 1692 : parrain et marraine, Pierre Micard, bourgeois de Périgueux et Monde Rondet, damoiselle.
François Lacroix, tailleur, originaire d’Annesse, se marie avec Anne Meysensas le 25 février 1686 à Léguillac de l’Auche. Anne est sœur de Sicaire, et autres frères et sœurs, Martial, Marcou, Marie et Mariotte Meysensas (née le 17 mars 1669).
François Lacroix, en 1730, habite Montanceix. Le 10 décembre 1703, lors d’une vendition entre Gilhou Neysensas dit Valet et Pierre Simon, est témoin, François Lacroix, tailleur d’habit, habitant le lieu des Tabacs qui ne sait signer.
Pierre Laronze se marie le 10 janvier 1684 avec Catherine Labrue, fille de Jean Labrue dit Guarramond et Sicarie Janailhat du village de la Martinie, beau-frère de Sicaire dit « garçon «.
Jean Serre, dit Barbazar, laboureur à bras et journalier, habite la paroisse de Montanceix. Jean se marie avec Marguerite Lacroix, Montremoise comme Jean, le 17 octobre 1729. Marguerite est fille de François Lacroix et Anne Meysensas. Jean Serre est mari de la nièce de Sicaire dit « garçon «.
Geoffroy Petit, sieur de Lagrange, né le 21 mai 1675 à Montrem. Geoffroy Petit se marie le 10 janvier 1708 avec Jeanne Lacueille. Le couple donnera naissance à 5 enfants. Le notaire Petit décède à l’âge de 82 ans, le 13 octobre 1757 en présence de Sicaire Meysensas, autre Sicaire, marguillier de Montrem.
Hélie Petit, sieur de Lagrange, praticien et témoin, frère de Geoffroy. Il est époux de Françoise Garreau et habite Montrem. Hélie décède en 1775 dans le village.
Jean De Puyjeanne, est laboureur, praticien, témoin, habitant du lieu du Fleix à Montrem, marié à Saint-Léon sur l’Isle avec Marie Labrue.
Traduction
La traduction conserve l’écriture du milieu du 18ème siècle.
« Ce jourd huy vingt sixiesme aoust mille sept cents trante après midy, au lieu de Montanceix juridiction dudit lieu, paroisse de Montrem en Perigord, et dans la maison du notaire royal soubzsigné, pardevant icelluy, presents les tesmoins sy après nommés, ont estés présents François et auttre François Lacroix, père et fils tailleur d’habitz.
Le dit François le jeune fils bien et dhuement authorizé dudit auttre Francois Lacroix son père pour la vallidité des présentes - habitants dudit present lieu,
Lesquelz de leur liberalle vollonté ont conjointement baillé a titre de ferme, pour le temps espace de huit années et huit cuilletés concecutifves quy coumanseront par la recolte prochaine de lannée mille sept cents trente un et les sept suyvantes, a Sycary Meysensas, dit Guarsson, laboureur a bras, habitant du dit lieu de Leypine, paroisse de Laguillac de l'Auche, present et acceptant.
Scavoir est tous les biens quy peuvent compter et apartenir ausdits Lacroix pere et filz dans le lieu appelé du Tabat et en la dite parroisse de Laguillac, ainssin quilz sont exploités par Jean Meysensas dit de Marot, en callité de fermiers desdits Lacroix.
Lesquelz biens, le dit Meysensas dit Guarson a dit le tout très bien savoir, concistant en une petite maison basse et une petite grange, bastimentz, aire, jardin, terres et auttres heritages, lesdits bastiment assez bien couver.
Cependent ayant a dire dun cotte environ un cent de tailles, les terres estant en ratoubles ou sebmées de gros bled despaigne, dans lesquelz biens ny ayant aucunes sebmances.
Laditte afferme a esté faite pour une chascune dicelles huit années, moyenent le prix et somme de vingt une livres.
Et pour le payement du prix desdits huit années quy revient a la somme de cent soixante huit livres, lesdits Lacroix pere et filz ont indiqué et chargé le dit Meysensas dit Guarson de icelle bailler et payer a leur aquis et descharge a leur creantier, savoir : a Pierre Laronze dit Guarramond, laboureur habitant du lieu et mesterie apellée de Sirieix*, parroisse susdite de Laguillac, lequel est issy present.
Auquel cest trouvé luy estre dheu par les dits Lacroix la somme de cent trante livres, savoir : en capital celle de cent dix livres ainssin quil est porté au contrat de transaction portant obliguation de la dite somme de cent dix livres en faveur dudit Laronze, consantie pour lesdits Lacroix, en dacte du neufiesme aoust mille sept cents vingt-sept, signée Reynaud notaire royal, raporté duement controllé suyvant lordonnance : seize livres dix solz pour les interez de trois ans ; et trois livres dix solz pour les fraiz dune sommation faite au requis dudit Laronze auxdits Lacroix en dacte du dix neuf du present mois daoust, signé Dupuy sergent royal, raporté, controllé suyvant lordonnance.
Revenent lesdites sommes a la susdite de cent trante livres. De laquelle somme, le dit Laronze declare ce comptanter tant pour linteret que capitail pourveu que le payement dicelluy luy soit fait pendent lesdites huit années.
Laquelle somme le dit Guarsson promest de icelle bailler et payerer au dit Laronze onc aux siens annuellement sur le prix desdits revenus de la dite presante afferme, pourveu que lon luy lesse la libre pocession et jouissance desdits revenus penden lesdites huit années sans luy causer de troubles.
Et soblige moyenant la libre pocession den raporter quittance de la dite somme de cents trente livres dudit Laronze.
Lequel a renoncé a tous interés dicelle, pourveu quil aye son payement dans le dit dellay de huit années.
Et a deffaud de payemant ce reserve de reprandre la poursuite et ses priorités et privilleges dhipoteque sur les biens desdits Lacroix.
Et lors du final payement, remettrat coppie dudit contrat portant obliguation de la dite somme de cent dix livres contre lesdits Lacroix et auttres actes a ce subjet.
Comme aussy lesdits Lacroix ont aussy pareillement chargé et indiqué au dit Meysensas dit Guarson a payer à leur aquis et descharge a Jean Serre dit Barbazar et Marguerite Lacroix conjointz, gendre et fille dudit Lacroix, par le dit Serre yssy présent et habitant dudit present lieu.
Lequel declare accepter la dite deleguation ques de la somme de trante livres. Laquelle somme le dit Guarson promest et soblige d icelle bailler et payer ausdits Serre et Lacroix conjointz, dans le jour et faite de Notre Dame de septanbre prochain venant, a paine de tous despans, dommages, interès, provenent icelle a cause et pour raison de partie et en desduction des droitz dotaux de la dite Marguerite Lacroix.
De laquelle le dit Guarson en raporterat quittans ausdits Lacroix.
Et pour le restans du prix entier desdits revenus affermés et desdites huit années quest la somme de huit livres, lesdits Lacroix en ont fait grais gratuitement, quitté le dit Guarson a raison desdits charges quil cest chargé de les acquitter desdits payements.
Moyenent quoy lesdits Lacroix pere et filz seront tenus comme sobligent solliderement et conjointement lun pour lauttre et du seul pour le tout et ont renoncé au benefice dordre, division et discution de personnes et biens, de faire jouir paisiblement le dit Guarson et luy faire cesser tous troubles generallement quelconques pendens lesdites huit années.
Et serat tenu le dit Guarsson de payer tailles et ranthes quy seront dhues sur lesdits biens penden lesdites huit années.
Et en cas quil arrive des cas fortuis sur quelque année en dommage, lesdits Lacroix seront tenus de ayder au dit Guarson du dommage dicelle année, a dire despert que les parties conviendront
Et en temps que de droit, lesserat le dit Guarson lesdits biens au mesme estat quilz sont a present, ny ayant aucune paille serrée dans lesdits biens, ayant dans la grange trante deux tables de chaitaigniers et auttres bois de peu de valleur, la maison plaine de tables jointes, ferment tant la dite maison que grange a clef ; gouvernerat lesdits biens en bon paire de famille sans y causer de despopullation ny de deterrioration, pourrat prendre des curages pour service, sans quil puisse couper ny ecrisser aucun arbre sans la permission desdits Lacroix.
Le tout a esté ainssin stipullé et acepté par lesdits parties quy ont promis le tout tenir et entretenir et ne venir au contraire, aux susdites peynes, qua lentretenement ilz ont respectivement obligé et hipotequé tous et checuns leurs biens presents et advenir et ont renoncé a toutes exeptions a ses presantes contraires, a quoy faire et de leurs voulloirs et consantement ont estés jugés et condanpnés soubs le seel royal.
Fait et presances de Hélie Petit et Jean Depuisane, praticien, habitantz dudit present lieu, temoins cognus quy ont signé et non lesdites parties pour ne savoir, de ce enquis par moy ».
Signatures En marge
Bail de ferme pour 8 années et pour ... ... 21 lt.
Fait par Francois et autre François Lacroix a Sycary Meysensas dit Guarson du 27 aoust 1730.
Ratouble : le ratouble est le long chaume laissé sur pied pendant quelque temps après la récolte jusqu’à ce que les herbes sauvages aient pris une assez grande croissance ; il est fauché ensuite près de la terre avec ses herbes et rentré pour servir de fourrage d’hiver. Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et domestique - 1827
Cuilleté : cueillette
La métairie de Sirieix appartient à Dominique de Montozon et se compose de deux paires de bœufs ; on sème froment et autres menus grains, le tout estimé à 16000 livres en 1737.
Les biens des Lacroix aux Tabacs se situent à 115 mètres de la fontaine aux Anes et 140 mètres de l’église située au-dessus.
Les temps changent …. 22 ans après, une autre partie de la famille Lacroix est miséreuse, « le 11 juin 1752, les frères Pierre et Jean Lacroix et leur père François déclarent qu’étant métayers du sieur Bretou au lieu de Martinie n’ayant rien pour vivre qu’ils auront eu recours à Maître François Pontard…. Pour le paiement de laquelle somme…… ils vendent une pièce de terre au lieu de Tabac ».
Quelques années, plus tard, la situation des Lacroix ne s’est pas améliorée, le 14 avril 1778, l’épouse de Pierre Lacroix de Sireix, Anne Linard, « supplie humblement le juge ordinaire de Léguillac de l’Auche, de par sa triste situation, son marie et ses quatre enfants, se trouvent à presque mendier leur pain faute de grain, n’ayant rien pour vivre… ».
1748 - la dévolution légale, ou succession « ab intestat » de
Sicaire Meysensas dit « garçon », 72 ans
Acte 42 du 2 juin 1748 reçu Geoffroy PETIT, notaire à Montanceix - AD Dordogne 3E 14 277, transmis par Monsieur Ph Lagorce le 23 mai 2022.
Sicaire Meysensas n’ayant pas préparé sa succession, son patrimoine est dévolu selon les règles légales, la succession est dite alors ab intestat.
Sicaire est-il décédé victime de la disette de 1748 ? Les appels à l’aide venus du Périgord incitent l’intendant à distribuer du riz à la population entre 1747 et 1748, mais les paysans vont refuser de consommer une nourriture qu’ils ne connaissent pas.
L’intendant de Guyenne Tourny note : en 1747, les paysans périgourdins ne sont que des « squelettes ambulants » trouvant leur nourriture « dans le son et les herbes ».
Le marquis d'Argenson écrit : « les hommes meurent dru comme mouche de pauvreté et en broutant l’herbe ».
Les biens de Sicaire vont être transmis aux personnes désignées par la loi dans les proportions fixées par la loi. Il s’agit des enfants des défunts Sicaire et Marie Labrue,
François dit Francillou,
Thoinette veuve de Jean,
Et Catherine Meysensas.
L’acte est passé au lieu de Leypine à Léguillac de l’Auche.
« Cejourd’huy segond Juin mil sept cents quarante-huit après midy au lieu apellé de Leypine, paroisse de Laguillac de lauche en Périgord ci au-devant de la maison des hoirs de Sicaire Meysensas dit « garçon », en présence de François Meysensas dit Francillou, laboureur, habitant du lieu apellé de Longe-Cotte, paroisse de Saint-Astier d’une part, et Thoinette Meysensas, veuve de Jean Meysensas, habitante de la dite présente maison, laquelle agissant en son nom propre que en callité de mère charitable de ses enfens du dit feu Jean Meysensas sans adopter aucune callité de tutrice, et Catherine Meysensas ».
Les feux Sicaire Meysensas « ab intestat » et Marie Labrue, conjoints étant décédés les biens sont partagés en portions égales entre feu Jean Meysensas, ledit François Meysensas dit Francillou, et Catherine Meysensas.
Le premier lot prendra la chambre ou l’on fait le feu qui est du cotté du couchant.
La chambre appentis y joignant dans laquelle on ferme les bestiaux, au lieu de Leypine où la porte de communication de la chambre y joignant demeure au second lot, sera fermée et murée à frais communs. Le mur qui les sépare demeurera en commun.
Ensemble prendra le jardin qui est devant la maison et joignant au grand chemin,
Plus toute la terre appelée du Claud sous le chemin d’Annesse à Laguillac, contenant 25 escats, confrontant la terre du Sieur Bazinette, plus toute la terre au-dessus dudit chemin appelée du Gros Claud contenant 60 escats confrontant au dit chemin au dit Bazinette et de la Meize,
Plus toute la terre appelée du Chenebal située au-dessus de ladite maison, contenant 78 escats confrontant au Grand Chemin et au chemin de ferré du lieu des Biarneix a Laguillac, et les hoirs Teyssier,
Plus le crochet de terre plus bas appelée de Briasse, contenant 50 escats joignant au terrier de Biarney, plus la longère de terre demeurée au second lot,
Plus toute la vigne par entier appelée Darjasou, contenant 65 escats, confrontant aux hoirs de …
Plus toute la Jarrissade située sur la maison et joignant ledit chemin des Biarney contenant 114 escats, confrontant à François Lacroix et au dit chemin du Biarney,
Plus tout le bois Châtaignier appelé des Tabats situé sur le village des Tabats contenant 14 escats, confrontant au dit Pontard et à La Meize.
Le dit présent lot est demeure au dit François Meysensas dit Francillou.
Les autres deux lots second et troisième prendront la grande chambre au fond, aizine qui est au -devant du côté du midy,
Toute la chènevière qui est au-dessus de la dite maison, plus la moitié de la chambre appelée la Veyssière située au dit lieu de Leypine joignant la dite chènevière et l’autre moitié de la chambre appartenant au nommé Petit de Veyssière, plus toute la terre appelée le Crochet qui est au-devant de la maison contenant y compris le dit Crochet, 137 escats, confrontant au dit de La Meyze aux hoirs de Chandillou au dit grand chemin,
Plus prendra toute la terre appelée de Las Petitas située au-delà du pred de la Chabane confrontant au chemin d’Annesse à Mensignac contenant 18 escats,
Plus toute la terre à vigne situé au-dessus de la maison et jardin joignant et par-dessus le dit Grand Chemin contenant 139 escats, confrontant à Anthoine Teyssier et François Lacroix et le chemin des Biarney,
Plus le restant des Crochets de terre appelée de la Briasse contenant 60 escats confrontant au chemin des Biarney joignant au dit Pontard, les hoirs du dit Chandillou plus toute la vigne appelée de la Briasse contenant 68 escats.
Plus toute la Jarrissade et le Chanfroy appelés du Biarney confrontant au domaine des Biarney contenant 45 escats,
Plus tout le bois et vigne part entière appelé au Claud de Marlouty contenant 150 escats,
Plus tout le bois châtaignier et chanfroy appelé au Puy de Faye contenant 57 escats et qui fait crochet, confrontant à Léonard Salesse,
Plus toute la terre par entier appelée de Chez le Chat contenant 153 escats confrontant au grand chemin a l’enclaud de la nommée La Chatte,
Plus toute la vigne appelée au Chagniounet contenant 24 escats confrontant au dit Sieur Ghoumondie,
Plus toute la vigne appelée à la Bautissoune contenant 59 escats confrontant à Reymond Delaguillade gendre du vieux,
Plus tout le bois et la vigne appelé à la Gravas ou il y a des arbres châtaigniers contenant 19 escats confrontant au Sieur Cluzeau,
Plus bois châtaigniers au dit lieu de chez Marlouty contenant 146 escats confrontant au nommé Chapt, plus tout le bois du Puy de Faye joignant La Plante du Sieur Bazinette contenant 30 escats, lesquels biens composant le dit second lot et troisième lot qui demeure à la dite Thoinette Meychenchas tant pour ses droits comme étant comme dit au lieu droit et place de la dite Catherine Meysensas qui comportent la moitié et le restant composant l’autre moitié appartenant à ses enfants dudit feu Jean Meysensas laquelle la dite Thoinette et ses enfants demeurent constante lesquels biens les parties peuvent prendre possession et des biens et dépendances et toutes jouissances à la manière comme bon leurs semblera et ont déclaré avoir partagé les meubles. Le dit François a déclaré avoir retiré son tier et la dite Thoinette deux tiers.
Les titres et papiers de la maison ont demeuré entre les mains de la dite Thoinette et attestant des rentes dues au seigneur de Puyferrat.
De son feu frère Jean qu’il a gagné dans la « maison de Monsieur l’abbé de La Faye » certains gages et qui lui sont encore dus par le dit Seigneur Abbé lesquels gages la dite Thoinette prétendait que le dit Francillou rapporterait dans la communauté dequoy l’acte nommé que le dit Francillou luy la demeurera le tiers pour en disposer à sa volonté, et les autres deux tiers seront du seigneur abbé de La Faye.
« En présence de Jean Legrand, praticien, habitant du lieu de Lalande paroisse d’Annesse, de Pierre Gadaud aussi praticien, habitant du lieu de Montanceix paroisse de Montrem, témoins qui ont signé et non les parties pour ne scavoir de ce enquis par Moy Petit, notaire Royal ».
Jean Legrand est praticien à Annesse, époux de Françoise Bardon.
Pierre Gadaud, praticien à Coursac, épouse Marie Petit à Montanceix en 1748.
Agriculture, alimentation et charges au temps de Sicaire
Agriculture et alimentation
En 1901 un état des classes rurales au 18ème siècle dans la généralité de Bordeaux note « ce qui domine de beaucoup dans le nombre de propriétés ce sont les parcelles de moins de moins de 20 ares ».
Terres, vignes, jarrissades et châtaigniers appartenant à Sicaire
L’alimentation de Sicaire est en partie une alimentation de cueillette. Avec trois parcelles de 3863 m2 de châtaigniers, dont une de plus de 20 ares, Sicaire ne devrait pas craindre la disette, d’ailleurs il taille régulièrement ses arbres et codres. Après la cueillette d’automne, le séchage à la fumée, et après les avoir jetées dans le chaudron avec un peu d’eau et de sel, Sicaire et sa petite famille vont pouvoir consommer les châtaignes une partie de l’hiver. L’été, se sera le bled d’Espagne.
« La disette ou l'abondance des châtaignes est le thermomètre du prix des grains en Périgord ». Latapie dans son journal lors de sa seconde tournée générale en 1782. La châtaigne, principal aliment, est aussi destinée à la nourriture des bestiaux et des volailles.
Huit parcelles composent les 9808 m2 de terres consacrées à la culture des raves, des haricots ou fèves pour la soupe. Deux seulement dépassent les 20 ares. Les autres parcelles ne dépassent pas, en moyenne, les 10 ares.
Lorsque Sicaire fait la croix sur le pain à l’aide de son couteau, il ne s’agit pas du pain comme on l’entend aujourd’hui, mais de pain noir de maïs, (la frottée de pain) et encore sa consommation demeure extrêmement rare, seulement les jours de fêtes. Peut-être Sicaire mange-t-il un peu de cochon sous forme de salé ou de lard, peut-être braconne-t-il un peu à l’occasion. Enfin la famille Meysensas apprécie les fruits de l’été et d’automne, les prunes, cerises, pommes, et ne les vend en aucun cas. On notera l’importance de la consommation d’huile de noix quant aux produits laitiers, ils sont inexistants.
La vigne cultivée par Sicaire représente une surface de 9327 m2, à peine un hectare, soit presque l’équivalent de la surface en terre. Sur les 6 parcelles de vignes, seules deux dépassent les vingt ares, elles doivent suffire exactement à la consommation de la famille Meysensas ; la consommation annuelle de vin, avant la Révolution, s’élève à une centaine de litre par habitant.
Sous l’Ancien régime, un hectare ne donne pas une barrique, la production se situe en dessous de 220 litres pour un revenu d’environ 400 livres l’hectare. Les propriétaires, vers Brantôme, possédant de grandes surfaces peuvent espérer vendre leur production, de qualité supérieure, à destination du Limousin.
Enfin Sicaire exploite 28 ares de jarrissade. Les jarrissades sont des taillis de chênes, le chêne est principalement utilisé, avec sa production de glands, à l’alimentation des animaux domestiques et la fabrication de charpente.
Charges
La taille personnelle en 1740 à Léguillac de l’Auche
De l’ensemble des impôts la taille (personnelle ou réelle) est l’impôt rural le plus lourd et le plus impopulaire. La taille personnelle s’élève entre 2 et 4 sols par livre de revenu net, soit le dixième à Périgueux.
Lorsque le bien est affermé à prix d’argent, le montant de la taille est divisé en deux parts égales, l’une incombant au propriétaire, la taille de propriété, l’autre au fermier, nommée taille d’exploitation.
La taille reste le symbole de l’arbitraire de sa répartition et l’abus des privilèges, en effet dans le détail des collectes, les règles d’équités ne sont en général pas respectées. Les collecteurs sont partiaux, ménagent leurs amis. L’intimidation, la corruption, le mensonge, la fraude, et la falsification des rôles sont effectifs par les taillables riches et influents.
L’intendant Tourny écrit en 1744 « la plupart des collecteurs de l’élection de Périgueux sont des gens grossiers et illettrés que ne sachant pas eux-mêmes former leurs rôles s’adressent à des écrivains de campagne qui savent à peine former les lettres, ignorent les règlements…… ».
Voir article « Les Neyssensas en 1740 - taillables du Tiers-Etat »
Jean, fils du « garçon », est parmi les plus pauvres des habitants de Léguillac de l’Auche, et, est 5 fois moins imposés que la moyenne des laboureurs à bras.
Sicaire comme les autres Léguillacois, une fois les redevances envers l’Etat acquittées, et on sait quelles se succèdent sans relâche, est encore redevable de la dîme au gros décimateur de la paroisse qui est aussi seigneur de Léguillac. Sicaire se serait résigné au montant de la dîme si le curé de la paroisse de Léguillac avait perçu une « portion congrue » à la hauteur du service spirituel rendu, c’était loin d’être le cas avec le gros décimateur Pierre d’Abzac de la Douze.
Depuis une loi de 1690, le vicaire perpétuel perçoit une portion congrue d’un minimum de 300 livres tournois auxquels se rajoutent un montant en lien avec les dîmes novales.
Voir le « conflit entre le curé Saulnier et le seigneur d’Abzac de la Douze en 1742 pour une nouvelle répartition des dîmes novales et portion congrue ». Au sujet des dimes novales, ou dimes mobiles, qui attribuent au curé une dîme sur toutes les terres nouvellement cultivées depuis au moins 40 ans, le syndic de Périgueux dit : « Les paroissiens, toujours portés pour leur curé, attestent, contre la vérité, la majeure partie de la paroisse être novale », d’où la difficulté pour le gros décimateur de démontrer les limites exactes de ces novales.
En Guyenne, la propriété ecclésiastique est en général peu importante, la dîme est au contraire beaucoup plus élevée que dans le reste du royaume. Le taux en Périgord, le Bordelais, le Sarladais est estimé au 11ème, 12ème souvent au 13ème. Voir article « la dîme payée par Philibert, Pierre, Bernard Meysensas en 1641 ».
Dîme écrasante surtout lorsqu’elle se prélève non seulement sur les grains d’hiver, blé, seigle, sur le vin, les fruits, mais aussi sur les menus grains, chanvre, lin, sur les fourrages, légumes, sur le bois et sur les bestiaux, au grès des villages. La plupart du temps, cependant, le taux variait selon les différentes récoltes, toujours plus élevé sur le blé et le vin. On le voit aisément, le montant de la dîme par village est d’une évaluation complexe, par exemple, à Eygurande où les seuls fruits décimables sont le blé et le vin.
En 1641, Pierre, Philibert et Bernard Meysensas sont redevables des fruits décimables en « picotins » sur le bled, le froment et l’avoine et la garaube. (Garaube : dans la plaine de Saint-Astier on sème de la jarosse ou garaube qu'on nomme gesse d'Espagne. C'est une très bonne espèce de prairie artificielle et très abondante - Lartigaud - Shap -1980). Le décimateur prélève aussi, au passage, quelques charretées de paille de froment provenant de l’aire de battage !
En 1741, Jeandillou Meysensas est exempté de dîme pour une vigne qu’il possède au Puy, peut-être est-ce dû à la mauvaise qualité de la production, en contrepartie il devra 2 jours de corvée pour le seigneur.
La dîme est prise soit sur place, en quantité de raisin prélevée, soit au pressoir, une partie du vin est alors prélevée par le prieur, lorsque la vendange se termine. Après que le ban des vendanges ait eu lieu, les paysans « doivent » deux jours de corvées au prieur, comme Jeandillou, ou bien payent 8 sols pour deux journées de corvées.
Quelques années plus tard, les Léguillacois Bernard et Jacques Meysensas, signataires des cahiers de doléances en 1789, se prononceront pour une taille réelle car ne pesant que sur la terre, et en cela, épargnant les métayers, les artisans et journaliers non propriétaires, si opprimés là où régnait la taille personnelle.
Quelques mesures anciennes en Périgord, pour le grain, la charge, le boisseau, la poignére, le picotin, pour les surfaces de terre labourable, la quartonnée, l’escat, la picotinée (l’escat à Mussidan correspond à 17,8 m2), pour les tissus, l’aune.
Les lieux de vie de Sicaire et Jean dit de Marot,
à Leypine, aux Tabacs, et le bâti vernaculaire
Les bâtiments situés à Leypine et aux Tabacs ne sont vraisemblablement pas ceux que Sicaire connu en 1748, mais ceux existant au tout début du 19ème siècle sur le plan cadastral Napoléonien en 1808. Ils furent édifiés avec un usage fréquent de remploi de matériau provenant de constructions du 18ème siècle.
L’habitation de Sicaire se distingue des quelques habitations du bourg, en pierre, appartenant à des personnes de rangs supérieurs.
Du temps de Sicaire, si la pierre de taille reste rare et ne concerne que les chaînes d’angle, les encadrements de baies et la niche d’évier, le bâti est en moellon de calcaire, les moellons étant liés entre eux par un mortier de terre crue ; quant aux murs ils ne dépassent pas les 70 centimètres. Les ouvertures sont rares. Le toit, en rapport avec le statut social, est couvert de chaume, type de couverture utilisé jusqu’au début du 19ème siècle. L’intérieur des plus simples, le sol en terre battue ou avec plancher, une seule cheminée pour le logis, peut-être un évier.En 1748, la maison basse de Sicaire, sise à Leypine, est composée de 4 pièces :
« La chambre ou l’on fait le feu qui est du cotté du couchant »,
« La chambre appentis y joignant dans laquelle on ferme les bestiaux »,
« La grande chambre au fond »,
« La chambre appelée la Veyssière et l’autre moitié de la chambre appartenant au nommé Petit de Veyssière » - le registre de la taille en 1740 indique un Sicaire Meysensas dit Laroze.
En 2022 la parcelle mesure 5830 m2 et l’on distingue deux corps principaux d’habitation.
Aux « Tabas »
Les Lacroix possédaient leur habitation aux Tabacs en 1703, propriété mise en affermage en 1730.
Sicaire dit « garçon » puis Jean dit de « Marot » seront fermiers des Lacroix aux Tabacs.
Plan cadastral en couleur transmis par
Madame Françoise Raluy en 2022
Autres Sicaire, aux
Tabacs
Sicaire est baptisé par le curé Parade le 5 février 1673, fils de Jehan Meysensas, tisserand, et Mariotte Soulhier. Sicaire des « Tabas » épouse en 1696 Marguerite Barrière de Saint-Germain de S - contrat du 23 février1696 3 E 5266.
Un autre Sicaire, dit Coutou, Coulou ou Boutou ou Boulou, habite les Tabacs en 1740, époux de Jeanne Dalesme - 1 E 81 1740.
Ses héritiers possèdent aux Tabacs, en 1771, une maison, un jardin, et des terres redevables de la rente foncière au prieur de la Faye - 11 J 79.
 |
| Rente foncière 11 J 79 1771 |
Dans le bourg, en 1740, d’autres
Sicaire sont redevables de l’impot le plus impopulaire, la taille, d’où
la difficulté de définir leur lieu d’habitation précis, les Tabacs, Mondy, ou
Leypine, qui ne sont pas désignés sur le relevé car trop proches du
bourg :
Ainsi l’on rencontre Sicaire, (il s’agit peut-être Sicaire dit « garçon »), bordier du Sieur Rey, procureur à Périgueux, Sicaire dit Laroze, qui possède deux petites maisons, bordier du Sieur de Fareyrou, Sicaire et Jean, laboureurs à bras pour Guillaume Rondet, rentier dans le bourg.
Sicaire dit « garçon », fut le plus jeune d’une fratrie de 7 enfants, dont 5 filles. Le premier garçon, Martial naquit en 1652 et décéda en bas-âge. Le surnom « garçon » trouve peut-être là son origine, Sicaire étant l’unique garçon du couple Marsaudon et Guillonne.
Découvrir nos ancêtres huguenots nécessite donc la connaissance puis la détection d’indices, signes, ou expressions codées, que le curé à laissé au fil des registres paroissiaux.
1er couple :
En tout cas, c’est la majorité des protestants qui se converti au tout dernier moment et le plus souvent par la force. « De paroisse en paroisse les troupes font la vendange des âmes à l’été 1685 ». Histoire du Périgord – Privat – 1983.
Le 21 octobre 1688, un deuxième couple Meyssensas appartient peut-être lui aussi à la religion réformée, habitant le bourg, l’enfant Jean n’est déclaré que le 4ème jour, on retrouve le patronyme Laceuille comme ci-dessus.
Guillauma, une femme célibataire singulière
Un acte notarié sous le règne de Louis XIII
 Louis XIII,
dit « le Juste », fils d'Henri IV et de Marie de Médicis, né le 27
septembre 1601 au château de Fontainebleau et mort le 14 mai 1643 au château
neuf de Saint-Germain-en-Laye, est roi de France et de Navarre de 1610 à 1643.
Louis XIII,
dit « le Juste », fils d'Henri IV et de Marie de Médicis, né le 27
septembre 1601 au château de Fontainebleau et mort le 14 mai 1643 au château
neuf de Saint-Germain-en-Laye, est roi de France et de Navarre de 1610 à 1643.
Son règne, dominé par la personnalité du cardinal de Richelieu, principal ministre d'État, est marqué par l'affaiblissement des protestants, la lutte contre la maison d'Autriche et l'affirmation de la domination militaire française en Europe pendant la guerre de Trente Ans. De son mariage avec l'infante Anne d'Autriche, il a tardivement deux fils : le futur Louis XIV, et Philippe, duc d'Anjou fondateur de la maison Orléans.
Des actes notariés de la famille Meyssensas attestés aux archives de Périgueux :
Aout 1526, le premier acte notarié enregistré à Léguillac nous présente Guillaume Meyssensas, hôtelier au bourg de Léguillac, cent ans après, en février 1626, un deuxième acte notarié concernant Guillauma Meyssensas est enregistré auprès de la Sénéchaussée du Périgord.
En 1539 que l’ordonnance de Villers-Cotterêts soumet toutes les donations à un enregistrement ou insinuation auprès du greffe des juridictions royales puis en 1693 c’est au tour de l’ensemble des actes notariés d’être assujettis à la formalité du contrôle. L’acte traduit en juillet 2022 par France-GenWeb est référencé aux archives de Périgueux en B2-960.
Ainsi l’histoire du Périgord se déroule pendant 100 ans sous les yeux de Guillaume et Guillauma ; entre 1526 et 1626 la campagne Périgordine vit de nombreux désordres. La religion réformée gagne peu à peu les villes, les campagnes sont à l’écart dans un premier temps, les paysans restant attachés au culte des Saints. Après 1560 un état de guerre s’installe. De nombreux paysans endettés rejoignent les villes. La présence d’une ou deux familles Meyssensas sur Périgueux en 1598 est peut-être l’une des explications de cette courte migration.
Puis vient le temps des révoltes paysannes après 30 années de guerre civile. 1595 annonce le début de la rébellion, après 1597 les campagnes retrouvent une certaine sérénité jusqu’à l’assassinat d’Henri IV en 1610. Un soulèvement protestant, à nouveau, se prépare ……
Nos ancêtres Guillauma Meyssensas et son frère Louis dit de Marot sont présents sur les registres paroissiaux dès 1598.
Guillauma est marraine de la petite Guillauma fille de Louis en 1599, du petit Mathieu fils de Louis en 1602. Guillauma n’apparait pas autrement sur les registres paroissiaux qu’en présence de son frère Louis. Louis dit de Marot est parrain du nouveau-né Louis Bibau en 1600.
Evaluons approximativement les dates de naissances des membres de la fratrie à partir des éléments en notre possession. Mathieu dit de Ramonet, autre frère de Guillauma, est témoin en 1618 dans l’affaire Vigier, affaire qui défraya la chronique Léguillacoise entre 1564 et 1629. (Voir article)
Mathieu est laboureur au village d’Armagnac, âgé de 55 ans ce qui par projection le fait naitre en 1563. On peut déduire que Guillauma, Marguerite, ses frères Louis et autre Marot sont nés entre 1550 et 1570 et sont enfants de Marot, mentionné décédé en 1626 lors de la signature de l’acte notarié.
Au tout début du 17ème siècle, les Meyssensas côtoient les Barzac, Rondet et de Linardz, familles de la bourgeoisie rurale de Léguillac, régulièrement cités lors des naissances de membres de la famille Meyssensas d’Armagnac, du bourg ou de Font-Chauvet….
Guillauma Meyssensas ne s’est pas mariée. Lors de la signature de l’acte son neveu Pierre, bénéficiaire de la donation, est âgé d’environ 26 ans, Guillauma d’environ 60 - 70 ans.
La donation consiste en « maison, terre, bois, vignes et autres héritages » sans autre précision, par moitié attribuée à son neveu Pierre. Pierre possède déjà par bail cette moitié. Malheureusement les archives du notaire Rondet ne sont pas parvenues jusqu’à nous et, en conséquence, le détail du bail et des biens cédés.
Le document référencé sur le registre des Insinuations de la Sénéchaussée du Périgord concerne en réalité deux actes notariés, l’un passé le 11 février 1626 au lieu-dit « au Vignaud » vraisemblablement un microtoponyme de la paroisse Léguillacoise aujourd’hui disparu. Nommé « clos » il peut s’agir du nom distinctif d’une propriété rurale peu étendue attenant à la maison d’un petit propriétaire. En 1705 le lieu existe encore attesté par la présence de « Jean Grand seigneur du Vignaud de la paroisse de Lagulhat ». (Série GG)
Le « clos » appartient à Damoiselle Françoise De Laporte (famille originaire du Puy-Saint-Front à Périgueux connue depuis 1200), peut-être descendante de Bertrand de la Porte premier habitant du Puy-Saint-Astier. Un Charles de la Porte écuyer, seigneur de Puyferrat, capitaine de 900 hommes à pied est tué en 1595 lors du soulèvement des Croquants ne laissant qu'un fils de Louise de Grimoard, fille de Jean seigneur de Frateaux et de Françoise de Beaupoil.
Le second acte, qui se trouve être la confirmation de l’acte signé en février 1626 est rédigé le 15 décembre 1626 à Léguillac au domicile du notaire Charles Rondet à Puichaud. Guillauma et son neveu vont devoir se diriger à pied à un peu plus d’un kilomètre du bourg.
L’habitation existe encore ……. Annette Meyssensas, fille de Mathieu vécut au côté du notaire en ce lieu jusqu’à son décès le 10 janvier 1633. Plusieurs prêtres et chanoines assistent la défunte….
Puychaud est l’un des lieux les plus anciens de la paroisse de Léguillac cité dans les archives du prieuré en 1321 lors de la vente d’une pièce de terre « à Puychipel ». Une famille de Puychipel est présente à Puychaud depuis au moins le 14ème siècle. Le 28 novembre 1606 la famille de Puychipel est encore présente à Puychaud lors de la naissance de Guirou de Puychipel, fils de Thomas, parrain Guirou de Puychipel avec sa signature au bas.
Les Puychipel sont vraisemblablement les bâtisseurs de l’édifice actuel à la fin 17ème siècle, le pied des murs est légèrement taluté - réf ouvrage Françoise Raluy page 217.
Les Rondet, famille de notaires royaux, investissent la maison après 1610. Les Meyssensas seront présents au côté de Pierre, Charles et Guillaume Rondet tout au long du 17ème et début 18ème siècle.
Donatrice, procureurs et témoins
Guillauma Meyssensas la donatrice, Pierre son neveu fils de Louys.
Maître Jean Bugeaud procureur es sièges royaux de la ville de Périgueux, procureur de Guillauma.
Maitre Jean de Linards procureur es siège royaux de la ville de Périgueux et y habitant, qualifié de Sieur d’Armagnac, procureur de Pierre.
Maître Jehan Rapnoulh témoin et habitant le bourg de Léguillac.
Charles Rondet notaire, époux d’Anne Meyssensas.
Etienne Vizille dit Tibaideau et Jean Bessarau laboureurs habitants du bourg et témoins qui ne savent signer.
Acte de naissance de Jean Barzac du village d’Armagnac en 1625, en présence de Charles Rondet notaire royal, Jean Rampnoulh notaire, Labrue, Chazotte, Langlade notaire royal, Janailhac diacre, Reynaud notaire royal, tous notables et habitants de Léguillac de l’Auche.
Onzième du mois de février mil six cent vingt et six
« Sachent tous qu’il appartiendra qu’aujourd’hui, onzième du mois de février mil six cent vingt et six, avant midi, au lieu appelé au Vignaud près le bourg de Léguillac de l’Auche en Périgord et dans un clos appartenant à Françoise De Laporte, Damoiselle, par devant moi notaire royal soussigné et témoins bas nommés, a été présente,
Guillauma Meyssensas, fille de feu Marot Meyssensas, habitant du faubourg de Léguillac de l’Auche.
Laquelle de son bon gré et agréable volonté, non contrainte ni induite en aucune manière par force, ains parce qu’en bien lui a plu et plait pour plusieurs ses grandes causes à ce la mouvant, a donné comme par ces présentes, donné par bonne pure et simple donation faite entre vif, perpétuellement durable et a jamais irrévocable à Pierre Meyssensas son neveu, fils de Louys Meyssensas habitant dudit bourg de Léguillac ici présent, stipulant et acceptant pour lui et les siens, savoir est : la moitié de tous et chacun ses biens tant meubles qu’immeubles présent et à venir quelconques en quoi qu’ils puissent consister situés tant audit bourg de Laguillac que en toute la présente paroisse ou ailleurs en quelle part qu’ils puissent être soit :
Maison, terre, bois, vignes et autres héritages quelconques sans les avoir spécifiés ni déclarés, sans autres choses se réserver ni retenir sur iceux que les usufruits et jouissance d’iceux sa vie durant seulement. Et en cette qualité et à ladite réservation, s’est ladite Guilhauma Meyssensas démise et dévêtue de ladite moitié de tous lesdits biens et de ceux qu’en a investi ledit Pierre Meyssensas son neveu par le bail et la note des présentes.
Se constituant les tenir d’icelui Pierre Meyssensas au nom et titre de précaire jusqu’à ce qu’il en aura pris la réelle possession et jouissance. Promettant la lui garantir et défendre envers et contre tous de tout trouble et empêchement et franche, quitte et immune de tout hypothèque et charges quels qu’ils puissent être, jusqu’au jour présent, à peine de tous dépends dommages et intérêts. Et pour insinuer et valider, requérir et accepter le présent contrat de donation en la cour ordinaire de la présente sénéchaussée où ladite Guilhaume Meyssensas a voulu être insinué pour la plus ample validité.
A cette cause elle a constitué son procureur de sa part, pour icelui requérir : Maître Jehan Bugeaud, et pour icelui accepter de l’autre part, ledit Pierre Meyssensas se constitue son procureur : Maître Jehan De Linard.
Tous deux procureurs es sièges royaux de Périgueux, avec puissance de substituer un ou plusieurs procureurs pour requérir et accepter ladite insinuation et en tenir acte et autrement généralement faire, comme lesdits constituants feront ici présents. Promettant avoir et tenir pour agréable tout ce que par lesdits procureurs ou lesdits substituants sera fait et du tout les en relever indemnes de tous dépens, dommages et intérêts.
Et pour l’entretien de tout ce que dessus, lesdites parties ont obligé et hypothéqué tous et chacun leurs biens présents et advenir et ont renoncé à toutes exceptions et dépens aux présents contraires, moyennant serment par eux faits.
A quoi faire ont été condamnés, sous ledit sceau royal, en présence de Maître Jehan Rapnoulh praticien habitant du lieu de……… audit bourg de Léguillac et Estienne Veyssière dit Tibaideau habitant dudit bourg de Léguillac, témoins.
Ledit Rapnoulh a signé et non les autres pour ne savoir écrire, de ce dument enquis et interpellés. Ainsi signé au pied de l’original des présentes : Rapnoulh
Présent et moi ainsi signé Charles Rondet notaire royal.
 |
| Carte de Belleyme |
Pierre de Belleyme sous-ingénieur géographe de Sa Majesté fut chargé dès 1776 de la gravure de planches cartographiant la Guyenne de l’époque en particulier des départements de la Dordogne, Gironde, Landes et Lot-et-Garonne. Il dresse sa première carte détaillée en 1783 et ce jusqu’en 1793. Pierre de Belleyme sera anobli par Louis XVIII pour ses travaux.
Aujourd’hui quinzième du mois de décembre mil six cent vingt et six, après midy, au lieu de Puychaud en la paroisse de Léguillac de L’Auche en Perigord, par-devant et en la maison du notaire royal soussigné et témoins bas nommés, a été présente Guilhauma Meyssensas fille de feu Marot Meyssensas habitant du bourg dudit Léguillac. Laquelle de son bon gré et volonté, en présence de Pierre Meyssensas fils de Louys, son neveu habitant dudit lieu a d’abondant et comme a dit, de nouveau fait,… et constitué son procureur général et spécial : Maître Jehan Bugeaud procureur es sièges royaux de la ville de Périgueux, ici présent et par express, pour requérir l’insinuation du contrat de donation et articles y contenus, par elle ainsi fait en faveur dudit Pierre Meyssensas son neveu, en la cour ordinaire de la présente sénéchaussée, avec les réservations y contenues, comme est porté par le contrat sur ce fait le onzième du mois de février, an présent mil six cent vingt et six, reçu par moi notaire, ce que ledit Meyssensas y présent a accepté.
Et de sa part, constitue son procureur Maître Jehan Delinardz procureur auxdits sièges, pour accepter ladite donation et d’icelle insinuation en tenir acte et autrement, généralement faire comme lesdits constituants feraient si présents ou faire pourraient, j’accuse que mandement plus spécial y fut requis et nécessaire. Promettant avoir et tenir pour agréable tout ce que par lesdits Bugeaud et Linardz ou leurs substituts sera fait.… Et du tout les en relever indemnes, sous l’obligation et l’hypothèque de tous leurs biens présents et advenir, à quoi faire
Ont été condamnés sous ledit sceau royal, et présence d’Estienne Veyssière dit Tibaideau habitant dudit bourg de Laguilhac et Jehan Bessarau laboureur habitant du présent lieu, témoins qui ne se signent, ni lesdits constituants pour ne savoir écrire, de ce dument interpellés par moi, ainsi signé Charles Rondet notaire royal.
Maître Jehan Bugeaud au nom et comme procureur de Guylhauma Meyssenssas et en vertu de sa charge et procuration à ce express a insinué et notifié a tous qu’il appartiendra la donation par elle faite en faveur de Pierre Meyssensas son neveu, des biens contenus par le contrat sur ce fait le onzième février mil et six cent vingt et six, reçu par Rondet notaire royal et les charges et réservations y contenues (en marge : du 15 décembre1626)
Laquelle donation, Maitre Jehan de Linardz au nom et comme procureur dudit Pierre Meyssenssas, aussi en vertu de sa charge et procuration a ce express dudit jour quinzième décembre dernier, a acceptée et de sa part insinuée, dont ma requis acte et dudit contrat et procuration, ai laissé copie au greffe ».
Guillauma, une femme célibataire singulière
Les femmes célibataires sont bien moins nombreuses dans la société rurale que dans la société citadine. Comme les veuves, les femmes célibataires jouissent d’une capacité juridique entière et agissent en leur nom propre. Par ce simple fait elles sont aisément visibles sur les registres de taille et actes notariés. Cependant le cas de Guillauma Meyssensas est un exemple extrêmement rare dans le monde rural car seules les personnes ayant des biens passent devant notaire et cela, d’évidence, concerne avant tout les élites du monde rural.
En ce début de 17ème siècle Guillauma est une femme singulière, pionnière d’un célibat laïc qui s’affranchit socialement, intellectuellement et moralement.
A-t-elle choisi son célibat ? s’est-elle sacrifiée aux intérêts familiaux ? ou les difficultés familiales ont-elles empêchées la réalisation d’une alliance ou d’une dot ? Le célibat de Guillauma ne fut pas un obstacle comme il le fut souvent plongeant les femmes célibataires dans les travaux précaires ou la mendicité. La donation de Guillauma démontre la présence d’un noyau familial important. En effet son neveu Pierre entretient une partie de la propriété de Guillauma et lui apporte ainsi un soutien financier. Contrairement aux autres femmes du village et des hameaux voisins Guillauma n’est point subordonnée à l’ordre patriarcal.
Quel était le statut de Guillauma jusqu’au décès de ses parents ?
Dépendante de sa famille, peut-être domestique en son jeune âge ou travaillant aux champs avec son père Marot.
En tout cas il s’agit de la première femme « Meyssensas » célibataire rencontrée lors de mes recherches familiales.
Un acte remarquable en l’an 1626
Observons l’acte de baptême de Pierre Meyssensas du 2 juin 1626, fils de Gabriel Meyssensas et de Pauline Chabanas, parrain Pierre Rondet fils de Charles, marraine Jeanne Chabanas. Les signataires sont Pierre et Charles Rondet notaires royaux, Chazotte sergent royal, Fournier, peut-être Pierre Fournier maitre chirurgien à Périgueux, époux de Marguerite Conche - un Sicaire Meysensas se marie en 1702 avec Antoinette Conche du hameau de Poude, Conseillaud, curé, et Rampnouilh greffier, assistants du curé Charrière et deux signatures intrigantes.
Charrière : il s’agit vraisemblablement de Jean de Charrière, écuyer, chanoine de l’église de Saint-Astier, décédé le 6 juin 1669. En 1639, Jean de Charrière est mentionné sieur de la Serne, chanoine de l’église de Saint-Astier.
Le curé Charrière officie pour la première fois en fin d’année 1612 assistant le vicaire Arnouldye, premier membre du clergé présent sur les registres paroissiaux de Léguillac en 1598. En 1617, le curé Arnouldye ne dessert plus l’église de Léguillac. Il se déplacera en qualité de prêtre, « par commandement du curé » spécialement le 8 décembre 1620 à Léguillac pour le baptême de Pierre Rondet fils de Charles et Annetou Meyssensas, parrain Pierre Rondet, marraine Marguerite Meyssensas assisté de De Janailhat et Chazotte.
On note particulièrement au bas de l’acte de 1626, et avec étonnement, la présence d’un Jean de Grimoard seigneur de Frateaux, descendant de la maison Grimoard. Les Grimoard, l’une des plus anciennes familles de la province du Périgord, qui pendant près de trois siècles seront héritiers de père en fils du fief de Frateaux à Neuvic, à 18 kilomètres de Léguillac ; de Jean Grimoard I à Guinot en 1523, de Jean Grimoard II puis son fils dit « de Frateau » qui testa en 1569 au lieu et bourg de Frateau dans lequel il fait son fils Jean III son héritier, futur époux de Françoise de Beaupoil de Saint-Aulaire. En 1600, il passe à François (1575-1658) lequel épouse Lucrèce de Mellet de Fayolle dont le fils Jean IV sera nommé maréchal des camps et armées du roi Louis XIII en 1652 et devient seigneur de Frateau.
Johannes de Frasteaux dont la signature apparait au bas de l’acte de baptême de Pierre est vraisemblablement l’un des frères de François fils de Jean III de Frateaux.
Une autre signature reste inexplicable, celle d’un A. de Saint-Michel.
S’agit-il de la maison des Penaud qui se qualifient de sieurs de Saint-Michel ? « En 1612, Antoine de Penaud, écuyer, et Annet de Penaud sont coseigneurs de Saint-Michel et du Gravoux ». En 1615, lors de la prise de possession de la Vicomté de Castillon par le duc de Bouillon, le manoir du Gravoux est en possession d'Annet de Penaud, écuyer.
Existe-t-il un lien entre les seigneurs de Saint-Michel et du Gravoux avec les d’Abzac de la Douze de Léguillac de l’Auche ?
On note que « la dame de Gravoux et les d’Abzac, par achat ou acquisition de la famille d'Abzac de La Douze pour les cens et rentes hommages en 1620 par le sieur Annet de Penaut, écuyer, seigneur de Saint-Michel du Gravoux ». Réf : archives Bordeaux - 2 MI 1678-1 - juridiction de Montravel.
Si l’on se réfère à la Revue historique du Libournais de 1960, il est noté « Les châteaux de Saint-Michel et du Gravoux vont passer à la famille d'Abzac de La Douze par le mariage de Georges d'Abzac de Ladouze avec Marie de Penaud le 8 janvier 1648 ».
Les parents de Georges d’Abzac sont Pierre II d’Abzac de la Douze et Marie Jay de Beaufort marié en 1612, ors en 1626, date de l’acte qui nous intéresse le prieur de La Faye n’est autre que Bernard de Jay de Beaufort. On retrouve Bernard de Jay et Pierre d’Abzac dans la fameuse histoire Vigier. En 1637, c’est un autre d’Abzac de la Douze qui devient prieur de La Faye en la personne de Jehan.
En tout cas la présence de ces deux signatures de nobles locaux ne s’explique pas au bas de l’acte de baptême d’un Meyssensas si ce n’est peut-être par la présence du notaire royal Rondet et ses liens avec la noblesse locale.
90% des actes d’état civil à cette époque présentent les signatures du curé et parfois celles de notables locaux tels les Rondet, Janailhac ou Rampnouilh et de façon très rares de nobles comme les Testard, d’Aloigny, du But, de Jay ou la Douze. Les deux signatures de nobles au bas de l’acte de baptême de Pierre Meyssensas en 1626 sont réellement intriguantes car les signataires habitent à plus de 15 km de Léguillac et ne sont pas parrains du nouveau né.
Deux années plus tard entre 1628 et 1634 le Périgord subit ses dernières flambées de Peste.

 |
| « Aux tabas » section A1 du plan cadastral en 1808. |
Marot, tisserand, habitant le lieu des « Tabas », paroisse de Lagulhat de l’Auche, teste « environ les dix heures du matin en sa maison, lequel est couché, mal disposé ».
Marot lègue à :
Bertrande Meysensas, sa « nièpce », fille de feu Jean Meysensas, son frère, la somme de 20 livres.
Catherine Meysensas « aussy sa nièpce », la somme de 5 livres.
Bernichou Meysensas et Mariotte Veyssière, son frère et sa sœur, ses neveux, fils de feu Catherine Meysensas, la somme de 5 livres.
Marie Meysensas, sa sœur, veuve de feu Pierre Simon de Merlet, et leur fils, la somme de 10 livres. (Marie nait le 4 février 1625, mariée le 15 septembre 1654 avec Pierre Simon, suchier).
Les autres, meubles et immeubles à Jeandillou Meysensas, son frère.
Marot cède une terre labourée à la veuve Jane Rapnouilh. Le bas des feuillets est dégradé, Marot, semble léguer une terre labourée, attenante aux terres des hoirs (héritiers) du seigneur de Linard et des hoirs de Pierre Boudu.
L’acte est rédigé en présence de Jean Chabanas dit Bibaud, marguillier, Léonard Debivas, « tailheur », Maître Jean Soulhier de Langlade, habitants Léguillac et Jean Dubiz, laboureur, Jean Meysensas, tisserand, habitants au Tabas et Reynaud, notaire royal.
Page 1
« Au nom du Père, du Fils, du benoist [Esprit], amen. Sçaichent tous qu’il appartiendra que au jour vingt-huictiesme jour du mois d’aoust mil six cent huictante et quatre, au lieu des Tabas prest le bourg de Lagulhat* de l'Au[che] en Périgord, environ les dix heures du matin et maison où habitte Marot Meysensas tixerant, par devant moy notaire royal s[oubzsigné] et présent les tesmoins bas nommés,
a esté présent ledit Marot Meysensas, tixerant habitant dudit présent lieu des Tabas prest ledit bourg de Lagulhat, lequel estant au lit couché, mal dispozé de sa personne, toutes fois par la grâce de Dieu en ses bons sens, mémoyre et entandement,
et considérant qu’il n’y a rien au monde si certain que la mort ny chose plus incertaine que l’heure d’icelle, et ne voulant décéder ab intestat, a faict et ordonné son testement noncupatif estrême et dernière volonté, en la forme et manière qui s’ansuit. Premièrement, a faict le signe de la sainte Croix sur son corps en disant « In nomine patri filii spiritu sancti amen »,
a recommandé son corps et âme à Dieu le créateur et à la benoiste Vierge Marie et à tous les saints et saintes de paradis, les priant d’intercéder pour luy envers nostre Seigneur Jésus Christ pour le salup de son âme,
Et a vouleut et veut ledit testateur que lors qu’il plaira à Dieu séparer l’âme de son corps, sondit corps estre porté et ensevelit au s,mmetière de l’esglize parochielle du bourg dudit Lagulhat et tumbeau de ses prédécesseurs trespassés
et que à sa sépulture, octave et fin de l’an, il soit appellé et convoqué deux prestres messe chantant et …. priant pour le salup de son âme, payables par son héritier bas nommé.
Item donne et lègue ledit testateur à Jane Rapnouilh veufve à feu Jean Soulhier … … Jean à cauze (des) services qu’il a receu d’elle et espère recepvoir à l’advenir, en récompense d’yceux …. »
Page 2
« [terre] des hoirs du Sr Linard procureur* et à la [terre] des hoirs de Pierre Rondet et à la terre de Marot Meysensas laboureur d’autre**, pour en jouir et disposer par ladite Rapuonilh après son depcès à son plaisir et volonté.
Item donne et lègue aussy ledit testateur à Bertrande Meysensas sa niepce et fil(l)eule, fille de feu Jean Meysensas son frère, la somme de vingt livres et,
à Catherine Meysensas aussi sa niepce, fille dudit feu Meysensas, la somme de cinq livres,
et à Bernichou et Mariothe Veysières** frère et sœur, ses neveux fils de feue Catherine Meysensas sa sœur, à chescun d’yceux la somme de cinq livres,
et à Marie Meysensas sa sœur, veufve de feu Pierre Simon, vivant sensier de Merle ? la somme de dix livres, le tout payable par son héritier bas nommé aus susnommés incontinant après son depcès, et pour en dispozer chescun d’yceux après sondit depcès à son plaisir et volonté.
Et au rézidu de tous et uns chescuns ses autres biens, baptimant, meubles, imeubles présent et advenir, ledit testateur a fait, créé, institué et de sa propre bouche nommé son héritier universel, Jandilhou Meysensas son frère, par lequel veut et entand ses debtes et léguats estre payés et acomplis. Et avec ce ledit testateur a dit et déclairé ce présent testement estre son dernier et perpétuel testement noncupatif extrême et dernière volonté, cassant, révoquant et annullant tous autres testements, codiciles ou donnations qu’ils pouroit avoir cy devant faict, voulant et entandant que le présent sorte son plein entier effet suivant sa forme et teneur,
et a requis à moy dit notaire le luy vouloir rédigier par escrit, que luy ay con(cédé) soubz le sel royal, et appelés à tesmoigner pour en estre mémoratif, Me Jean Soulhier praticien, Jean Chabanas dit Berland, marguilhier, Léonard Dabiras tailheur, Arnaud Laborie ? »
* Léonard Vincent, procureur à Périgueux, est cité dans divers actes.
** ces lignes énumérent les « confronts » (voisins) d’un terrain.
Page 3
« tous habitans du bourg de Lagulhat … Clerc habitans du village de Langlade, par(roisse) ….
Jean Dubez laboureur et Jean Meysensas du …… tixerant habitans dudit présent lieu des Tabas, t[esmoins] cognus ; lesdits Soulhier et Langlade ont signé et [non … ?] ledit testateur ny autres tesmoins pour ne sçavoir, de ce interpellés par moy ».
Signatures : Langlade présent ; Soulhier ; Reynaud notaire royal, tisserand, habitant le lieu des « Tabas », paroisse de Lagulhat de l’Auche, teste « environ les dix heures du matin en sa maison, lequel est couché, mal disposé ».

 |
| Prieuré de La Faye |
29 septembre 1688
Accord entre Vergnaud, Meysensas et Simonnet
« Aujourd’hui vingt neufuiesme du mois de septambre mil six cent quatre vingt et huit au bourg de Lagulhac de Lauche en Périgord avant midy et maison ou habitte Léonard Gouzou hostes par devant moy notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés ont pris et personnellement constitués Gabriel Vergniaud laboureur habitant au village de Combecouyère parroisse de Mensignat audit Périgord d’une part faisant de moy comme représentant légal administrateur de ses enfants et de feu Marie Meysensas sa première femme et Pierre Meysensas aussy laboureur faisant pour luy que pour d’autre Pierre et Jean Meysensas, ses frères, disant absans ausquel il promest longtemps d’entretenir, alouer et ratiffier, de constituer, apeyne de tout despant dommages habitant du lieu-dit Chantegeline aussy audit Périgord d’autre et Marie Simonnet veuve de feu Marsoudou Meysensas, niepce, beau-père et mary, habitant aussy du lieu de Chantegeline d’autre part lesquelles dictes parties a esté dit que ladite Marie Meysensas contractant mariage avec ledit Gabriel Vergniaud, le dit Marsoudou Meysensas et Marie Decouts ses paire et mère ont fait leur héritière de tout leurs biens présents et advenir suivant le nombre de leurs enfans ou filhes qu’ils auront lors deleurs dépcés et en outre luy auront constitué certains linges et promis de caution annuelle pendant dix années la somme de quarante sols pour chacune dycelles dicts années en quoy laditte Marie Descouts estan veuve et décédée ledit Marsoudou Meysensas avoit convollé en seconde nopces avec ladite Marie Simonnet et par leurs contrat de mariage du vingt six décembre mil six cent huictante deux par Reynaud notaire Royal, le dit Meysensas auvoit promis agencement et gains de survie » - fin du premier feuillet.
« aladit Simonnet sa seconde femme la somme de vingt livres et le dit Marsoudou Meysensas estan venu amourir dans le mois de juin dernier, ledit Vergniaud estoit faire le point de former action contre ledit Pierre Meysensas pour la division et partage des biens meubles et ymeubles délaissés par ledit feu Marsoudou Meysensas son beau-père aus fins deluy estre délaissé un quatriesme sans estre comprendre les meubles aluy donnés par préciput par son contrat de mariage du dixiesme fébvier mil six cent septante neuf rendu par feu ……. notaire royal et ladite Marie Simonnet vouloit aussy poursuivre le payement de lesquelles par elle gaigné par le prédécés de son feu et mary surquoy les dites parties estant contraint de s’engager dans un grand et long procès pourquoy obtenir et craignant le douloureux événement d’yceluy traitant aussis leurs parents amis et conseil, ils sont venus estre aborder et traitant que …
Scavoir que le premier jour il sera fait partage entre le dit Vergniaux et Meysensas des biens déllaissés par ledit feu Meysensas que parladite Marie Descouts lors duquel partage il sera délaissé apart et indivis audit Vergniaud qu’il agist un quatrièsme des biens fonds et audit Meysensas de son chef les trois autres quatrièsme pour y estre dellaissé et ensuite deux portions entre ses frères et pour acqui lesdits meubles légué parentier et déclaré et estre venu apartage le dit Vergniaud a retiré par devant moy un quatrieme outre ceux qui sont portés par son contrat de mariage lesquel il déclare avoir reçu et acquitté et aquitte le dit Meysensas et ses frères aux promesses de ne leurs en faire aladvenir aucune demande ny plus que leurs parties delaquelle il déclare avoir esté entièrement payé et les autres trois portions desdits meubles ont esté retirées par ledit Meysensas tant de leur chef que ……et constitué par ladite Marie Simonet elle a déclaré que lors dudit partage des dits meubles ledit Vergniaud et Meysensas » - fin du 2ème feuillet.
« délaissé les meubles du chef édicté dudit feu Marsaudou Meysensas, son mary, de la valeur de la somme de vingt livres ……. dont …….. et qu’elle a acquitté deladite somme de vingt livres aux promesses de ne plus la demander aladvenir et pour acquis de ces fruits délaissés par ledit feu Marsaudou Meysensas perçus et apercevoir, le dict acte convenu et arresté entre lesdistes parties, le tout demeurant en propre audit Pierre Meysensas et qu’il sera tenu comme obligé par les parties de payée les dettes dudit feu Marsaudou Meysensas sous peine de tenir quitte le dit Vergniaud que la dite Marie Simonnet et pour l’entretien de tout convoqué les dites parties sont obligé et hypothéqué tout le leurs biens meubles, ymeubles présent et advenir ou renoncé aux …….. contraires moyennant paiement par eux fait aquoy faire de leurs vouloir et consantement ou estres condampnés soubs le chef Royal en présence de François de Langlade Sieur de Las Couts habitant du village de Langlade parroisse de Razat audit Périgord et dudit Léonard Gouzou hoste habittan dudit même bourg, le dit Langlade asigné et non les parties ny ledit Gouzou autre lequels pour ne scavoir de ceux enquis et autres choses qui luy pourrons apartenir et qualitté ……. du Sieur de la Borie audit lieu de Chantegeline » - fin du 3ème feuillet.
Contenu de l’acte :
L’acte est enregistré dans l’hostellerie du bourg en présence du tenancier Léonard Gouzou. L’habitation appartient à François de Langlade Sieur de Las Couts, domicilié à Razac.
Un shéma permet de mieux situer les trois contractants de l’accord, accord issu d’un litige entre Gabriel Vergnaud, mari en premières noces de Marie Meysensas, décédée, fille des parents décédés Marsoudou Meysensas et Marie Descouts, et ses frères, Pierre et Jean Meysensas et la deuxième femme de Marsandou, Marie Simonnet concernant le partage des biens meubles et immeubles de Marsoudou Meysensas ainsi que des sommes promises en gains de survie à sa deuxième épouse, Marie Simonnet.
L’accord conclu au partage des biens de Marsandou par un quart des biens fonds attribué à Gabriel Vergniaud, les trois autres quart à Pierre Meysensas, Jean et autre Pierre Meysensas, la somme de 20 livres en gain de survie à Marie Simonnet.
Remarque : le notaire Reynaud écrit invariablement le patronyme, « Meysensas » et non Meyssensas.
Contrat de mariage entre Sicaire Meysensas et Annette Conche
 |
| Reconstitution plan du village de Léguillac de l'Auche en 1808 |
 |
Les dimes du prieuré de La Faye au 17ème siècle
Créé en 779 par Charlemagne, la dime devient, au fil des siècles, l’impôt le plus impopulaire. Le clergé ne reçoit aucune rétribution de l’Etat, ses revenus émanent donc du rapport de ses biens et de la dîme.
« Premièrement a été affermé le quartier de Cayot et le Bourg à Thomas Meyssensas et autres consorts, la quantité de 60 charges de bled tiercé ».En marge le collecteur note « reçu le contenu en la sus ditte afferme sauf d’une charge ».
Le registre est précisément tenu. La novale n° 29, est un terrier éboulé au village de Font Chauvet, défriché, depuis 10 ans environ, appartenant au Seigneur de Beller, confrontant au chemin dudit bourg de Lagulhac, et autres terres dudit seigneur propriétaire. En marge il est mentionné, en friche en 1741, entretenue en 1742 et avec, en 1743, la dîme de deux gerbes restant sur le champ.
Les métiers de la terre
Charles est « issu d’une maison distinguée de Bretagne, fils de Pierre, chevalier, comte de Bouexis »
 |
| 21 juin 1789 – baptême « à féfix Augustin de Montozon, ondoyé …. » |
Les échos de la prise de la Bastille, les faits qui se déroulent tant à Paris qu’à Versailles, l’approche de la moisson, et les rumeurs qui parlent de « l’arrivée de 2000 brigands sur Brantôme », voulant, soit disant, s’emparer des récoltes, des « Anglais à Limeuil et Ribérac, mis à feu et à sang », et des « Allemands aux frontières du pays », enflamment les esprits.
2ème période
Après l’épisode Léguillacois, une nouvelle agitation métayère se dessine en Périgord, à l’ouest et au nord du département, Saint Astier et Tocane, Agonac et Brantôme sont tour à tour atteints par des « personnes mal intentionnées », qui parcourent la campagne en défendant aux métayers de payer la rente, la dîme aux propriétaires. Quelques gardes nationales des paroisses concernées soutiennent les métayers, la garde nationale de Périgueux fait 80 prisonniers fin aout à Lisle, puis c’est au tour de Saint Astier.

































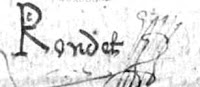

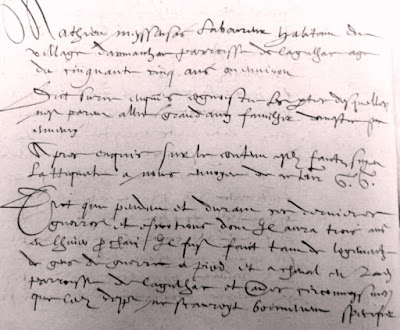















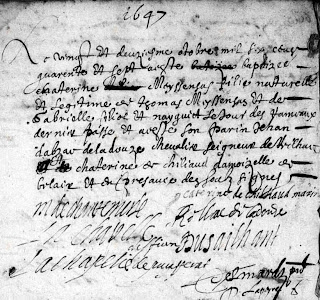









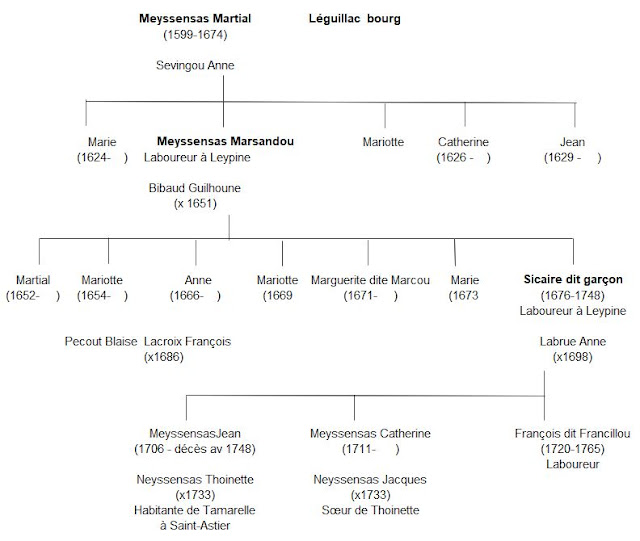























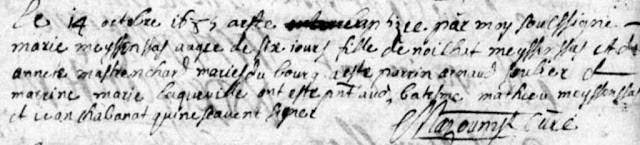







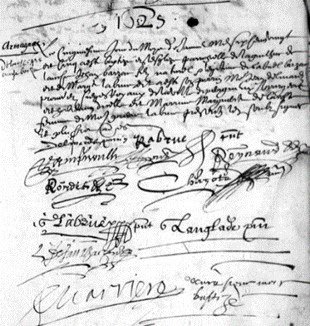














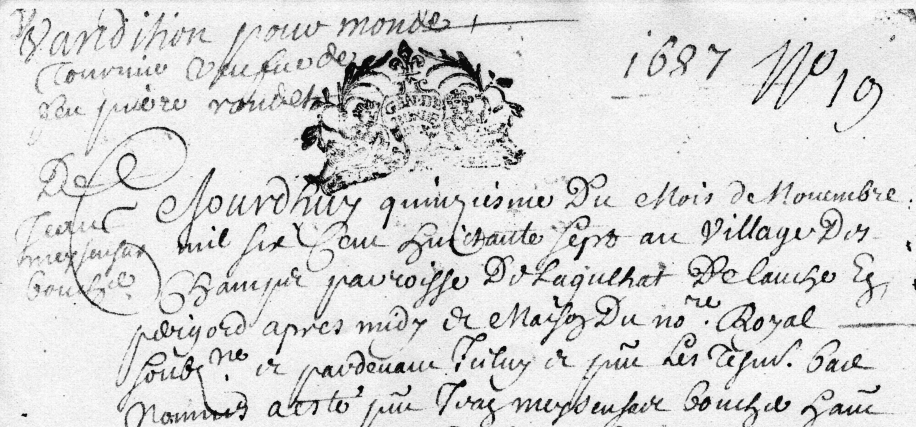



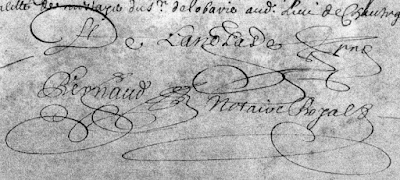





























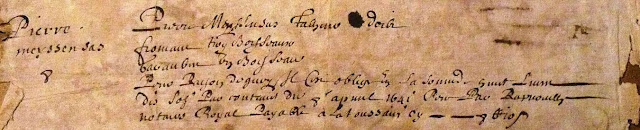


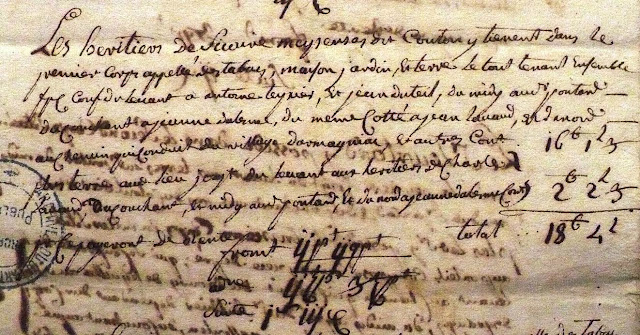


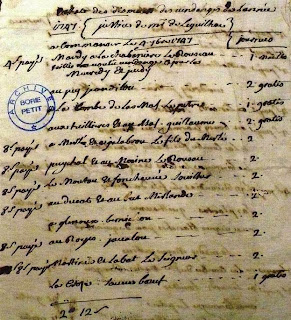

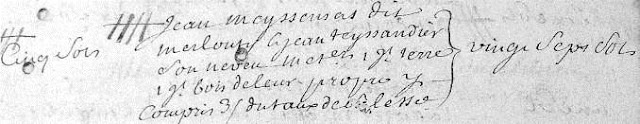













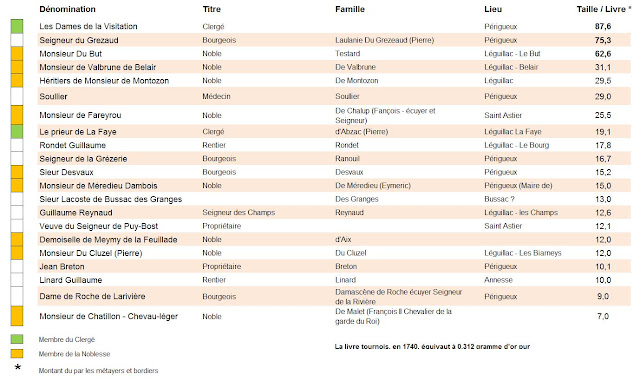
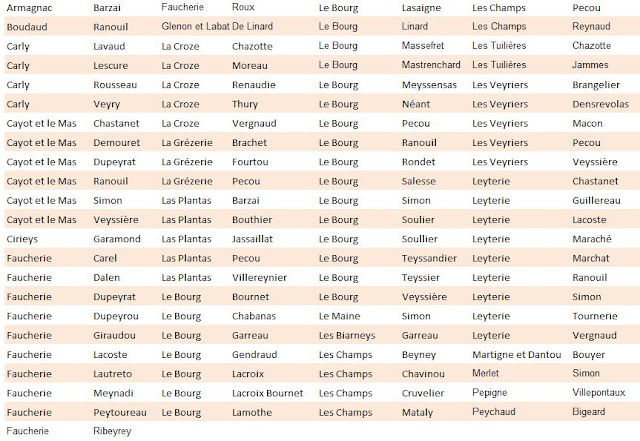

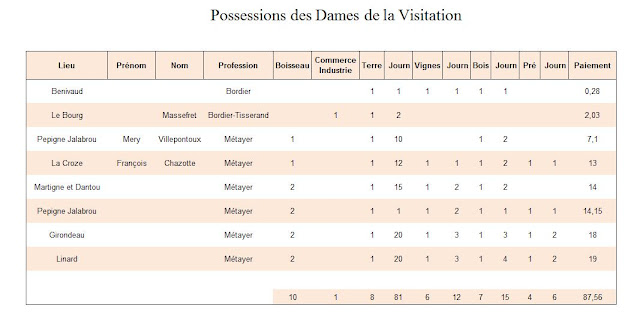



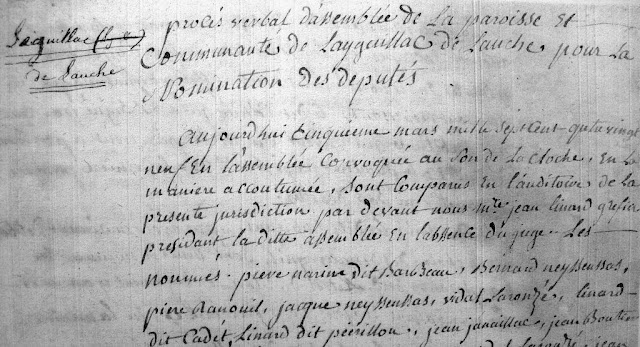
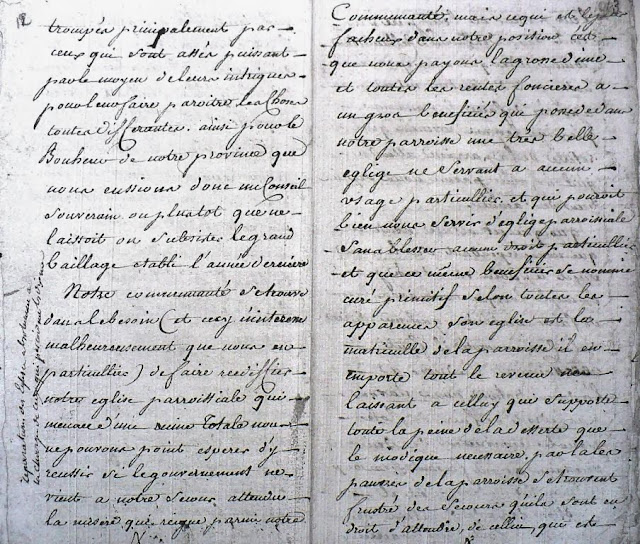






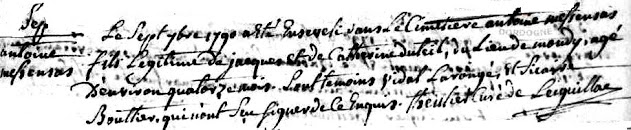
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire