Pierre Neyssenjean, la campagne de 1793 en Vendée
François Leyssensa, la campagne d’Egypte en 1798
Pierre Neyssensas, décédé en 1870
Paul Neyssensas décédé pendant la bataille de la Marne en 1914 et tous ceux cités
Maurice Neycensas, marin rescapé à bord du cuirassé Dunkerque
à Mers El Kébir (Algérie) en 1940
Neyssensas Robert, Résistance Intérieure Française, déporté et interné à Mauthausen en 1943
Neycenssas Pierre, décédé en déportation en 1944
Neycenssas Jack, décédé en Algérie en 1957
Les soldats de la Révolution - La campagne de 1793
 |
| Cholet - 17 octobre 1793 Défaite des Vendéens |
Entre l’an III et IV les désertions sont de plus en plus nombreuses en Dordogne, certains ayant déjà largement contribués à l’effort de guerre. Malgré l’affaiblissement des demies brigades causé par un grand nombre de déserteurs, la situation militaire Française en 1795 est meilleure que les années précédentes.
C’est ainsi que le 14 prairial an III - mardi 2 juin 1795 - sont recrutés, Sicaire Neyssensac, 19 ans, cultivateur à Mensignac, Meysensar, 25 ans, tisserand à Leguillac, et Jacques Nessensar, 20 ans, cultivateur à Saint Astier.

Le 18 brumaire An VI - 1797 - l’administration constate son impuissance à faire exécuter la loi. La gendarmerie est mal organisée. Elle est principalement, fin novembre, toute à Saint Astier, Bergerac ou Sarlat, où s’élèvent des troubles. Les réquisitionnaires fuient d’un canton à l’autre, se cachant dans les bois.
1794 - l’Armée des Pyrénées Occidentales
Jacques Neyssensas recruté de l’An II
Dans le courant du mois de juillet 2020, Madame Françoise Raluy me communique un nouveau document découvert aux archives départementales de la Dordogne quelques semaines auparavant.
Il s’agit d’extraits d’une liste de jeunes hommes de la circonscription de Périgueux recrutés en 1794 pendant la période révolutionnaire destinés à accroître les effectifs de l’armée des Pyrénées Occidentales.
Les deux feuillets, datés du 24 nivôse An II (13 janvier 1794), sont référencés Série L.
Contexte historique en Dordogne
En fin d’année 1793, le 9ème bataillon de la Dordogne rejoint les Pyrénées Orientales. En avril 1794, le bataillon stationne à Foix.
Le 3ème bataillon de la Dordogne, formé le 26 septembre 1792, va servir l’armée des Pyrénées-Occidentales, division de Saint-Pé. Il est à Blaye en janvier 1793, au col d’Ispéguy, non loin de la vallée de Bastan, courant mai 1793. En avril 1794, il sert dans la division de Saint-Jean-Pied-de-Port et participe aux opérations de la vallée de Bastan et autour d’Irun.
« Les nouveaux administrateurs sont à peine installés (2 nivôses an II - 22 décembre 1793) que le général de brigade, chef de l’état-major de l’armée des Pyrénées Occidentales demande 1500 hommes, …. Que l’agent supérieur pour le recrutement des jeunes gens de 18 à 25 ans, prendra les mesures pour que le contingent soit rendu à Bayonne le 12 nivôse (1er janvier 1794).
Sous aucun cas le manque d’habillement ne pourra retarder le départ. En cas d’insuffisance de ces effets, on donnera néanmoins aux hommes le nécessaire pour les garantir des intempéries de la saison. L’agent supérieur fera partir, de préférence, « les gens oisifs et ne tenant pas à l’agriculture ».
Roux-Fazillac, représentant du peuple, est envoyé par la Convention avec des pouvoirs illimités pour surveiller la levée. Roux-Fazillac, Conventionnel, né à Excideuil le 18 juillet 1746, décédé à Nanterre le 21 février 1833. Garde du corps du roi, lieutenant-colonel en 1789, il est élu député de la Dordogne à l’Assemblée législative et à la Convention et prend place sur les bancs de la Montagne. Dans le procès du roi il vote contre l’appel au peuple pour la mort et contre le sursis.
Athée, ennemi des prêtres et adversaire farouche de la religion, dès juillet 1793, il mène activement le mouvement de déchristianisation en Dordogne
Arrivé dans le département il valide le décret de levée des 1500 hommes le 4 nivôse an II. Le district de Périgueux enverra 120 hommes pour ce premier contingent. Jean Neyssensas et la 4ème division font partie de ce contingent.
En mai 1794, les Directoires de districts sont chargés de requérir les citoyens les moins utiles à la culture des terres et aux arts, et de ne point s’en rapporter vaguement aux certificats de maladie ou d’infirmité, que « s’empressent de mendier ceux que la lâcheté enchaine et que la fortune oblige ».
Ainsi sont formés deux autres contingents d’environ un millier d’hommes. Ces hommes sont réunis à Bergerac, d’où ils partent en deux détachements courant 1794. Chaque détachement est commandé par un lieutenant et un sergent pour 100 hommes qui choisiront « de bons sans-culottes ».
Le 11 mai 1794 il y a encore 7033 réquisitionnaires de la première levée dont l’incorporation n’a pas été faite ; ils seront versés sans délai dans les cadres de l’armée des Pyrénées Occidentales.
La situation à la frontière Espagnole
Le général de division Muller commande l'armée des Pyrénées occidentales et lance les premiers engagements à Hendaye le 5 février 1794, dans le col d'Ispéguy le 3 juin, et à Bera (Bidassoa) le 23 juin.
Les batailles en Pays-Basque et en Navarre sont dirigées depuis le quartier général situé à Bayonne.
Les Français capturent le magasin de mâts de la marine espagnole sur l'Irati et une seconde fonderie, à Egui.
 |
| Moncey effectue une avancée victorieuse |
Quand une éclosion mortelle de maladies paralyse les opérations françaises dans les Pyrénées occidentales pendant l'hiver 1794 - 1795. En juin 1795, Moncey effectue une avancée victorieuse vers l'ouest et s'empare de Vitoria-Gasteiz et Bilbao.
Le traité de Bâle, le 22 juillet 1795, met fin à la guerre.
Quand les nouvelles de paix atteignent le front en août, Moncey a traversé l'Èbre tandis que les autres forces se préparent à investir Pampelune.
Les recrutés Périgourdins
L’extrait du rôle nous indique que les recrutés, toujours appelés « volontaires », sont enrôlés au sein de la 4ème division sous le commandement du capitaine Nicolas Maurice, du lieutenant François Frut, et des deux sergents, Jean Desmaison et Hilaire Dalesme.
Qui sont ces hommes ?
Nicolas Maurice, originaire de Thionville, capitaine à compter du 25 septembre 1792, chef d’escadron le 26 janvier 1793, refuse son nouveau grade de général de Brigade le 23 aout 1793. Nicolas Maurice est traduit devant le tribunal révolutionnaire par Saint-Just le 17 nivôse An II ; condamné, il est incarcéré en la forteresse de Landau. Prit-il part finalement au commandement de la 4ème division ?
Le lieutenant Elie François Frut est né le 21 octobre 1764 à Périgueux. Au service depuis 1781, sergent au 40ème de ligne, marié en 1790 avec Jeanne Guinot, décoré de la légion d’honneur en 1813, il décède le 7 aout 1829 au fort de Lourdes à l’âge de 64 ans. Des lacunes sont relevées de carrière militaire, notamment pendant la période révolutionnaire.
Aucune information sur le sergent Jean Desmaison.
Quant au sergent Hilaire Dalesme, il nait le 10 juin 1775 à Saint-Astier. Ami de Jean Neyssensas, Hilaire est charron et témoin lors de son mariage le 28 pluviôse An 11 (1803).
Hilaire, à présent marchand bottier, se mariera le 18 septembre 1808 à Rueil Malmaison avec Catherine Suzanne Julien. Hilaire est domicilié au 251 rue Saint-Honoré, 1er arrondissement de Paris lors de son décès à l’âge de 51 ans, le 16 aout 1826.
Jacques Neyssensas est né le 3 avril 1772 à Tamarelle, commune de Saint-Astier, fils de Jacques et Guline Garreau, il est baptisé par le curé Leynier.
Le départ de Jacques à destination de la frontière Espagnole
Engagé dans le conflit en tout début d’année 1794, Jacques, 20 ans, rejoint « l’armée des Pyrénées Occidentales, le bijou de nos armées » - Robespierre.
Lors de son déploiement au printemps 1793, l’armée des Pyrénées Occidentales compte 8 000 hommes, organisée en deux divisions, elles-mêmes regroupant 15 bataillons et 18 compagnies franches.
Mi-1794, ses effectifs atteignent 66 000 hommes, avec 32 bataillons, 3 des Basses-Pyrénées, 4 des Landes, 9 du Lot et Garonne, 7 de la Gironde et 9 de la Dordogne.
Ce que l’on ne sait pas : à quel corps les hommes de la 4ème division appartiennent ?
« La pagaille, l'anarchie qui régnaient alors, faisaient que le ministre de la Guerre ne savait plus où en étaient les unités, ni leurs emplacements, ni leurs effectifs et ce d'autant plus que, réfractaires à la discipline, les volontaires changeaient fréquemment, à leur gré, d'unités.
Ces bataillons de réquisitionnaires (on ne peut vraiment plus parler de volontaires) seront loin d'avoir la même tenue au feu que les premiers et ils seront souvent plus une gêne qu'un appui pour les années qui auront à les utiliser. En outre, qui pourrait compter ceux que la terreur faisait courir au combat préférant l'incertitude de la guerre à la certitude de la guillotine ».
Ce groupe de soldats n’appartient à aucun des bataillons de volontaires issus de la levée des 300 000 hommes, mais plutôt à un bataillon de réquisitionnaires « ces frères de dernière nécessité » comme les appellent le capitaine Jacques Antoine Dejean de la 7ème compagnie.
La 4ème division, squelettique, ne semble pas avoir fait l’objet de recherche historique vue son éphémère durée. Jean fut peut-être incorporé dans un autre bataillon par la suite puisque la durée du service à l’armée était de 3 ans.
Quelques jeunes gens de la liste du 24 nivôse an II
Arnaud Demignol, 18 ans, Paussac, tailleur de pierre,
Guillaume Descourts, 18 ans, Bourdeilles, tailleur de pierre,
Antoine Cruvelier, 21 ans, Bourdeilles, tailleur de pierre,
Pierre Privat, 18 ans, Grun, cultivateur,
Antoine Peyrat, 18 ans, Grun, cultivateur,
Antoine Lasjonias, 22 ans, Cornille, cultivateur,
Jerome Verdier, 21 ans, Le Change,
Jean Laschaud, 18 ans, Eyliac, tailleur d’habits,
Martin Sudrie, 19 ans, Blis et Born, cultivateur,
Jacques Migol, 24 ans, Milhac, cultivateur,
Jean Binet, 26 ans, Fouleix, cultivateur,
Jean Roussarie, 19 ans, la Chapelle Faucher, cultivateur,
Gerone Andrieux, 21 ans, Chancelade, cultivateur,
Jean Aupetit, 18 ans, la Chapelle Gonaguet, cultivateur,
Elie Bourgeois, 19 ans, Chancelade, cultivateur,
Jean Leynie, 19 ans, Eyliac, cultivateur,
Jean Roulaud, 19 ans, Le Change, cultivateur,
Jean Veyry, 19 ans, Bussac, cultivateur,
Pierre Larue, 24 ans, Bussac, cultivateur,
Pierre Gay, 22 ans, Bussac, cultivateur,
Pierre Barrière, 18 ans, Bussac, cultivateur,
Elie Laronze, 19 ans, Saint-Astier, cultivateur,
Jean Pecout, 18 ans, Léguillac de l’Auche, cultivateur,
Martin Bonnet, 22 ans, Chantérac, cultivateur,
Jean Sirieix, 23 ans, Saint-Astier, cultivateur,
Jean Neyssensas, 20 ans, Saint-Astier, cultivateur,
Jean Lacueille, 18 ans, Saint-Astier, cultivateur,
Pierre Jalage, 23 ans, Saint-Astier, cultivateur,
Jean Ricard, 19 ans, Bussac, cultivateur,
Jacques, 20 ans lors de son recrutement, mesure 5 pieds 2 pouces 9 lignes soit 1m 69.
Jacques Neyssensas, âgé de 30 ans, fils de Jacques Neyssensas et Aquiline Garreau, se marie le 28 pluviôse an onze (17 février 1803) à Saint-Astier, avec Marie Gibeau, 22 ans, fille de Jean Gibeaud et Marie Mazeau. Les témoins sont Anthoine Parot, cultivateur, 40 ans, Jean Petit, cultivateur, 40 ans, Léonard Mazeau, cultivateur, 30 ans, et Hilaire Dalesme, charron, 28 ans. De l’union au moins deux enfants naissent à Saint-Astier.
Le maire De Valbrune inscrit sur le registre de Saint-Astier, le décès de Jacques, le 25 septembre 1817, âgé de 45 ans, sur la déclaration de Martin Neyssensas, cultivateur, âgé de 33 ans, cousin germain du défunt, en présence de Jacques Garreau, cultivateur, âgé de 33 ans, son voisin, demeurant tous deux à Tamarelle. Les témoins déclarent Jacques, « décédé à onze du soir, fils de Jacques vivant et de Guline Garreau, décédée, époux de Marie Gibeau, vivante, âgée de 50 ans ». Martin signe l’acte et non l’autre témoin.
Récit extrait de : « l’Historique du 75ème régiment d’Infanterie » d’A. Gérôme, édité en 1891, des lettres du mathématicien Monge à sa femme, des Mémoires de Bourrienne, Ministre d’État de Bonaparte, des « œuvres de Napoléon Bonaparte » édité en 1821, et de sites Internet retraçant la Campagne.
« A bord de « l’Orient », Bonaparte entouré de Monge, Berthollet, élève sa main vers le ciel et montre les astres, et leur dit: « Vous avez beau dire, Messieurs, qui a fait tout cela ? ». Tandis que les grands personnages en uniformes ou habits à haut collet et cheveux noués à la vieille mode causent ainsi gravement astronomie, philosophie ou conquêtes d'Alexandre, les soldats imaginent d'une façon plus matérielle le pays des merveilles, fait d’illusions les plus singulières. Tous croient, en effet, trouver en Égypte les trésors et les délices poursuivis au Mexique et au Pérou par les compagnons de Cortez et de Pizarro ».

Selon Monge, « Bonaparte, 29 ans, le 1er juillet, se jette dans un canot, saute sur la plage et, roulé dans son manteau, s’y endort » pendant deux heures.
C’est à quatre lieues d’Alexandrie que Bonaparte, le 4 juillet, passe en revue les divisions réunies sur la plage, entre autre, la division Kléber composée de la 2ème demie brigade d’infanterie légère, des 25ème et 75ème régiments de bataille, soit environ un millier d’hommes. François fait parti de l’une des trois colonnes, ainsi composées qui se mettent en marche vers 2h30 du matin. A une demi-lieue d’Alexandrie, 300 cavaliers Arabes abandonnent les monticules de la ville et se dirigent vers le Caire.
François, à la pointe du jour, aperçoit la colonne de Pompée. Lorsque les troupes de Bonaparte parviennent à Alexandrie, ils découvrent une ville partiellement couvertes de ruines, seules les portes de Rosette et du Lotus accueillent encore de modestes artisans. Les caravansérails, les marchés, les mosquées et les bains sont presque totalement abandonnés.
Les Mamelouks s’ébranlent sans ordre et attaquent la flottille et l’armée de Bonaparte. Afin d’éviter les charges des cavaliers Mamelouks, Bonaparte dispose chaque division en carré avec six hommes en profondeur sur chaque face. Ces compagnies de grenadiers forment des pelotons flanquant ces carrés, l’artillerie Française se démasque alors et foudroie puis disperse l’armée adverse. C’est au pas de charge que l’armée enlève le village de Chébreiss. 70 soldats sont tués côté Français, environ 600, côté mamelouks.
Les troupes ainsi réunies, d’un assemblage incohérent de détachements de divers corps, dragons, hussards, chasseurs non montés etc.….. Et partagées en deux colonnes, pénètrent dans un petit village à proximité de Chébreiss, sans heurt.
Lors de la bataille de Chebreiss, on note dans l’Historique du 75ème régiment, le décès d’environ 34 soldats, et trois officiers blessés.
L’uniforme et le fusil du soldat François Leyssensac
François porte un habit très long, bleu, boutons dorés, col et épaulettes, poignets rouges, bicorne de feutre noir et cocarde tricolore, pompon blanc et rouge, gilet blanc, culotte de peau blanche, guêtres de toile blanche montant au dessus du genou. Les buffleries de la giberne, du sabre et de la baïonnette se croisent sur la poitrine.
L’armée Napoléonienne
Et l’infanterie de ligne
Période 1807 - 1813
Les registres matricules de l’armée Napoléonienne conservent les mémoires de
Jacques l’Astérien
Et
Coulaud, le Léguillacois.
Le Service historique de la Défense (Vincennes) conserve, sous les cotes GR 1 à 49 Yc, environ 25 000 registres de contrôles des hommes de troupes couvrant une période qui va de la fin du 17ème siècle, lorsque furent institués ces contrôles, jusqu’aux lendemains de la guerre de 1870, voire jusqu’à 1909 pour certaines unités. Source extrêmement précieuse pour la généalogie, l’histoire militaire et l’histoire sociale, ces registres recensent, par unité, tous les soldats et bas officiers ayant servi durant une période do
nnée.
Jacques l’Astérien
Découvrons tout d’abord le parcours militaire de Jacques Neyssensas.
Jacques, sans emploi, conscrit de l’an 1808, possède un visage ovale, un front « couvert », les yeux roux, le nez aquilin, une bouche moyenne, un menton pointu, des cheveux et des sourcils bruns ; de stature moyenne il mesure 1 mètre 67.
Il est engagé sous le matricule 6835 à 19 ans au sein de la 3ème légion de réserve de l’Intérieur et obtient le grade de fusilier le 30 juillet 1807. Le 1er janvier 1809, à l’âge de 21 ans, il est incorporé au 122ème régiment d’infanterie de ligne, 2ème bataillon, 4ème compagnie.
Les légions de réserve de l’Intérieur
Par décret du 20 mars 1807, Napoléon crée les Légions de réserve de l'Intérieur et fait appel, avec un an d’avance, à la classe de 1808. Jacques appartient aux milliers d’hommes d’unités toutes dépourvues d’esprit de corps et d’instruction, incorporés dans ces formations temporaires.
Mais bientôt Napoléon souhaite conquérir l’Espagne avec une armée de 110 000 hommes dont seulement 34 000 viennent de l’armée « régulière ». Tous les autres sont des conscrits ou des alliés.
Le 3 novembre 1807, Jacques, avec la 3ème et 4ème compagnies composées de 4600 hommes sous les ordres du général Dupont, passe à Bordeaux.
La grande armée parviendra peu à peu en Espagne en cette fin d’année 1807 et tout au long de l’année 1808….
Jacques est un survivant des champs de bataille, survivant parmi des milliers d’hommes qui n’avaient pas plus d’un an sous les armes.
Juillet 1808 - La bataille de Bailén, est le point culminant du soulèvement de l'Andalousie contre l'envahisseur français. C'est une victoire décisive des Espagnols et le premier échec important des armées Napoléoniennes.
Le 122ème régiment d’infanterie de ligne
Le décret du 1er janvier 1809 institua à Versailles, les 121ème et 122ème régiments d’infanterie de ligne formés par les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème légion de réserve.
28 jours après son incorporation au sein du 122ème, Jacques est blessé lors de la bataille de la Corogne en Galice et de la prise du port d’El Ferrol et hospitalisé le 29 janvier 1809.
La bataille de La Corogne est l'une des batailles de la guerre d'indépendance Espagnole qui opposa 16000 Britanniques, sous le commandement de Sir John Moore aux 16000 Français du maréchal Jean-de-Dieu Soult.
Après 5 mois d’hospitalisation Jacques décède à l’hôpital le 30 juin 1809.
"Le fait qu'il soit signalé comme "Rayé" dans le registre matricule le 30 juin 1809 ne signifie pas qu'il soit décédé ce 30 juin. Ce mot signifie simplement que ce soldat ne fait plus partie de l'effectif: soit parce qu'il est effectivement décédé; soit parce qu'il a été congédié ou démobilisé, soit parce qu'étant sans nouvelles de lui (prisonnier, disparu...) il a été décidé de le "rayer" souvent plusieurs mois après. D'ailleurs un certain nombre de soldats de ce régiment sont portés comme lui "rayé" à la même date du 30 juin. Ce que l'on peut dire c'est que Jacques est entré dans un hôpital peu de temps après la bataille de La Corogne, le 29 janvier, et qu'il y est sans doute décédé sans que le registre en mentionne la date et le lieu. Il est clair que dans ces conditions il était difficile de rédiger un extrait mortuaire !" Lionel Dumarche - 19/11/2021
Le 122ème sera dissout en 1814, à Rouen.
Coulaud, le Léguillacois
Un deuxième membre des familles Neyssensas est recruté en 1812 au sein de l’armée Napoléonienne.
Il s’agit de Coulaud Naissensas, né à Léguillac de l’Auche le 9 janvier 1791, baptisé par le curé Theulier.
Les parents de Coulaud, Sicaire Naissensas et Marie Rousseau sont métayers au hameau des Granges.
La métairie des Granges appartint tout d’abord aux Linard en 1647, Jean Rondet en 1765, puis après 1776, par mariage, la métairie passe aux Dumaine, à Léonard Dumaine plus exactement, l’un des acteurs de la Révolution à Léguillac.
Coulaud grandit dans la maison des colons et ses dépendances, grange, fournil, étable, jardin, terres labourables, près, vignes et bois. La famille Beyney, vers 1871, sera à son tour métayer du Sieur Dumaine. (ref : Françoise Raluy)
Coulaud est qualifié de laboureur, lors de son recrutement en 1811, et travaille les terres de la métairie des Granges avec son père.
Coulaud est incorporé le lendemain du décès son père, le 18 avril 1812, à la 62ème cohorte comme bien d’autres Périgourdins et Corréziens.
Les hommes recrutés sont des conscrits des classes 1812 et précédentes qui n’ont pas été incorporés dans l’armée active.
La destination de ces cohortes, de leurs gardes nationaux, n’est point affaire de « figuration sur les places des villages » mais bien tenir garnison en des lieux définis, hormis hors des frontières du pays.
Les gardes nationaux constituent une troupe aguerrie équipée d’uniforme identique à ceux de l’infanterie de ligne.
Peu de temps après la défaite Russe, l’Empereur décide de reconstituer la Grande Armée et, en janvier 1813, fait appel aux cohortes de la garde nationale en les transformant en 22 régiments d’infanterie de ligne. Ainsi se forme le 141ème régiment d'infanterie de ligne à Paris le 14 février 1813 avec, entre autres, la 62ème cohorte. C’est à cette date que Coulaud intègre le 141ème. La 62ème cohorte appartient à la 20ème division.
Réf : Mémoire des Hommes - SHD/GR 21 YC 932 - Registres matricules des sous-officiers et hommes de troupe de l'infanterie de ligne (1802-1815)
La campagne d'Allemagne en 1813
La campagne d'Allemagne débute immédiatement après la campagne de Russie de 1812 et précède la campagne de France de 1814. L’année 1813 constitue un véritable tournant de la guerre. Les États Allemands soumis par Napoléon, devant ses premières défaites, se retournent contre lui l'un après l'autre et se joignent à la Sixième Coalition autour de la Russie. Après la bataille de Leipzig, l'armée française vaincue doit se replier vers la France.
Bataille de Lutzen,
La bataille a lieu le 2 mai 1813. Le général Russe Wittgenstein attaque une colonne avancée de Napoléon près de Lützen, afin de reprendre la ville de Leipzig. Après une journée de combats intenses, les forces prussiennes et russes battent en retraite. L’absence de cavalerie empêche les Français de les poursuivre.
Bataille de Bautzen,
La bataille de Bautzen des 20 et 21 mai 1813, contre les troupes Russo-prussiennes commandées par Wittgenstein, est une victoire Française. Malgré les effectifs très supérieurs de l’armée Française et les mauvaises décisions de l’adversaire, Napoléon ne remporte qu’une victoire incomplète.
Bataille de Leipzig
Connue sous l’appellation de « bataille des Nations », est une des plus importantes batailles livrées au cours des guerres napoléoniennes entre les 16 et 19 octobre 1813.
Elle oppose une Armée en partie reconstituée aux forces Russe, mais aussi de la Prusse, de l'Autriche et de la Suède qui ont rejoint la Sixième Coalition contre Napoléon. Vaincue, la Grande Armée doit de nouveau battre en retraite, et réussit à traverser l'Allemagne et regagner le territoire français.
C’est le 18 octobre, à Mockau, front nord, que Coulaud est blessé.
La situation ce 18 octobre
Le général Blücher et le prince Bernadotte sont disposés au nord, les généraux Barclay De Tolly, et Bennigsen ainsi que le prince de Hesse-Hombourg au sud, et le feld-maréchal Autrichien Gyulay à l'ouest.
Le combat s'engage vers 6 h du matin. Vers 9 h, à Mockau, une brigade de cavalerie Saxonne, commandée par le colonel Lindenau, change de camp et se rallie aux Russes. Un peu plus tard dans la journée, une brigade de cavalerie Wurtembergeoise, commandée par Karl von Normann-Ehrenfels, passe du côté Russes, tandis que le gros de l'armée Saxonne continue le combat contre les Autrichiens.
La 9ème brigade Prussienne occupe le village abandonné de Wachau, tandis que les Autrichiens avec les Hongrois du général Bianchi repoussent les Français.
De tous côtés les alliés lancent l'assaut. En un peu plus de neuf heures de combat, les deux camps subissent de grosses pertes, les troupes Françaises empêchent la percée mais sont lentement repoussées vers Leipzig.
Le soir du 18 octobre, la bataille est perdue pour les Français : 320 000 soldats coalisés convergent autour de 170 000 Français pratiquement à court de munitions ; l'avant-garde de Blücher entre dans les faubourgs de Leipzig. Napoléon décide de retirer la majorité de ses troupes pendant la nuit en leur faisant traverser la rivière Elster. Le total des pertes est incertain. Prenant une évaluation de 140 000 au total, la coalition aurait perdu 90 000 hommes, Napoléon 60 000 soldats.
Parmi les disparus se trouve le maréchal Poniatowski, neveu du dernier roi de Pologne, Stanislas II, qui avait reçu la veille le bâton de maréchal, et les généraux Aubry, Camus de Richemont, Rochambeau et Couloumy.
La retraite de Napoléon permet de sauver l’armée. Il doit encore affronter les Austro-Bavarois qui tentent de lui couper la route à la bataille de Hanau les 30 et 31 octobre 1813, mais ne l'empêchent pas de se replier jusqu'au Rhin.
Les Alliés, épuisés, ne peuvent poursuivre les Français et ne peuvent transformer la bataille en victoire décisive. Napoléon perd les pays qu'il contrôlait en Allemagne, précieux réservoir d'hommes et de chevaux, et abandonne dans les places fortes de Dantzig, Glogau, Stettin, Dresde, Hambourg, un peu plus de 100 000 hommes et deux maréchaux de grande valeur, Davout, sûrement son meilleur maréchal en activité, et Gouvion-Saint-Cyr, qui lui manqueront pour la campagne de 1814.
Les églises de Liepzig sont transformées en hôpitaux de fortune, c’est peut-être l’un des lieux qui accueille Coulaud jusqu’au 20 octobre 1813.
on peut imaginer qu'il a été blessé et s'est retrouvé dans un "hôpital", lequel a été laissé à l'arrière lors de la retraite des Français quelques jours plus tard. Sans nouvelles de lui le régiment l'a "rayé" le 20 décembre. On peut comparer cette mention aux "sorts indéterminés" que l'on trouve pour cette période de 1813 dans les registres. Lionel Dumarche - 19/11/2021
En 1813, quelques 22 000 blessés de l’armée Napoléonienne sont hospitalisés sur les lieux mêmes des combats, dans les hôpitaux de Lützen, Bautzen, et Leipzig. Le typhus fait à nouveau des ravages parmi les restes de la Grande Armée qui arrivent à Mayence en octobre 1813. Sur 5 000 malades hospitalisés dans les hôpitaux de cette ville, près de la moitié est emportée par la maladie.
Jacques et Coulaud sont blessés lors de deux batailles perdues par Napoléon, l’une en Espagne, l’autre en Allemagne et décèderont à proximité des champs de bataille.
Jean Nayssensas conscrit de l’an 1815,
Résistant à la conscription et déserteur
Le site Geneanet met en ligne le 12 avril 2023 les fiches des conscrits du 76ème régiment d’infanterie de ligne de l'armée Napoléonienne enregistrés du 7 juillet 1813 au 1er aout 1814 pour les matricules 9601 à 11118 sous la référence HD/GR 21 YC 613 page 232.
Ses caractéristiques physiques : Jean mesure 1 m 62, son visage est plein, son front couvert, les yeux gris, le nez moyen, sa bouche est moyenne, son menton rond, ses cheveux et ses sourcils sont châtains. Jean ne présentent aucune marque particulière.
Jean, conscrit de l’an 1815, arrive au corps du 76ème régiment d’infanterie de ligne le 21 février 1814 puis il est affecté au 1er bataillon, 2ème compagnie, après son passage devant le conseil de révision.
Jean entame alors son voyage vers son unité d’affectation en contingent, escorté par des officiers et des gendarmes. Entre Mensignac et son régiment d’affectation, Jean parcourt un long, un très long voyage. Jean n’est ni enrôlé volontaire ni remplaçant d’un conscrit mais compris sur la liste de désignation du canton de Grignols sous le numéro 115. Son dernier domicile est Mensignac.
Jean déserte le 19 mai 1814, soit à peine 3 mois après son incorporation
La conscription
La conscription de 1815 concerne les jeunes hommes âgés de 20 ans nés en 1795. Elle est décidée en octobre 1813 puis retardée jusqu’en janvier 1814.
Pour mémoire, du 1er septembre 1812 au 20 novembre 1813, 1 527 000 hommes sont appelés.
Le 27 septembre 1813, l'Empereur signe un sénatus-consulte mettant en activité 280 000 conscrits : 160 000 de la classe 1815, 120 000 des classes antérieures de 1808 à 1814. En septembre 1813, à la veille de la reprise des hostilités, des régiments entiers sont exclusivement composés de conscrits réfractaires.
La conscription est improvisée dans le désordre et le chaos liés à l’invasion.
Depuis 1805 les préfets et les sous-préfets avaient la haute main sur la répartition du contingent.
En 1814 devant des « circonstances impérieuses » dont dépend « le salut de la France » les listes nominatives des conscrits nés en 1795 sont établies par les maires, sans tirage au sort, entre le 26 janvier et le 5 février. Jean Nayssensas est un jeune conscrit surnommé « Marie-Louise » baptisé ainsi parce que le décret qui l’a convoqué est signé par l'Impératrice Marie-Louise.
Les Maries Louises
En 1814, pendant la campagne de France, l’infériorité numérique de la Grande Armée la place dans une situation très difficile après les résultats cumulés des désastres de Russie en 1812, des pertes de la campagne d’Allemagne et de la stratégie Napoléonienne en 1813.
Combien de ces Maries-Louises ont réellement combattu après leur incorporation, à quelle date ont-ils participé aux opérations ? Après leur arrivée dans les dépôts, soit environ 25000 conscrits, un peu plus de 20000 sont versé dans la Garde impériale.
Les conscrits de 1815 servent en grande partie à compenser les pertes. Les premiers Maries Louises ne partent au feu qu’à partir de mi-février et surtout en mars. Leur préparation militaire est rudimentaire, deux semaines tout au plus, trois ou plus rarement quatre semaines. Jean, avec sa redingote grise et son bonnet de forme féminine, est soumis alors à la rude épreuve des marches de la campagne d’hiver, dans des combats où il se comporte honorablement peut-être même brillamment. Si son moral semble parfois fluctuant, on ne connaît pas chez les conscrits qui l’entourent de tentatives d’automutilation comme celles qui se sont produites après la bataille de Bautzen en 1813.
Les combattants de 1814, conscrits de 1815, n’apparaissent pas ou très peu dans les représentations guerrières et pourtant, comme Jean, ils sont jetés sur le champ de bataille à peine formés. Toujours est-il que les jeunes soldats sont très mal accueillis dans les dépôts, particulièrement à Courbevoie où passent 50 000 conscrits.
Situation du 76ème régiment de ligne entre janvier et mai 1814
Le Maréchal Soult raconte :
« Les pluies abondantes qui tombent en décembre 1813 et en janvier 1814 ont transformé la Nive, les gaves et 1'Adour en torrents impétueux impossibles à franchir. Les débordements de ces cours d'eau inondent la plaine et mettent sous l'eau les chemins de traverse. Début janvier j’en profite pour remettre de l'ordre dans mes unités et achève l'instruction poussées des nouvelles recrues. Le 16 janvier, le 1er bataillon du 76ème fait toujours partie de la 1ère brigade (Fririon) de la 1ère Division Foy.
Notre quartier général est à Bidache. Les soldats du 76ème cantonnent alors à Hastingues, sur les hauteurs de la rive droite du gave d'Oloron. Je fais disposer trois canons dans le cimetière pour défendre la plaine en contrebas et freiner l'avancée des troupes espagnoles et anglaises. Six cents soldats de l'armée napoléonienne et leurs chevaux vivent ainsi pendant huit mois dans la commune, logés et nourris par l'habitant. Le village en ressort durablement appauvri.
L’effectif du 76ème s’élève à 746 hommes dont 17 Officiers présents, 2 détachés à Bayonne, 2 à l'hôpital et 534 soldats présents, 7 détachés à Bayonne et 184 à l'hôpital.
En février, le froid augmente et de fortes gelées permettent aux alliés de passer les gaves sur la glace. Le 14 février, les Anglais attaquent notre aile gauche et craignant d'être contourné je me replie derrière le gave d'Oloron. Le bataillon franchit le cours d'eau à Sordes, le 16 février.
Les Alliés parvenus devant Sordes dès le 18 forment dans un premier temps le projet de franchir l'Adour au-dessus de Bayonne, puis en abandonnent l’idée et se portent de nouveau contre la gauche des Français. Ceux-ci abandonnent le gave d'Oléron et se portent sur Orthez derrière le gave de Pau, position moins étendue et plus aisée à défendre ».
Jean arrive à Orthez et incorpore le 76ème régiment le 21 février
« Le 26 février, toute notre armée se trouve unie autour d'Orthez dont les hauteurs présentent sur un front de trois kilomètres une succession de rideaux d'un accès assez difficile.
Bataille d’Orthez - 27 février 1814
Le 27 au matin, Wellington tente une attaque et nous la repoussons vivement à la baïonnette.
Wellington renouvelle l'attaque et parvient à nous mettre en déroute. Nous nous replions sur Saint-Sever.
Soult dit : « J'ai été attaqué aujourd'hui sur les hauteurs en arrière d'Orthez par toute l'armée ennemie. Les troupes se sont battues avec une grande valeur. Le village de Saint-Boès a été pris et repris 5 fois ; mais j'ai dû céder au nombre et retirer l'armée sur Sault de Navailles, d'où elle continue sa manœuvre vers Saint-Sever. Je ne vois pas de position où je puisse m'arrêter, ainsi je m'avancerai suivant les circonstances, afin de retarder autant que possible d'être obligé de passer la Garonne. Je ne connais pas encore le détail de pertes : l'acharnement a été tel qu'elles doivent être considérables. L'ennemi a aussi beaucoup perdu. Un officier anglais prisonnier m'a dit que plusieurs de leurs régiments étaient anéantis ». 5000 soldats décèdent lors de la bataille.
Le 1er mars l’armée d’Espagne est réunie sur l'Adour. Voici l'effectif du bataillon du 76ème :
678 - Officiers : 18 présents, 2 détachés à Toulouse, 3 à l’hôpital ; soldats : 473 présents, 12 détachés à Toulouse, 170 à l'hôpital. Nous avons perdu devant Orthez et perdu 61 hommes tués ou blessés.
Le 10 mars 1814, le 76ème est au centre d'Erlon. Le 12 mars, je concentre mes Divisions à Maubourguet et me porte en avant vers Aire dans l'intention d'attaquer l'ennemi que je suppose affaibli par l'envoi de ses forces sur Bordeaux. La forte position des Anglais et la nouvelle de l'évacuation de Bordeaux me pousse à me retirer le 16, avant le jour, sur Lembeye et, de là, sur Toulouse.
Notre marche à travers la plaine sablonneuse de Gers est très pénible pour mes troupes. Nous arrivons à Tarbes le 29 mars. L'arrière garde de l'armée française est attaquée vers midi, au moment où elle évacue la ville. Après une courte canonnade, elle se retire en bon ordre sur deux colonnes qui marchent toute la nuit. Elles sont guidées dans leur marche par des feux qu'on a allumés sur des hauteurs comme des points de direction.
Jean est sur le front ……
De là, je me dirige sur Toulouse par Saint-Gaudens et la Garonne. Voici notre situation au 1er avril 1814.
Pendant cette longue route d'Orthez à Toulouse, nos bataillons sont impressionnés par le mauvais vouloir des autorités, et l'hostilité des habitants. Lassées du régime impérial, les populations du Midi pressentent la chute de Napoléon et appellent de leurs vœux, avec le retour des Bourbons, la paix à tout prix. Les soldats indignés de ce manque de patriotisme se livrent au pillage et à tous les excès ».
« Je fais élever
autour de la ville une ligne de retranchements qui en font en quelques jours
une position formidable dans laquelle, avec 33000 hommes, nous allons livrer le
10 avril 1814 aux 60 000 hommes de Wellington une bataille
acharnée où la victoire reste indécise. Le bataillon du 76ème, occupe
la tête de pont construite en avant du pont des Minime et garde ce passage de
concert avec le bataillon du 31ème Léger établi dans le couvent. L’effectif
du 1er bataillon n'est plus à cette époque que de 465 présents.
Jean vient de participer à la bataille de Toulouse et vraisemblablement déserte quelques jours, quelques semaines après …. Et ne sera inscrit déserteur sur sa fiche que le 19 mai 1814.
Attaquée vigoureusement dès 7 heures du matin par les Anglais du Général Picton, la Division Darricau soutient les efforts de l'ennemi dans cette position jusqu'à 4 heures du soir. C'est le dernier acte de l'invasion. Le lendemain, la retraite est ordonnée pour onze heures du soir. Les troupes, munies de quatre jours de vivres, prennent en bon ordre la direction de Montpellier, pour se joindre aux 14000 hommes de Suchet. Le Corps d'Erlon forme l'arrière garde.
Le 12 avril, l'Armée française s'établit à Villefranche ; le 13 avril, elle prend position à Castelnaudary, puis se retire sur Avignon. Le bataillon du 76ème vient tout juste d'arriver à Castelnaudary le 13 avril, quand j’apprends l'abdication de Fontainebleau signée depuis le 4 avril. Un armistice est conclu le 19 et les hostilités cessent dans le midi de la France ».
Réf - Soldats de la Grande Armée - article et site de Mr Berjaud.
La plus inutile des batailles, près de 7000 morts et blessés en quelques heures à Toulouse, Napoléon avait abdiqué quelques jours auparavant …… le 10 avril 1814
Les évènements se précipitent
Le 2 avril 1814, le gouvernement provisoire déclare Napoléon Bonaparte déchu du trône. En 1814, l’effondrement du régime enraye rapidement le fonctionnement de la conscription,
Le 4 avril, les conscrits, les bataillons de nouvelle levée et les hommes des levées en masse sont libérés. Les conscrits de la classe 1815 sont autorisés à rentrer chez eux. Ceux de cette même classe qui n'ont pas rejoint resteront dans leurs foyers.
Le poids de la conscription en fonction des classes sociales, la désertion
C'est naturellement le monde rural qui paye le plus lourd tribut à la conscription.
Pourquoi Jean déserte le 19 mai 1814 ?
Les réfractaires désertent avant leur affectation, par attachement au pays natal, la peur de la mort ou des blessures, les déserteurs comme Jean quitte le champ de bataille « en cours de route ».
Géographiquement le phénomène le plus important de l'insoumission et de la désertion se situe dans le sud-ouest qui oppose une franche résistance à la conscription.
La fiche de Jean ne mentionne pas de jugement ou condamnation à une peine de travaux publics, voire une amende.
Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord - 1er janvier 1920
Un témoignage de l’esprit public dans la Dordogne en mars 1814.
« Le pays saturé de gloire mais saigné aux quatre veines ne voulait plus que la paix et il la voulait à tout prix. L’Empire avait fait ce miracle que l’étranger apparaissait presque comme un libérateur.
Dans le Lot la gendarmerie et les lettres de plusieurs citoyens me prouvent que la situation de ce département devient de jour en jour plus inquiétante. Il faudrait bien peu de choses pour y exciter un soulèvement général et nous n’avons aucune force à y envoyer. L’organisation de la Garde nationale est suspendue…. Le pays est à son comble de voir qu’on exige toujours de nouveaux sacrifices sans espoir d’obtenir la paix. La garde nationale de la Dordogne est organisée mais bien peu se présentent pour partir et nous n’avons aucun moyen de contraindre les refusants. Les conscrits ne partent pas, les désertions se multiplient, le recouvrement des contributions se ralentit, une résistance générale s’oppose à la perception des droits, les employés insultés et menacés n’osent plus se montrer dans les communes, les garnisaires se refusent au service, bientôt on ne pourra plus payer la solde des troupes.
Si l’ennemi se présente en Dordogne on ne pourra opposer que 4 à 500 hommes ».
Le curriculum vitæ de Jean Neyssensas
Jean est né le deux du mois de Ventôse an III (20 février 1795) à 8 heures du matin à Mensignac, hameau des Combaraux, des époux Jean Neyssensas, cultivateur et Jeanne Pisou, en réalité Pichon, en présence des témoins François Thomas et Mathieu Berger, cultivateurs. L’acte est enregistré par l’officier public Vedrenne.
Le mariage de Jean et Jeanne
La raison d’un prénom différent
« Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance » or le jour de son mariage, le 22 janvier 1816, le maire Jacques Dubesset ne reporte pas sur l’acte le prénom Jean mais celui de Jérôme.
Est-ce une erreur liée au niveau d’alphabétisation du maire, de sa disponibilité et de l’attention qu’il porta au document de référence, sans parler de la compréhension de ce qu’il lut sur le document précédent, tout cela est peu probable, en effet le prénom Jean est parfaitement lisible sur l’acte de naissance. On peut évoquer plutôt une absence de vérification de l’acte de naissance, le maire fit confiance à son oreille pour transcrire le nom que lui annonça le futur époux.
Dans ce cas Jean / Jérôme a peut-être craint que l’officier d’état civil ne fasse un lien avec Jean Neyssensas, déserteur du 19 mai 1814, quelques mois auparavant …… si ce n’est que l’officier d’état civil signant les actes tout au long de l’année 1814 et, ayant potentiellement connaissance de la désertion de Jean, était l’adjoint Simon et non pas le maire Dubesset dont la signature est extrêmement rare cette année-là.
Jean / Jérôme, « mineur de 20 ans », habite le hameau de Lambertie à Mensignac, avec ses parents. Il épouse Jeanne Bunlet, fille majeure de Jean Bunlet et Marguerite Roubenot, habitants le hameau de la Chazardie à Mensignac, née le 20 mars 1792.
Les témoins sont le Sieur Jean Alexis Deschamps, âgé de 39 ans, propriétaire habitant le château de Mesplier situé à une demi - lieue au nord de Château - l'Evêque, Mesplier est une demeure greffée au 18ème siècle sous une partie du 16ème. - Shap-1874
Autres témoins, Mery Lacoste âgé de 32 ans, cultivateur, Pierre Patissou, sonneur de cloche, habitants du bourg et Jean Pichard, 54 ans, cultivateur aux Planches.
En 1836, année du premier recensement de population à Mensignac, Jérôme retrouve son vrai prénom. Jean est âgé de 41 ans, Jeanne, 45 ans, Jeanne, 16 ans, Jean, 13 ans, Jeanne 8 ans, Marie Neyssensas, 38 ans, tante de Jean, et Jean Neyssensas, 72 ans, veuf et aïeul, tous colons.
Jean assiste aux obsèques de son père Jean dit Coutou, âgé de 91 ans, le 2 juin 1844, veuf de Jeanne Pichon. Coutou habitait le hameau de Lavaux à Mensignac. Les témoins sont Jean Simon dit Naillou, charpentier, 60 ans de la Jourdonnie, gendre du décédé et Jean Vedrenne, dit Lalit, cultivateur, 68 ans habitant Lavaux.
Jean Neyssensas, cultivateur, décède le 28 novembre 1867 à 4 heures du matin au hameau des Vignes à Mensignac, âgé de 72 ans fils de « parents dont on ignore le nom ».
Les témoins se nomment Jean Simon, 51 ans, et Sicaire Jugie, 52 ans, cultivateurs habitants des Vignes.
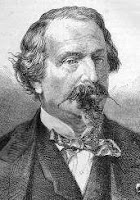 |
| Napoléon III |
 |
| Léon Bloy |
 |
| Aurelle de Paladines |
Le 22ème Régiment des Mobiles de la Dordogne, 1ère brigade, 2ème division, 16ème corps, intègre la 1ère armée de la Loire, et se dirige vers Tours par voie ferrée le 27 septembre 1870. Une colonne de 2000 gardes mobiles de la Dordogne défile dans les rues de Tours vers 9h00 du matin et parvient boulevard Heurteloup, accueilli par un discours officiel de l’homme politique Glais Bizoin.
Le 15 octobre, retour à Tours et départ le lendemain pour Vouvray, Amboise et Blois.
 |
| Ernest Gay |
Arrivé à Amboise, le lieutenant Ernest Guay, né à Excideuil le 27 avril 1847, participe à la distribution des nouveaux fusils « Chassepot », moderne pour l’époque, et d’une portée très supérieure à l’époque.« Dans ces vastes plaines, les balles des Chassepots pénètrent partout atteignant les hommes à des distances énormes, et sans qu’on puisse se rendre compte d’où elles viennent, tandis que l’artillerie Française ne cause presque aucun dégât». Plus de 80% des pertes infligées aux troupes adverses en 1870-71 ont été imputées, après la guerre, aux effets de ce fusil.
Pierre, âgé de 21 ans, décède à trois heures du soir, à Saint Laurent des Eaux, (aujourd’hui Saint Laurent Nouan), à « l’ambulance de l’instituteur ».
L’instituteur, François Célestin Boulains, 38 ans, et Cyprien Boulains, journalier, déclarent le décès de Pierre, célibataire, fils de Pierre Neyssensas et de (mère non indiquée). François et Cyprien Boulains, sont mentionnés témoins et amis de Pierre.
Ordre du général d’Aurelle et emplacements de l'armée de la Loire le 29 octobre 1870
 |
| Cathelineau |
Après la prise d’Orléans par les Bavarois en novembre 1870, la riposte s’organise côté Français.
Un autre Neyssensas : Sicaire
Le 28 juin 1914, à Sarajevo, un jeune nationaliste serbe originaire de Bosnie, Gavrilo Princip, assassine le couple héritier du trône austro-hongrois, le prince François-Ferdinand d'Autriche et son épouse la duchesse de Hohenberg. L'Autriche-Hongrie réagit à l'attentat en formulant un ultimatum à l'encontre du royaume de Serbie, en accord avec son allié allemand. L'une des exigences austro-hongroises étant jugée inacceptable par les Serbes, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Ce qui aurait pu n'être qu'une guerre balkanique de plus, dégénère en guerre mondiale par le jeu des alliances entre les grandes puissances européennes qui sont à la tête d'empires s'étendant sur plusieurs continents.
Les familles Neyssensas compteront 9 conscrits tués au front durant le conflit.
Chaque conscrit se voyait attribuer un numéro de matricule, correspondant au numéro de la page du registre tenu par l’armée dans lequel toute sa carrière militaire était inscrite : c’est à partir de ces documents de suivi individuel extrêmement riches déposés aux Archives de la Dordogne que les parcours des membres de no familles sont établis.
Pour chacun des décès ou prisonnier au front, un résumé des évènements du jour est présenté en caractère italique. Quelques fiches extraites du site de la Croix-Rouge complètent le récit de 4 années de conflit. Verdun, la Marne, l'Argonne, ou le chemin des Dames, mais aussi Salonique en Grèce, autant de noms qui résonnent du bruit des canonnades de la Première Guerre mondiale.
 |
| Astériens au temps de la guerre de 14-18 |
Le début de la guerre et la bataille de la Marne se déroule du 6 au 12 septembre 1914. Au cours de cette première bataille décisive, les troupes franco-anglaises réussissent à arrêter puis repousser les Allemands. L’ère de la « guerre des tranchées » est ouverte.
Saint-Astier
1914 : Paul Neyssensas, cultivateur, 1 m 69, degré d’instruction 2, sait lire et écrire. Paul nait à Jevah, commune de Saint-Astier, le 3 septembre 1893, fils de Joseph et de Marguerite Verninas. Paul est affecté au 108ème régiment d’infanterie de Bergerac sous le matricule 707 en qualité de Sergent. Paul décède le 8 septembre 1914 à Vitry le François lors de la bataille de la Marne, à l’âge de 21 ans. Paul est cité à l’ordre du régiment. « Gradé, brave et courageux, mort pour la France à son poste de combat ». Il obtient la Croix de Guerre, étoile de bronze, et sera inscrit au tableau spécial de la médaille militaire le 26 avril 1921.
 |
| Le drapeau du 108ème de retour du front - Paul en haut sur la photo au centre |
 |
| Le 108ème à Bergerac |
Extrait de l’historique du 108ème paru en 1919
« Le 6 août, cinquième jour de la mobilisation, le 108ème régiment d’infanterie, prêt à entrer en campagne, quitte sa garnison de Bergerac, petite ville pleine de soleil, de lumière et de gaieté, où la vie est facile, où il fait bon vivre, patrie de Cyrano, patrie de la bravoure ardente et gaie, turbulente mais sûre. Les fils seront dignes des pères : ils vont le montrer….. ».
La bataille de la Marne - dimanche 6 septembre à 9 heures
« Au moment où s’engage une bataille dont dépend le salut du Pays, il importe de rappeler à tous que le moment n’est plus de regarder en arrière ; tous les efforts doivent être employés à attaquer et à refouler l’ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer ; dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée ». Signé Joffre
Paul, le mardi 8 septembre 1914
« A 5h40, le 8 septembre, le 108ème est violemment attaqué sur tout son front. Il tient toujours dans Courdemanges, néanmoins ordre est donné au 126ème R.I. de se porter vers la cote 130. A 6h15, le Colonel Commandant la 47ème Brigade fait savoir, du Château de Beaucamp, que le 108ème est fortement engagé. La situation sur le front est sérieuse. L’artillerie ennemie en particulier tire avec une violence extrême. A 7h40, un aviateur est envoyé en reconnaissance pour situer exactement les positions des batteries allemandes. La cote 130 (Sud-ouest de Courdemanges) n’a pu être enlevé et le 108ème, dans Courdemanges est obligé de céder ».
 |
| Journal de campagne du 108ème le 8 septembre 1914 |
 |
| Courdemanges 1914 et Cimetière de Saint-Astier – 1990 |
Le 108ème régiment perd, entre le 6 et le 11 septembre 1914, 52 officiers et 2220 hommes.
Paul dit Jean Neyssensas porte la mention « tué à l’ennemi » par acte de décès établi par jugement du tribunal de Périgueux le 21 juin 1918 - Décès retranscrit à l’état civil de Saint-Astier le 12 juillet 1918.
Témoignage familial
Reine Bressolles - Taix, née en 1908, fille de Lucie Neycensas - souvenirs des familles Neyssensas de Jevah - Saint Astier vers 1914.
« En ce qui concerne les Neycensas, mon plus vieux souvenir est ma grand-mère née Catherine Simon mais appelée généralement « Philippine », son linge était marqué d’un F.
Je me la rappelle qu’immobile et sans parole dans son fauteuil de châtaignier près de la porte d’entrée de la maison de Jevah, détruite pour élargir la route. Elle était soignée par le grand-père Joseph Neycensas qui lui survécu 12 ou 13 ans.
Il y avait aussi cinq fils, tous mobilisés car c’était la guerre de 1914-1918, l’un deux, Paul n’en n’est pas revenu.
Robert, Suzanne, mon frère, Michel Bressolles, étions accueillis à bras ouverts dans leur maison pendant ces étés de guerre. C’était ce que l’on appelle une famille au grand cœur. Ma cousine Inès était pour moi une grande sœur et j’avais droit à quelques confidences ».
Mon dernier séjour à Jevah date de l’été 1919 ».
Le 8 septembre 1914, quelques heures après le décès de Paul, un autre Neyssensas, Astérien de naissance décède sur le front de la Marne.
1914 : Neyssenssas Jean nait le 10 aout 1891 à Saint-Astier, cultivateur, 1 m 57, degré d’instruction 2, sait lire et écrire. Jean est fils de Sicaire et Madeleine Petit. Jean est Caporal au 108ème régiment d’infanterie sous le matricule 389. Comme Paul, précédemment cité, Jean, 23 ans, décède le 8 septembre 1914 à Chavanges dans l’Aube à 3 heures du soir, de blessures de guerre dans l’ambulance numéro 7 du corps Colonial. Jean décède d’une « péritonite consécutive à une plaie de la région lombaire ». Jean obtient la médaille militaire le 13 janvier 1921. « Sous-officier brave et courageux. Grièvement blessé en montant à la contre-attaque des positions ennemies. Mort des suites de ses blessures le 8 septembre 1914 ». Retranscrit sur le registre de Saint-Astier le 1er janvier 1915.
 |
| Communication à la famille - Croix rouge |
En garnison à Bergerac au moment de la mobilisation d'août 1914, rattaché à la 47ème brigade d'infanterie de la 24ème D.I., le régiment reste à la 24ème D.I. jusqu'en novembre 1918 et sera notamment engagé sur le front italien. Jean est mentionné sur le monument aux morts de Saint-Astier.
Le retour du corps de Jean en 1922
Le site de l’Association des Anciens Militaires de Saint-Capraise de Lalinde détient la liste des corps rapatriés entre 1921 et 1926 pour le département de la Dordogne.
Le corps de Jean, noté Paul sur le site, est rapatrié le 28 décembre 1922 par train, arrivé en gare de Périgueux avant de repartir pour Saint- Astier, la commune de destination du corps. Le convoi est le n°45. Jean dit Paul Neyssensas porte le n° 39. Le corps a été demandé par Monsieur Neyssansas Sicaire résidant au Pigat à Saint-Astier. Sicaire est fils du couple Jean et Jeanne Duranthon de Davaland : Saint-Astier.
La famille du Pigat, endeuillée, demande le rapatriement du corps de Jean dans le caveau familial à Saint-Astier, après la parution de la loi du 31 juillet 1920. Jean n’est pas resté seul sur le champ de bataille comme des milliers d’autres mais enseveli provisoirement dans un cimetière militaire dans la Meuse en zone de combat. 240 000 soldats sont rapatriés à partir de l’été 1922.
« En outre les conditions si particulières du combat ont en effet multiplié dans tous les camps le nombre des disparus et de ceux dont les corps n’étaient pas identifiables le chiffre représente dans le cas Français près un cadavre sur deux. Leurs proches ne purent alors jamais disposer d’une tombe pour se recueillir, d’une sépulture pour commencer leur deuil, à l’exception des ossuaires comme celui de Douaumont et surtout de la tombe de l’Inconnu qui prit dès lors en France, en Angleterre, en Italie, son véritable sens.
La souffrance extrême des agonies au front ajoute une composante particulière, la douleur des proches. Les familles devinent fort bien cette souffrance comme elles devinent ce que furent la solitude animale et angoissante des agonisants. Dès lors on comprend l’insistance des familles, dans leurs courriers adressés aux camarades ou aux supérieurs hiérarchiques, de connaitre les derniers moments, quelles ont été les circonstances exactes de la mort, Quelles blessures, Quelles souffrances.
On veut savoir aussi si celui que l’on pleure était seul pour mourir, s’il a pu être enseveli, et, dans ce cas le lieu de sa sépulture. Il s’agit ainsi de tenter de combler la lacune terrible de l’absence de tout accompagnement des mourants. La blessure, l’agonie la mort, cette lacune qui porte sur quelques heures, sur quelques jours le plus souvent, mais qui semble avoir torturé les survivants et leur a rendu le deuil si difficile et parfois impossible.
On mesure mieux ainsi l’épreuve de ceux qui ne retrouvèrent jamais de corps à enterrer. Pour eux il n’y eut jamais un avant et un après, un avant et un après la visite sur la tombe du champ de bataille, un avant et un après le retour du corps, un avant et un après la réinhumation.
Décidément la spécificité des deuils induits par le conflit de 1914-1918 revêt une importance capitale pour la compréhension des conséquences de la mort de masse au sein des sociétés européennes ». Extrait de « Corps perdus, corps retrouvés ». Par Audouin-Rouzeau.
1915 : Neyssensas Alfred, nait à Saint-Astier le 22 février 1892, fils de Guillaume et Madeleine Peyrouny, cultivateur. Son degré d’instruction est de 2, soldat de 2ème classe au 108ème, Alfred porte le matricule 79. Blessé au bras gauche par éclat d’obus le 28 septembre 1914 à Suippes près de Reims, Alfred puis passe au 412ème régiment d’infanterie le 1er mars 1915. Alfred décède lors de la 3ème bataille d’Artois, le 25 septembre 1915, devant Thélus au combat de Roclincourt dans le Pas de Calais, lieu-dit Noyelette, à l’âge de 23 ans.
Le 412ème régiment d'infanterie est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française constitué en 1915 avec des blessés guéris et des éléments provenant des dépôts de la 12ème région militaire (Limoges) avec entre autres un 2ème bataillon composé notamment du 108ème. Cependant sur la fiche du site « mémoire des hommes » Alfred est mentionné appartenant au 63ème régiment d’infanterie, effectivement présent à Thélus.
La journée du 25 septembre 1915 en quelques mots……
En Artois, après un mois très agréable de repos à Rubempré, le 63ème se rend, par camions automobiles, dans la région de l'ouest d'Arras. Le 1er août, il s'installe dans le secteur de Roclincourt, à cheval sur la route d'Arras à Lille. Il va l'occuper pendant huit mois. Il y méritera le renom de régiment « tenace et résolu » qui lui sera reconnu officiellement à la fin de la guerre.
Les trois bataillons accolés tiennent un front de 1200 mètres : la ligne avancée est distante de 20 à 200 mètres de l'ennemi ; on se touche presque par endroits. En avant, le chaos de craie et de boue retournée où est retranché l'ennemi va buter contre la crête de Thélus, qui barre la route du bassin de Lens. Le secteur est, par excellence, le secteur des mines. Une lutte sévère se poursuit entre sapeurs français et allemands. Huit fois en six semaines, les Allemands font sauter la mine et tentent de détruire notre première ligne. Le régiment a la chance de s'en tirer sans accidents graves. Il peut ainsi achever d'importants travaux, pousser en avant une vingtaine de sapes et les relier par une parallèle de départ. C'est la préparation de la grande offensive.
Un rôle important est réservé au 63ème. Il attaquera en tête de la brigade, ses trois bataillons accolés, échelonnés en quatre vagues de six pelotons chacune. L'objectif premier est la tranchée du Paradis, dont la conquête permettra l'attaque ultérieure de la crête 132 et des bois de Farbus. L'attaque devra avoir « le caractère d'une ruée ».
Le travail de notre artillerie dure huit jours : il est formidable. Le 25 septembre, à midi 25, toutes les vagues s'élancent dans un ordre parfait.
A l'aile gauche (1er bataillon), les deux premières gagnent la ligne ennemie (tranchée des Punaises), devant laquelle tombe le commandant Bonnal. Elles repartent, enlèvent la deuxième (tranchée des Cafards), la dépassent et ne s'arrêtent que devant d'infranchissables réseaux demeurés invisibles. Les deux autres vagues nettoient les positions conquises et font des barrages.
Mais, aussitôt, de tous les boyaux adjacents, les Allemands débouchent en masse et contre-attaquent à la grenade. Nos hommes, leurs munitions épuisées, résistent avec une énergie prodigieuse pendant deux heures. Tous les officiers sont frappés. Au centre, même lutte ardente. Le bataillon de droite est tombé sur un réseau à peine entamé. Le commandant Baston est tué en tête de ses hommes. Quelques fractions franchissent néanmoins la première ligne et se battent jusqu'à épuisement. Deux fois dans l'après-midi, on essaye de reprendre l'offensive.
Tous les efforts se brisent contre une barrière de feux opposée par des forces supérieures et sans cesse alimentées. Dans cette très dure journée, le régiment a perdu 2 chefs de bataillon, 8 commandants de compagnie, 31 chefs de section, un millier d'hommes. Mais il a fait subir aux Allemands de grosses pertes. L'ennemi avait accumulé sur ce point, jugé sensible, la plus grande partie de ses forces engagées dans la région d'Arras, ce qui a permis de remporter, sur ce même front d'Artois, des succès marqués. La journée a été très glorieuse. Il faudrait un long chapitre pour conter les actes de bravoure accomplis le 25 septembre ». Historique du 63ème
Montrem
1917 : Neyssensas Henri nait le 28 septembre 1896 à Montrem, fils d’Elie et de Germaine Fargeot, cultivateur, 1 m 57. Son degré d’instruction est de 0, ne sait ni lire ni écrire, Alfred est soldat de 2ème classe, 1er régiment d’infanterie, et porte le matricule 65.
Henri est au combat lors de la bataille du Chemin des Dames, aussi appelée seconde bataille de l'Aisne ou « offensive Nivelle ».
Le chemin des Dames doit son nom à Adélaïde et Victoire, filles du roi Louis XV et donc Dames de France. Elles empruntaient ce chemin de plaisance, qui a été empierré pour rendre visite à leur gouvernante et dame d’honneur, Mme François de Châlus, au château de la Bove à Bouconville-Vauclair.
« A la tête de l’armée françaises depuis le début de la guerre, le général Joffre est remplacé le 13 décembre 1916 par le général Nivelle (originaire de Tulle) alors qu’après l’échec des offensives d’Artois et de Champagne en 1915 et dans la Somme en 1916, il a préparé le plan d’une nouvelle offensive entre Soissons et Reims pour le début de l’année 1917.
Le 16 avril 1917, en pleine nuit, dans le froid et même la neige, Nivelle engage un million d'hommes, des milliers de canons et les tout premiers chars de combat.
Réveillées à 3h30, les premières vagues s’élancent à 6h00 du matin à l’assaut du plateau du Chemin des Dames, elles se heurtent à des barbelés souvent intacts et elles sont fauchées par le feu des mitrailleuses allemandes.
L’offensive est un désastre. Le 20 avril, le général Nivelle arrête les opérations. 134000 hommes, dont 30 000 tués pour la semaine du 16 au 25 avril, sont tués, blessés ou disparus pour un gain de terrain dérisoire. Le général Nivelle, généralissime et commandant en chef des armées françaises pendant la Première Guerre mondiale en 1916 et 1917 est relevé de ses fonctions en mai 1917, en raison des controverses encore vives aujourd'hui autour de ses options stratégiques, particulièrement meurtrières notamment au Chemin des Dames. Innocenté, il sera nommé, en décembre 1917, à la tête du 19ème corps d'armée en Afrique du Nord, et entra au Conseil supérieur de la guerre en 1919.
Pétain prend la place de Nivelle à la tête du grand quartier général français, le 15 mai 1917, au moment où éclatent les premières mutineries, signe de désespoir et de découragement dans une partie des troupes françaises.
S’il ne mourait pas sur le champ de bataille, le poilu mourait à l’hôpital de Prouilly dans la Marne, faute de soins.
Les blessés trop atteints étaient laissés de côté. On n’opérait que pour des interventions qui ne devaient pas dépasser les 30 mn. On laissa sans soin des milliers de blessés, parfois sans pansement en côtoyant les morts…. Du 16 au 21, Prouilly reçoit près de 12000 blessés dont 7 000 le 17 avril, le 17 avril à 15 h, Prouilly est encombré de 5700 blessés en attente ».
Henri meurt à l’âge de 21 ans, le 25 avril 1917 à 18 h 00 de blessures de guerre à l’hôpital de Prouilly, lieu où se déroule un véritable drame sanitaire. Inhumé dans un premier temps dans le cimetière de l’hôpital, fosse 282, Henri est inhumé, à nouveau, dans la nécropole nationale de la Maison bleue à Cormicy dans la Marne - Tombe n° 5257. Le 12 juillet 1917, le père du défunt perçoit un « secours » de 150 francs.
 |
| (mi-1917 entre la ferme Hurtebise et Craonne) |
Henri est mentionné sur les monuments aux morts de Montrem et Saint-Astier
Du 20 mai à fin juin : le front sera secoué par des mutineries qui affectent plus de 150 unités. Ces refus d'obéissance concerneront des troupes au repos que l'on veut renvoyer à l'assaut.
Saint-Astier
1918 : Neyssensas Emile-Georges, nait à Saint-Astier le 19 janvier 1890, fils de Jean et d’Anne Doche, cultivateur, domicilié au Perier, célibataire. Exempté pour goître en 1911, finalement appelé au combat le 22 mai 1917, marsouin, soldat de 2ème classe au 37ème régiment d’infanterie coloniale basé à Bordeaux.
« Les Poilus d’Orient », ceux que Clemenceau appelait avec mépris « les jardiniers de Salonique » leur reprochant longtemps leur inaction. (Images entre autres véhiculées par la présence de plants de salades cultivés en périphérie de Salonique par les poilus dans le but d’éloigner le scorbut, mais aussi par les cartes postales de l’époque où le poilu déambule dans les rues en agréable compagnie).
« Sur les quelques 400 000 soldats qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale dans les Balkans, dont 70 000 ne sont pas revenus, près de 290 000 sont ainsi tombés malades.
Face aux forces de la Triple Alliance, les poilus ne doivent pas seulement lutter armes à la main, mais aussi essayer de survivre dans des conditions extrêmement difficiles et propices aux épidémies. La présence de marais, la malaria, les moustiques, la dysenterie et le typhus provoquent une hécatombe dans les rangs des soldats. A la chaleur accablante des étés succèdent les hivers glacials …. Entre 1916 et 1918, la moitié des soldats français, dont Emile, se trouve dans des tranchées sur de hautes collines ou dans des montagnes à environ 1 000 mètres d’altitude, d’où la difficulté pour les blessés d’être acheminés vers les hôpitaux. Finalement l’histoire retiendra Verdun ou le Chemin des Dames, et oubliera les autres fronts ».
Emile est inhumé dans le cimetière militaire de Zeitenlik - Tombe 7676
Saint-Léon sur l’Isle
Une fratrie décimée au combat
Une tragédie humaine emblématique de la tuerie que fut la Grande Guerre
Retraçons, tout d’abord, le parcours de vie des parents de Jean, Roger et Jean décédés au front, nés à Saint-Léon sur l’Isle entre 1883 et 1892 à l’aide des registres paroissiaux et des recensements.
Le père, Martin Neyssensas, dit « Duranthon » est né à Davaland le 21 janvier 1854. Martin, cultivateur, se marie avec Catherine Gouzou à Saint-Astier le 18 avril 1882. Le couple a 9 enfants nés entre 1883 et 1896, lieux-dits Puypinssou et La Valade à Saint-Léon sur l’Isle.
Martin et ses 7 frères et sœurs sont enfants de Jean Neycensas (1814-1889) et Jeanne Duranthon (1820-1881). Le couple Jean et Jeanne s’est installé à Davaland entre 1841 et 1846. Voir recensement de 1846 à Saint-Astier.
Martin est petit-fils de François et Marguerite Simonet, arrière-petit-fils de Martin et Anne Doche, tous descendants de Charles et Tamarelle Marguerite du hameau de Tamarelle à Saint-Astier depuis 1677 et bien avant, de Guirou, du hameau de la Font-Chauvet à Léguillac de l’Auche.
Quatre enfants naissent dans le hameau de Puypinssou
Le couple quitte Saint-Astier et s’installe dès 1883 dans le hameau et rejoint ainsi son cousin Sicaire, fils de François et Marie Duranthon, époux d’Anne Poumeyrol, habitants à Puypinssou peu de temps avant la naissance de leur premier enfant Sicaire-François-Gaston nait le 2 septembre 1882 (décès le 2 avril 1961). Le couple s’est marié à Tocane Saint-Apre le 14 février 1875 et aura 10 enfants.
L’habitation de Martin à Puypinssou appartient à la tante de Catherine Gouzou, Catherine Sirouze qui la possède de ses pères et mères, Sicaire Sirouze et Marguerite Peyrouny et ce depuis au moins 1836. Le patronyme Sirouze apparait pour la 1ère fois en 1737 à Montrem et signifie « lieu pierreux », dérivé Cirouze, Chirouze - nom d’une commune de Corrèze.
En 1861, Catherine, mariée avec Pierre Reymondie, travaillent leurs terres accompagnées d’un enfant de l’hospice de Périgueux âgé de 12 ans, Etienne Dubreuil. Le couple cohabite avec Sicaire Sirouze, veuf de Laronze Anne, âgé de 65 ans. En 1866, Sicaire est décédé, Etienne, 17 ans, est toujours présent avec le couple.
En 1881, peu de temps avant son mariage Catherine Gouzou, vit toujours avec Catherine Sirouze veuve Reymondie. Puypinssou est composé de 7 maisons, 7 ménages et 30 individus.
En 1886, Puypinssou est habité par 42 personnes. Le hameau se compose de 8 maisons et 8 ménages. Martin et son épouse vivent au côté de Catherine Sirouze, 56 ans, et leurs trois enfants. Le cousin de Martin, Sicaire, son épouse Anne Poumeyrol, élèvent à présent 4 enfants.
Le premier enfant de Martin et Catherine Gouzou, Jean, nait le 6 mars 1883. Sicaire dit « Roger » nait le 27 aout 1884 et décède le 14 juillet 1890 à l’âge de 6 ans. Jean nait le 18 mars 1886. Marie-Angèle nait le 17 juin 1888 à Puypinssou et décède à la Valade le 12 novembre 1890 à l’âge de 2 ans.
La famille s’agrandit, Martin et sa famille quittent Puypinssou début 1890 pour la Valade à un peu moins d’un kilomètre de là. Catherine Sirouze conserve son habitation à Puypinssou et vit à présent seule.
Le cinquième enfant du couple, Marie, nait le 20 avril 1890.
En 1891, le recensement de Saint-Léon sur l’Isle indique à la Valade la présence de Martin, 38 ans et Catherine, 27 ans, propriétaires, Joseph-Jean âgé de 7 ans (1883), Jean 5 ans (1886), Marie 11 mois (1890) et Catherine Sirouze âgée de 67 ans, tante. Marie-Jean Alleminge, 16 ans, de l’hospice de Périgueux, cultivatrice, seconde le couple pour les travaux du quotidien. La Valade est composée de 5 maisons et 33 personnes. Les familles citées sont les Lavaud, Raymonde, Mazière, Reymondie et Neycensas.
Un sixième enfant, Roger nait le 22 janvier 1892. Jean nait le 1er février 1894 et décède le 11 octobre 1894 à l’âge de 9 mois. La dernière enfant, Marie nait le 4 avril 1896, 7 mois après le décès de son père Martin. Sa mère Catherine Gouzou est alors âgée de 32 ans.
Martin décède le 17 septembre 1895 à l’âge de 41 ans après un été exceptionnellement chaud et sec. La pandémie de 1889-1890 dite grippe « russe » est la première dont on peut démontrer la dissémination sur l’ensemble du globe. L’un de ses caractères les plus marqués tient aux récurrences de l’infection, lesquelles, jusqu’en 1895, occasionnent une mortalité supérieure à celle causée par la pandémie initiale. Martin a-t-il été victime de l’épidémie ?
Catherine Gouzou décède le 19 avril 1896 des suites de l’accouchement, 15 jours après la naissance de Marie et 7 mois après le décès de son mari.
En ce temps-là, la moyenne de vie est de 38 ans et 8 mois pour les hommes et 40 ans et 5 mois pour les femmes. Catherine Gouzou fait partie de la tranche de mortalité maternelle la plus élevée entre 30 et 34 ans soit 13% des décès maternels.
En 1901, après la disparition du couple Martin et Catherine, le 2ème recensement indique à nouveau la présence de Catherine Sirouze âgée de 73 ans, à présent en charge des enfants orphelins de Martin et Catherine, Joseph, 18 ans (1883) en réalité nommé Jean à l’état civil, cultivateur, André, 15 ans (1886) en réalité Jean à l’état civil, cultivateur, Noélie, 10 ans (1890) en réalité Marie à l’état civil et Rosa, 4 ans (1896) en réalité Marie à l’état civil. Roger 9 ans n’est pas mentionné sur le recensement.
Le 24 mars 1907, Catherine décède à son domicile à l’âge de 78 ans, à la Valade. Joseph Neyssensas, 24 ans, et Louis Mazière, 52 ans, cultivateurs à la Valade sont témoins.
Durant 11 ans Catherine s’occupa des enfants des défunts Martin et Catherine
En 1901, le cousin de Martin, Sicaire dit Grégoire, 54 ans et Anne Poumeyrol, 46 ans, habitent toujours Puypinssou avec François-Gaston, 18 ans, Hélène, 15 ans, tous cultivateurs.
En 1911, seul le couple Jean, futur poilu, et Marie Javerzac habite encore le lieu-dit la Valade.
Marie, la dernière fille de Martin et Catherine, épouse Blaise Peytoureau le 24 avril 1919 à Saint-Léon sur l’Isle.
Les enfants de Sicaire et Anne Poumeyrol se marient après 1899 : Anne-Marie à Saint-Astier en 1900 avec Jean Mazière, Sicaire-François-Gaston en 1907 à Saint-Astier avec Emilie Marie Neyssensas, en 1911, le couple a deux enfants, Augusta et Julien et Hélène-Joséphine en 1907 à Saint-Léon sur l’Isle avec Antoine Millaret.
Disparition au front de la fratrie
1914 : Jean Neyssenssas nait à Saint-Léon sur l’Isle le 6 mars 1883, cultivateur, fils de Martin et Catherine Gouzou. Jean est époux de Marie Javerzac. Ils se marient le 8 juin 1808 à Grignols. Le couple habite encore, en 1911, à Saint-Léon sur l’Isle, le lieu-dit la Valade - recensement de population de 1911. A la Valade, 5 familles se côtoient, les Reymondie, Maze, Lavaud, Mazière et Neyssensas. Les autres Neyssensas ont quitté Saint-Léon sur l’Isle.
La fiche de recrutement décrit Jean ainsi : taille 1 m 51, cheveux et sourcils, bruns, les yeux gris bleu, le front couvert, nez et bouche moyenne, menton rond et visage ovale, degré d’instruction 3, sous le matricule 88. Arrivé au 50ème régiment d’infanterie en 1904, Jean est dispensé en tant que « ainé d’orphelins ».
Peu de temps avant le début de la guerre un enfant nommé Camille nait le 23 septembre 1912. Camille se mariera avec Lucienne Lespinasse le 16 avril 1936.
À la déclaration de guerre, le 50ème est caserné à Périgueux commandé par le colonel Valette. Il fait partie de la 47ème brigade, de la 24ème division d'infanterie subordonnée au 12ème corps d'armée. Il s'articule alors en 3 bataillons comportant chacun 4 compagnies numérotées de 1 à 12 et comprend 3 sections de mitrailleuses. Le recensement des effectifs fait état de 3391 hommes répartis en 55 officiers, 220 sous-officiers et 3116 caporaux et soldats. En outre, l'unité comprend 179 chevaux et mulets.
Appelé à la mobilisation générale le 1er aout 1914, Jean, 31 ans, soldat, disparait au front le 19 septembre 1914 à Auberive dans la Marne. Par jugement déclaratif à Périgueux du 13 juin 1920 et à la demande de la famille Neyssensas, le décès est fixé en date du 19 septembre 1914.
« Le 1er août 1914, vers 17 heures, à la caserne Bugeaud de Périgueux, se produit un mouvement insolite. Sans avoir été appelés par aucune sonnerie, officiers et hommes de troupe accourent de tous les côtés vers le chef de bataillon Blondont qui descend du bureau du Colonel, un papier à la main. Quelques instants avant, un planton du Colonel est venu à la salle de service, avec un air plus grave que d’habitude ; aussitôt le chef de bataillon de service est monté vers le bureau. Tout le monde s’attend à la grande nouvelle. Le commandant s’arrête près du pédiluve. On fait cercle. Il dit « Attendez un peu, du calme, tout à l’heure je vous permettrai un cri, un seul. » Il lit l’ordre de mobilisation générale. Puis il ajoute : « Et maintenant, Vive la France ! » Et la foule des soldats répète, en un cri immense, joyeux et enthousiaste : « Vive la France ! ».
Le régiment est depuis le 13 septembre devant Auberive, dans les tranchées. Aubérive, nom sinistre dans l’histoire du 50ème. Du 19 au 30 septembre, le régiment attaquera quatre fois, toujours avec la même ardeur, la même abnégation. Mais il se heurtera à des positions organisées, munies de mitrailleuses, défendues par des feux croisés d’artillerie, ayant d’excellentes vues sur toute la zone qui les précède. Sûr de son feu, l’allemand restera d’abord silencieux devant la progression. Mais quand cette progression lui paraîtra devenir dangereuse, alors il déclenchera ses rafales de mitrailleuses et de 77 qui cloueront l’attaque sur place. Ainsi le 19, le 20, le 24, le 30 septembre.
 |
| L’auberge de l’Espérance à Auberive |
Que peut faire Jean Neyssenssas, que peuvent faire les hommes les mieux trempés, obligés de marcher à découvert, sur un véritable glacis, contre une position ainsi organisée et défendue ? Si encore notre artillerie pouvait nous soutenir efficacement ! Mais les artilleurs n’ont plus d’obus ! On attaque cependant parce que c’est l’ordre et que le commandement sait, lui, tout le résultat important de ces attaques d’apparence infructueuse.
Il s’y est maintenu malgré le tir violent et précis de l’artillerie allemande. Chaque jour, il a progressé, fortifiant le soir le terrain conquis. Jamais un pouce de terrain n’a été abandonné.
Le régiment a arrêté net le 26 septembre les attaques de l’ennemi. Le 30 septembre, il s’est porté, par un magnifique effort jusqu’à la lisière Aubérive ; il n’a été arrêté que par les réseaux de fil de fer et par le tir de mitrailleuses et d’artillerie d’une intensité inouïe. Malgré les pertes éprouvées et bien que tous les officiers du 1erbataillon fussent tués ou blessés et que la plupart des gradés fussent hors de combat, les survivants se sont maintenus inébranlablement jusqu’à la nuit. Les actes d’héroïsme individuels ont été nombreux dans le régiment. Beaucoup restent inconnus ».
Jean est cité de manière posthume le 18 mai 1922, « brave soldat, s’est fait remarquer par son dévouement et son courage. A été tué le 19 septembre 1914 à Auberive en se portant vaillamment à l’attaque de ce village » - Jean obtient la Croix de guerre avec étoile d’argent.
1914 : Jean Neyssensas nait le 18 mai 1886 à Puypinssou, commune de Saint-Léon sur l’Isle, cultivateur, fils de feu Martin et Catherine Gouzou. Jean est l’époux de Marthe Héritier depuis le 8 février 1912, habitants Manzac sur Vern. Le couple a un enfant, Roger, né le 16 avril 1913, marié à Ménesplet le 29 mai 1937, décédé le 30 décembre 1954 (?) à Manzac.
Arrivé au corps suite à la mobilisation générale du 3 aout 1914, Jean est soldat de 2ème classe au 108ème régiment d’infanterie et porte le matricule 677. Jean mesure 1 m 54 avec un degré d’instruction de 3 avec une instruction primaire plus développée.
Jean est « tué à l’ennemi » le 28 aout 1914 à Moislains dans la Somme à l’âge de 28 ans. (Source Allemande du 9 octobre 1915). Après jugement du 4 mars 1922 à Périgueux, l’acte est retranscrit sur l’état civil de Manzac le 12 avril 1922.
« Le 28 août 1914, une terrible bataille décime les troupes du 307ème et 308ème d’Angoulême commandées par le colonel Gary. Le 308ème régiment d'infanterie est constitué en 1914 avec les bataillons de réserve du 108ème régiment d'infanterie. Envoyé « à marche forcée » au nord de la Picardie, le 308ème a pour mission de retarder l’avancée allemande sur Paris et d’éviter l’encerclement d’un corps expéditionnaire anglais fort de 74000 hommes. Piégés sur une plaine bordée de bois, en pantalon rouge garance, Jean au côté des réservistes tombe en plein champ, le matin du 28 août, tous « tirés comme des lapins ».
A 7 h 30, la tête de la colonne atteint la ferme du Gouvernement, installée entre les bois de Saint-Pierre Vaast et celui de Vaux. Vers 8 heures, les dragons viennent buter sur les avant-postes ennemis. Des deux côtés, on échange des coups de fusil.
Les combattants tirent au jugé tant le brouillard est dense. Vers 9 heures, les patrouilles détachées du 307ème reçoivent l’ordre d’avancer vers les lisières du village. Là, les éclaireurs se trouvent confrontés à des cavaliers allemands contre lesquels ils doivent croiser la baïonnette. Les fantassins allemands ouvrent le feu et un déluge d’obus s’abat sur les deux compagnies qui se rabattent sur le bois de Vaux. Deux compagnies du 308ème arrivent à la rescousse, mais voyant les soldats ennemis fondre sur elles pour les encercler, elles se replient sur le chemin de la Croix où les attendent les rescapés du 307ème.
Avec la dissipation du brouillard, l’ennemi s’aperçoit qu’il n’a en face qu’un petit nombre d’adversaires. L’artillerie vient alors prendre position au lieu-dit Valigout et des mitrailleuses campent sur le chemin de la Croix pour un tir croisé. En quelques instants c’est l’hécatombe. Les blessés et les morts gisent au fond du chemin. À midi la cavalerie allemande charge et sabre les derniers combattants sur la plaine dominant Moislains. La bataille a duré quatre heures. Jean était mobilisé depuis seulement 1 mois ».
1915 : Roger Neyssensas nait le 21 janvier 1892 à Saint-Léon sur l’Isle, fils de Martin et Catherine Gouzou. Roger est domestique à la Jaure chez Monsieur Siméon Hivert.
Soldat au 126ème régiment d’infanterie à compter du 8 octobre 1913, matricule 80, 1 m 53, degré d’instruction 2, Roger est « tué à l’ennemi », disparu le 25 septembre 1915 à l’âge de 23 ans à Neuville Saint-Vaast dans le Pas de Calais lors de la bataille d’Artois. Transcrit sur le registre d’état civil de Saint-Léon le 23 juillet 1920, d’après un jugement rendu par le tribunal de Périgueux le 19 juin 1920 à la demande de la famille Neyssensas.
« Les premiers « placards » de mobilisation sont à peine affichés à Brive que déjà à la porte de la caserne, s'est formé un attroupement nombreux. Le 126ème quitte Brive le 8 août 1914. Son voyage vers la frontière, par Limoges, Troyes, Saint-Dizier est une longue marche triomphale.
Pendant la deuxième quinzaine de juin et le mois de juillet 1915, le 126ème au cantonnement dans la région d’Amiens, à Naours, se réorganise et s'entraîne. Il est enlevé en camion automobile le 19 juillet et transporté dans la région de Frévent. Le 1er août, il relève le 50ème régiment d'infanterie dans les tranchées au sud de Neuville-Saint-Waast.
C'est dans cette zone que le régiment de Roger Neyssensas attaque le 25 septembre, après avoir au cours de ses périodes d'occupation, préparé la parallèle de départ, créé des places d'armes, ouvert de nombreux boyaux, creusé des abris.
Dans la nuit du 24 au 25 septembre, après un repos de huit jours, le 126ème va prendre les emplacements fixés par le plan d'engagement. Les mouvements préparatoires s'effectuent dans de bonnes conditions et à 12 heures 25, les deux bataillons de tête s'élancent sur les tranchées adverses. Le bataillon Fautrat marche droit sur son objectif ; les compagnies Gracies (1ère) et Rivaud (4ème), enlèvent, à la baïonnette, dans un héroïque assaut, les tranchées fortement défendues du Moulin, puis du Losange, et poussent résolument vers les Tilleuls. Elles atteignent la grand-route d'Arras à 12 heures 45, où elles s'arrêtent épuisées.
Les éléments avancés du 2ème bataillon, privés de leurs officiers, tous tués ou blessés, sans liaison à gauche avec les troupes du 3ème corps, se replient également dans la tranchée du Vert-Halo. Toutes les tentatives pour gagner la tranchée des Cinq-Saules, sont paralysées par le feu d'un centre de résistance ennemi qui n'a pas été enlevé, en raison des attaques divergentes du 2ème bataillon. Roger a atteint le groupe de maisons « des Tilleuls » et sa compagnie est arrêtée par une contre-attaque ennemie.
Nos pertes sont lourdes. 9 lieutenants-colonels, sous-lieutenants et capitaines, sont décédés, deux cent soixante-dix-huit hommes, dont Roger, sont également tombés au cours de l'action. Dix officiers, cinq cent dix hommes ont été blessés. De nombreux cadavres d'ennemis, restés dans les tranchées conquises témoignent de la violence de la lutte. Il n'est pas possible de raconter ici tous les traits d'héroïsme accomplis dans cette dure journée ; combien, d'ailleurs, resteront ignorés faute de témoins ... ». Historique du 126ème
Roger est cité sur une plaque commémorative à Ablain-Saint-Nazaire - Mentionné sur le monument aux morts de Brive - place d’arme de la caserne Laporte.
Mensignac
1918 : Célestin Albert Neycenssas nait le 17 mars 1897 à Mensignac, cultivateur célibataire, fils de Jean et Anne Martrenchard tous résidants à Barsac, canton de Podensac en Gironde. Matricule au recrutement : 1937 - Bordeaux (Gironde) - Incorporé et arrivé au corps le 8 janvier 1816, 2ème classe au 107ème régiment d’infanterie, 1 m 61, degré d’instruction 2.
Le 107ème est en garnison à Angoulême lors de la mobilisation d'août 1914, rattaché à la 46ème brigade d'infanterie de la 23ème D.I. - Le régiment reste à la 23ème D.I. jusqu'en novembre 1918 et sera notamment engagé sur le front italien.
Célestin part au front le 24 octobre 1916 et, est nommé tambour le 10 aout 1917.
Célestin, 21 ans, est mort au champ d’honneur, « tué à l’ennemi » le 27 octobre 1918 au combat sur le Piave, à Valdobbiadene en Italie. « Soldat brave et dévoué tombé glorieusement en se portant à l’assaut des positions ennemies ».
« Les premières troupes françaises arrivent en Italie le 31 octobre 1917 et se déploient progressivement entre Mantoue et Vérone ; puis, un peu plus à l'est de Montello, sur la ligne Monfenera - Monte Tomba - Pederobba.
Fin avril, deux divisions françaises (les 23ème et 24ème DI) restent sur le front Italien, formant le 12ème corps d'armée, commandé par le général Jean-César Graziani et désormais dénommé Forces françaises en Italie (FFI).
Ces troupes participent activement à la « Bataille de la Piave » sur le plateau d'Asiago, du 15 au 22 juin 1918. Le 24 octobre, le généralissime Italien Diaz lance une offensive générale. Ses sept armées attaquèrent sur un front qui allait d'Asiago à la mer. Au centre de ce front se trouvait le 12ème Corps français avec les FFI du général Graziani.
Dans la nuit du 26 au 27 octobre, les Français forcèrent la traversée de la Piave au Molinetto di Pederobba. Le 107ème bataillon traverse le fleuve et fait face à des unités ennemies accrochées aux falaises de San-Vito. Le 28 octobre, les Français, appuyés par les unités italiennes, agrandissent leur enclave et prennent possession des monts Perto et Piaunnar. L'avancée a culminé le 29 octobre avec la victoire italienne à Vittorio Veneto, au cours de laquelle des milliers de soldats Autrichiens ont été capturés ».
Célestin est inhumé en Gironde à Barsac
Moyenne d’âge des décédés : 24 ans
Prisonniers en Allemagne
Les familles Neyssensas compteront 8 prisonniers tout au long de la première guerre mondiale.
Lorsque les opérations commencent sur le front Ouest, en août 1914, le sort des prisonniers de guerre est réglé depuis le 18 octobre 1907, par la convention de La Haye signée par 44 pays et définissant la responsabilité des États vis à vis de leurs prisonniers en ce qui concerne le mode d'internement, la discipline, le travail, la solde, le courrier, les rapatriements...
Les armées allemandes envahissant la France, la Belgique et le Luxembourg lors des batailles des frontières, de nombreux soldats français, souvent blessés, sont capturés au cours des combats en rase campagne ou lors de la reddition des places fortes. Le sort exact réservé à ces captifs par l'ennemi est ignoré en France durant les premiers mois de la guerre. Il est peu à peu connu grâce aux lettres échappées à la censure ou aux témoignages des premiers évadés. Aucun règlement militaire allemand ne fixe vraiment le sort des prisonniers : autant de camps, autant de régimes particuliers. Le traitement des hommes de troupe est sévère, celui des officiers plus adoucis. En 1915, les plus durs se trouvent à Lechfeld, Minden, Niederzwehren : pas de chauffage, pas de lit, peu de soins sanitaires, peu de nourriture. (Chemin de Mémoire)
Les autorités allemandes sont confrontées rapidement à un afflux inattendu de prisonniers. En septembre 1914, 125 050 soldats français sont prisonniers. Dès l’année 1915, les autorités allemandes mettent en place un système de camps, près de trois-cents, en recourant à la dénutrition, aux punitions et au harcèlement psychologique, alliant enfermement et exploitation méthodique des prisonniers. Les prisonniers dorment dans des hangars ou sous des tentes, et creusent des trous à même le sol pour se protéger du froid. Les constructions, forts par exemple, humides, réquisitionnés pour servir de lieu de détention occasionnent de nombreuses maladies pulmonaires. Des camps sont établis aussi bien dans les campagnes qu’à proximité des villes, ce qui eut des conséquences lorsque des épidémies de choléra ou de typhus menacèrent de s’étendre à la population civile.
Léguillac de l’Auche - Saint-Astier
Adrien Neyssensas nait le 18 mars 1884 à Léguillac de l’Auche, résidant à Saint-Aquilin, carrier-mineur, fils de Jean et Anne Beyney, domiciliés à Neuvic. Incorporé au 50ème régiment d’infanterie en 1906 sous le matricule 23, taille 1 m 61, degré d’instruction 3. Passé à l’état-major de l’Ecole supérieure de guerre comme soldat ordonnance 1er novembre 1907. Après la mobilisation générale Adrien arrive au corps le 3 aout 1914. Adrien disparait sur le front le 28 aout 1914 à Mesnil. Adrien est finalement en captivité dans le camp de Sennelager à compter du 28 aout 1914 puis rapatrié le 22 décembre 1918.
Adrien se marie le 7 février 1924 à Saint-Astier avec Raymondie Reynelle et décède le 6 novembre 1955 au Roudier à Saint-Astier à l'âge de 71 ans.
Camp de Sennelager
« En 1915 on parvient au camp par trains : 40 hommes par wagon. Au début du camp nombre de prisonniers logent dans des tentes. Les Belges, Français, Britanniques, Russes, sont rapidement groupés par nationalité. (Les Belges et les Français semblent avoir été rassemblés). Le camp s’agrandit : Senne I, Senne II, puis le camp de Staumühle situé au nord de Sennelager, dans l'enceinte du champ de manœuvre. Les prisonniers n'échappent à la famine que grâce aux colis envoyés par leurs familles. La plupart d'entre eux travaillent en Kommandos à l'extérieur du camp. La majorité des prisonniers français rentrent chez eux en novembre 1918. Certains toutefois ne quittèrent le camp qu'en janvier 1919 ».
Montrem
Adrien Neyssensas nait à Saint-Aquilin le 8 avril 1893, chaufournier à Saint-Astier, fils d’Elie et Germaine Fargeot, résidant à Montrem.
Adrien est incorporé au 108ème de Bergerac le 26 novembre 1913 en qualité de soldat de 2ème classe, classé dans le service auxiliaire pour acuité visuelle diminuée à l’œil gauche. Adrien porte le numéro matricule 706, sa taille est d’1 m 60 et porte une cicatrice au menton, degré d’instruction 0.
 |
| Montrem le 9 septembre 1926 |
Maintenu
sous les drapeaux le 1er aout 1914, Adrien arrive au front le
14 février 1915, et ce, jusqu’au 8 mars 1916. Adrien, 22 ans, à présent soldat
au 153ème régiment d’infanterie, est fait prisonnier de guerre
à compter du 9 mars 1916, et ce, jusqu’au au 31 janvier 1919. Interné à Duelmen
en Allemagne, Adrien est rapatrié et arrive au dépôt des Isolés de Limoges le 1er février
1919. Sa blessure contractée lors de sa captivité, fracture de l’humérus gauche
est bien consolidée le 28 septembre 1922, persiste un léger emphysème sans
bronchite, état général bon. Adrien obtient un certificat de bonne conduite à
la fin du conflit. A son retour en Dordogne, Adrien habite à Saint-Astier dès
le 28 aout 1919, puis Montrem le 1er janvier 1920.
Le
recensement de Montrem en 1926 nous apprend qu’Adrien a épousé Alice Mourcin,
née en 1894 à Razac sur l’Isle, sans profession. Le couple donne naissance à
Colette en 1923 à Montrem.
Adrien
est inhumé à Montrem le 9 septembre 1926. (Informations fiche matriculaire
militaire).
Camp de Duelmen
Camp de prisonniers situé en Westphalie, proche de la frontière Hollandaise, qui vraisemblablement servait de centre de ravitaillement à d’autres camps de prisonniers, mais aussi de camp de triage pour prisonniers qui étaient par la suite dirigés soit vers d'autres camps, soit dans différents commandos.
« Environ 10 000 personnes y ont été détenues. Il y a eu 5 296 Français, 2595 Britanniques, 1135 Russes, 505 Belges, 237 Italiens, 178 Portugais, 10 Roumains, 9 Serbes, 6 prisonniers civils et deux officiers. Il y aurait eu également, à certains moments, des prisonniers Américains et Canadiens.
Le camp comptait trois blocs de baraques et un hôpital (Lazaret). Le bloc 1 était occupé par les Français et les Belges, le 2 par les Anglais et le 3 par les Russes et autres ressortissants des pays de l'Est. Le bloc 1 comprenait 22 baraques dont 18 étaient destinées au logis de 2 094 prisonniers. Ils avaient à leur disposition 10 baraques pour se laver, une buanderie, une cantine et un atelier. Plusieurs détenus assuraient le service religieux mais le curé Fiedler de Dulmen disait la messe dans le camp allemand et visitait les détenus malades au Lazaret.
Il y avait une baraque qui servait de théâtre et disposait de 600 places. Il y avait des concerts organisés par les Russes.
Après un certain temps les prisonniers furent formés pour travailler dans les fermes ou les usines, compte tenu des pertes de travailleurs allemands enrôlés. Les prisonniers travaillaient 10 heures par jour pour un salaire de 0,32 Mark.
La poste fut organisée par le Cicr et par la Croix Rouge Néerlandaise. Les colis étaient ouverts en présence des prisonniers et tout objet permettant une évasion était confisqué (carte, compas, tournevis etc….) ».
La rencontre de deux soldats Périgourdins
Au début de la 1ère guerre mondiale
Les courriers de Joseph Gouzou
La Première Guerre mondiale est la première des guerres où tant d'hommes engagés dans un conflit savent écrire. Dès cet instant, lors des moments de répit, l'écriture devient l’un des moyens de s’évader du monde des tranchées.
Les courriers de Joseph Gouzou représentent une source de premier ordre pour celui qui désire découvrir la vie quotidienne d’un soldat de 14-18, tout en faisant un parallèle avec l’un de ses compagnons d’arme, Adrien Neyssensas, pour lequel nous ne détenons aucun écrit.
Nous allons faire connaissance avec Adrien et ainsi aborder la guerre à partir du regard personnel et intime de Joseph.
Les documents cités sont issus des sites « Chtimiste », Archives de la Dordogne et Généanet tous en consultation libre.
En aout 2025, je découvre sur le site « chtimiste » consacré à la 1ère guerre mondiale, la correspondance d’un Caporal du 126ème régiment d’infanterie de Brive nommé Joseph Gouzou originaire de Manzac sur Vern en Dordogne. Joseph deviendra sergent au 43ème régiment d’infanterie en novembre 1914.
Présenté par « Max » comme étant un cousin de son beau-père, Joseph Gouzou a écrit un peu plus de 300 courriers à ses parents entre le 5 aout 1914 et le 24 septembre 1916.
Dans le courant d’avril 1915, sur un secteur du front, Joseph est aux côtés de « deux soldats du pays : un de Grignols, Veyssière dit « Cariolet », et un de Montanceix, Neyssensas, mais ils ont été blessés tous les deux le 5 avril ». (Courrier du 16 avril 1915 à ses parents, voir ci-dessous).
Dans l’attente que « Max » me contacte et sans avoir eu de retour par mail du responsable du site, je publie quelques extraits des courriers de Joseph Gouzou….
Le patronyme Gouzou n’est pas inconnu dans la famille Neyssensas de Saint-Léon sur l’Isle.
Une fratrie de 3 enfants, fils de Catherine Gouzou et Martin Neyssensas, décède au front entre 1914 et 1918. Voir article ci-dessus. Les parents et ancêtres de Catherine Gouzou sont originaires de Grignols.
Présentons tout d’abord Joseph Gouzou d’après sa fiche matriculaire disponible aux archives du Périgord sous la référence 02R1042, puis Adrien Neyssensas et Ludovic Veyssière.
Joseph nait le 18 mars 1891 à Manzac, canton de Saint-Astier. Il porte le matricule de recrutement 353 de la classe 1911. Joseph est décrit le visage long, les cheveux châtain foncé, taille 1 m 66, et degrés d’instruction 3, (3 pour un jeune homme qui sait lire, écrire et compter - instruction primaire).
Joseph est cultivateur à Manzac avec ses parents, Jean Gouzou et Jeanne Hivert.
 |
| Ils ont rencontré Joseph |
Il est incorporé au corps, soldat de 2ème classe, le 8 octobre 1912, nommé Caporal le 9 novembre 1913, puis Sergent le 11 novembre 1914, affecté au 43ème régiment d’infanterie le 23 février 1915.
Le bataillon auquel appartient Joseph est composé d’environ 1000 hommes. Joseph, par voie ferrée, quitte son cantonnement le 13 janvier 1915 pour son instruction à Oiry, Saint-Hilaire-au-Temple dans la Marne.
 |
| Le Café de la Gare d’Oiry en mars 1915 |
Quelques militaires attablés
Il est vraisemblable qu’Adrien Neyssensas incorpore le 43ème le 14 février 1915 après une formation qui s’échelonnera du 2 aout 1914 au 13 février 1915. (Voir son parcours personnel ci-dessus).
Quant à Ludovic Veyssière, il incorpore le 43ème le 26 mars 1915. Ludovic porte le matricule de recrutement 98, classe 1912, cheveux châtain foncé, les yeux marrons, il mesure 1m64. Son degré d’instruction est de 2.
Ludovic est né le 28 juin 1892 à Grignols, canton de Saint-Astier, cultivateur comme ses parents, Jean et Marie Besse. Après la guerre Ludovic est classé affecté spécial à l’usine de chaussures Georges de Saint-Astier en qualité de monteur en chaussures.
Adrien et Ludovic passeront tous deux par le 108ème régiment au tout début de leurs affectations.
Joseph écrit :
Le 28 février 1915
« Cher Monsieur,
Hier, j’ai été affecté à ma compagnie, la huitième. J’ai très bien réussi car j’ai comme commandant de compagnie un bon capitaine qui est là depuis le début de la campagne, ce qui est rare en ce moment. Je ne crois pas rentrer dans les tranchées de 7 à 8 jours.
On est en train de vacciner les hommes du corps d’armée ; avec ça on va pouvoir un peu s’habituer à cette vie de pirate et au grondement du canon. On est à environ 6 kilomètres des lignes de bataille, et depuis que nous sommes là, le canon n’a pas cessé de tonner une seconde, si bien la nuit que le jour. C’est juste là que l’on veut faire une trouée si c’est possible. Enfin le temps n’est pas trop mauvais, mais malgré ça, la vie n’est pas la même qu’à Brive.
On a comme logement des cabanes creusées dans le sol et recouvertes de terre. Je termine avec espoir que bientôt, nous aurons pu débarrasser le territoire belge et le nôtre, et alors revenir vous voir avec une paix éternelle ».
15 mars 1915
« Mes chers parents,
Je fais réponse à votre lettre que je viens de recevoir hier. J’ai été très heureux de voir que vous êtes tous en très bonne santé.
Je vais vous dire que nous avons été relevés depuis avant-hier des tranchées, on nous a amenés en auto en arrière de Châlons où nous devons rester au repos au moins jusqu’à la fin du mois. Là, on est très bien. Tout ce qu’il faudrait, c’est que ça puisse durer.
Vous me demandez si je connais quelqu’un. Je suis venu avec vingt sergents de Brive. On était 3 de la 28ème. Nous sommes restés ensemble à la 8ème du 43ème. Hier, il en est encore arrivé d’autres de Brive. Hier, je suis allé à la messe. Presque tous les soirs, on va aller au salut. Je suis avec des gens bien plus religieux que dans notre pays. Cela me fait beaucoup plaisir. Quant aux Pâques, je compte bien pouvoir les faire avant de retourner aux tranchées… ».
Les 13 et 14 mars 1915, le Régiment est relevé de cet absorbant secteur, après avoir subi un échec, le 3 mars, dans l’attaque du Bois Oblique, et après avoir arrêté, le 4, une vigoureuse poussée allemande.
Transporté en camions, le Régiment débarque à Cheppy où il demeure jusqu’au 20 mars.
21 mars 1915
« Mes chers parents,
Je viens vous donner de mes nouvelles toujours très bonnes. Aujourd’hui, je croyais aller faire mes Pâques. Il a fallu changer de cantonnement. On est partis ce matin à 5 heures. On a 35 km à faire en deux jours, ce qui n’est pas beaucoup. On est arrivés à côté du village où nous devons coucher ce soir à huit heures par un superbe soleil. On doit y rentrer ce soir à 5h pour repartir demain matin pour le nouveau cantonnement où nous resterons encore quelques jours ».
Le soir même, il cantonne à Ressons et après une journée de repos, il se rend dans la Woëvre par étapes successives. Il est le 31 mars à Brize-la-Grande, le 1er avril à Heippes.
1er avril 1915
« Chers parents,
Hier, j’ai reçu le colis avec plaisir. Les gaufres étaient très bonnes ainsi que le chocolat. Je vous remercie beaucoup. D’alcool de menthe, je n’en avais pas beaucoup besoin. J’ai le flacon que j’avais acheté avant de partir et qui est à peine entamé ; et celui que vous m’aviez envoyé, je l’avais donné à un camarade. Enfin, celui-là, je le garde ; mais on n’en use pas beaucoup, car on ne fait pas beaucoup de marches et il ne fait pas très chaud. Des mouchoirs, j’en avais assez. Les chaussettes servent toujours ; mais comme linge, ne m’envoyez rien, on en touche suffisamment. Ce soir, nous sommes relevés ; nous allons à 15 km en arrière pour 15 jours.
Le temps n’est pas trop mauvais, ces jours-ci, il tombe quelques averses. J’ai toujours des bonnes nouvelles de mon oncle Boulenzou (Pierre Fourgeau). Vous me dites que Clament (Frédéric) et Fruchou sont en permission. Tant mieux. Moi aussi, je compte bien y aller vers la fin du mois. Mais comme je vous ai dit déjà, n’y pensez pas trop, c’est tellement vite changé qu’il vaut mieux ne pas s’y attendre. Ici, toujours la même chose : quelques coups de canon, mais front toujours calme. Pas grand-chose pour le moment. Je suis toujours en bonne santé et espère que vous êtes tous de même.
En attendant le plaisir de se voir, recevez de votre fils ses meilleurs sentiments d’amitiés ».
Joseph, Adrien Neyssensas et Ludovic Veyssière sont le 2 à Dugny, le 3 dans la région de Ville-en-Woëvre. Le 4, les chefs de Bataillon et les Commandants de Compagnie, appelés pour une reconnaissance sur le front situé en avant du village d’Hennemont reçoivent communication d’un ordre d’attaque pour le lendemain.
Joseph, ne reverra pas Adrien et Ludovic, en effet, tous deux sont blessés lors de l’une des batailles de la Woëvre dans les Hauts de Meuse, le 5 avril 1915 au bois de Pareid.
Le Bois de Pareid se situe entre Verdun et Metz à proximité de Maizeray. Devant lui, un glacis en pente douce monte insensiblement jusqu’aux tranchées allemandes situées à 1200 mètres. Il pleut et il fait froid. Enveloppés dans leurs couvertures et leurs toiles de tentes, accroupis au fond d’un fossé, les hommes subissent de fortes averses. Toujours insouciants, ils attendent l’heure prévue pour l’assaut.
14 h 20 ! Les masses informes qui somnolaient dans la terre gluante se sont agitées ; elles sont parties à découvert vers le point lointain. Et maintenant le régiment est debout sur la plaine, tout entier déployé sur une seule ligne, le long de laquelle courent et se multiplient les étincelles des baïonnettes. L’ennemi est loin et il a vu. Ses mitrailleuses crépitent. En nappes profondes, les balles rasent le sol, frappant et tuant sans relâche.
Et cependant, malgré la mort qui fébrilement fouille les rangs, les assaillants montent calmes et résolus vers l’objectif qui grandit. Mille mètres sont franchis et l’élan n’est pas encore brisé. Mais le double réseau ennemi dresse non loin de là ses piquets intacts le long desquels s’enchevêtrent en une broussaille profonde et infranchissable les rangs entremêlés de fils de fer barbelés. C’est là que, dans un ultime élan, les plus vaillants vont succomber, 23 officiers et 511 hommes disparaissent ce jour-là.
Extrait : Historique du 43ème Régiment d’Infanterie - Imprimerie Berger-Levrault - Paris
Deux autres Périgordins sont parmi les « tués à l’ennemi » ce 5 avril :
Vassal Léon Élie de Cénac et Lacoste Gustave Bertrand de Terrasson.
Le Régiment est relevé le 7 avril 1915 et mis au repos près de Verdun, à la caserne Chevert, où il fait son entrée le 9.
Adrien est en convalescence après sa fracture à l’humérus gauche du 6 avril au 28 septembre 1915.
Veyssière Ludovic est blessé le 5 avril 1915 par un éclat d’obus à la tête. Il venait d’arriver au 43ème après une première blessure en novembre 1914 (éclat d’obus au doigt et à la jambe gauche). Il sera blessé une troisième fois le 24 juin 1916 (éclat d’obus jambe droite) et une quatrième en novembre 1916 (éclat d’obus épaule droite). Il survivra à la guerre et gardera des « corps métalliques » dans le tibia droit et la cuisse gauche. Voir infos Chtimiste.
Le courrier de Joseph, écrit le 16 avril, mentionne bien le départ du 43ème d’Adrien et Ludovic après blessures.
16 avril 1915
« Mes chers parents,
« Hier, je viens de recevoir vos lettres datées du 8 et 10 avril ainsi que le colis. Ce qui me surprend, c’est de voir que vous me dites que vous ne recevez pas de nouvelles ; il faut que les lettres s’égarent car j’écris souvent. Vous dites que la dernière était datée du 15. Pourtant depuis, je vous en ai envoyé au moins 10. C’est vrai que depuis le 29, on a été en marche et on ne recevait même pas les vôtres. Alors, je donnais mes lettres à n’importe qui en passant dans les villages, soit les artilleurs ou le génie qui peut-être souvent les perdaient au lieu de les donner au vaguemestre. Enfin, malgré ça, vous devriez en recevoir quelques-unes. Le colis parti du 21 mars est arrivé seulement 3 jours avant l’autre que vous m’aviez envoyé le 8 avril.
J’ai reçu aussi les deux lettres recommandées avec dix francs chacune. Je vous prie, ne m’en envoyez plus car j’en ai assez, avec 34 sous que je gagne par jour. Si je vous ai dit que l’on change de secteur, c’est le secteur de front, mais jamais de secteur postal, le numéro postal est toujours le même. J’avais avec moi deux soldats du pays : un de Grignols, Veyssière dit « Cariolet », et un de Montanceix, Neyssensas. Mais ils ont été blessés tous les deux le 5 avril.
Je vous renouvelle aussi, si parfois la lettre est perdue, que j’ai pu faire mes Pâques le jour des Rameaux. En ce moment, nous sommes au repos à 1500m de Verdun dans une caserne. J’ai un bon lit, voilà déjà 6 jours. Je pense y rester encore quelque temps. Le temps est superbe, il fait un beau soleil ».
8 mai 1915
« Chers parents,
C’est étant en très bonne santé que je vous écris. Hier, j’ai reçu votre paquet ainsi que la lettre recommandée avec 10f. Je vous remercie beaucoup, seulement, je vous renvoie l’argent. Je mets 30f dans la lettre, il me reste assez pour mon service. On touche notre prêt régulièrement tous les dix jours. J’envoie aussi mon tricot de laine ; ne m’envoyez rien jusqu’à ce que je vous le demande. Quand vous aurez reçu, vous me le direz. J’ai assez de bas et de mouchoirs. On en touche assez souvent. Vous pourrez laver le tricot au cas où il y aurait des œufs de petites bêtes, car c’est là principalement que ça aime être. » « Il y a déjà quelques jours que je n’ai pas reçu de nouvelles de Boulenzou - Pierre Fourgeau, mais ça ne m’étonne pas, car lorsqu’on change de place, la correspondance est très difficile.
On n’avait pas encore relevé le 127ème. Il avait demandé à rester 12 jours dans la tranchée. On y va ce soir ; nous serons 4 jours en 1ère ligne, 4 jours en 2ème et 4 dans un village ; puis on revient à l’arrière. On n’avait plus eu un secteur pareil. Depuis 12 jours, le 127ème n’a encore pas un blessé. J’espère que ça va être calme pour nous aussi. Je vous écrirai quand je serai dans la tranchée. Je termine avec espoir que vous êtes tous en bonne santé.
Votre fils qui vous embrasse. »
Ps : « Bonjour à mes parents, à Raoul et aux voisins. Je suis très content de rentrer dans la tranchée pour pouvoir me reposer ; à l’arrière, on nous fait faire des marches tous les jours. Le temps est superbe. »
Mardi 11 mai 1915
« Chers parents,
Voilà 3 jours que je suis dans la tranchée. Comme je vous l’avais dit, je viens vous donner de mes nouvelles toujours très bonnes. Ici, on est très tranquilles, on ne se croirait pas à la guerre, on ne tire pas un coup de fusil, ni on ne reçoit d’obus. On ne reçoit pas d’obus, on a des souterrains profonds de 2 à 3m où on peut dormir en sécurité. C’est très curieux à voir. Où je suis, on est deux : l’adjudant et moi. On a une table, chacun son petit tabouret, et de la paille à volonté, c’est à dire une belle petite chambre de guerre. Ce n’est plus le même adjudant. L’autre est blessé depuis le 5 avril. Celui-là a un an de moins que moi, il était fourrier quand je suis arrivé ; il a été nommé depuis un mois. »
« Vous me direz si vous avez reçu le tricot et la lettre recommandée avec 30F. La lettre faite, avant la carte du … que j’ai reçu ce matin, n’est encore pas arrivée. Vous voyez que ce n’est pas toujours régulier. J’ai reçu un petit paquet venant de ma tante Louise (FOURGEAU). Je termine avec espoir que vous êtes toujours en bonne santé. Votre fils qui vous embrasse. »
PS : « Je vous envoie une fleur cueillie à côté de la tranchée. Les vignes doivent être bien belles. Nous sommes en 1ère ligne, nous serons relevés demain soir pour aller en 2ème. Bonjour aux voisins et à Raoul. »
Samedi 13 juin 1915
« Mes chers parents,
C’est étant toujours en très bonne santé que je vous écris. Je suis en 1ère ligne depuis hier, pour le même nombre de jours comme à passer en 2ème.
On est très tranquilles, les boches ne nous embêtent pas trop ; on a un très bon « gourbi » : c’est le nom de notre maison souterraine. On y est à trois : l’adjudant et le sergent qui est à la section avec moi. Vous me demandez si j’ai des camarades sur lesquels je puis compter. Je peux vous répondre que oui. Jamais je n’en avais trouvé de meilleurs. Il se trouve même beaucoup d’hommes de la contrée, des départements voisins qui ne sont pas meilleurs que les autres ; il y en a des bons et des mauvais dans tous les pays.
J’en ai un qui est de Coursac dans ma compagnie. Il s’appelle Dumas. Il a un an de plus que moi. Il travaillait à la scierie qui se trouve à côté du charron et aubergiste Siquier. C’est un brave garçon. Il était avec moi déjà depuis longtemps que je n’en savais rien.
Il était venu avec les deux qui ont été blessés le 5 avril, Veyssière Ludovic et Neyssensas Adrien.
Il y en a beaucoup d’autres de Brive, Tulle, Terrasson, Bergerac, Sarlat, Saint-Yriex, enfin des environs. Ils viennent des régiments de la division : 50, 108, 126, et 100. Quant à ceux qui sont sur la carte, il n’y en a qu’un de La Force, c’est celui qui est à ma gauche, un engagé du mois d’août, il est tout jeune, de la classe 1916.
Les autres sont de Lille, Roubaix et Calais. Le sergent-major qui se trouve en avant de celui de La Force est parisien. Alors, vous voyez qu’il y en a un peu de partout. »
« Je trouve que les récoltes sont beaucoup avancées. Il se trouve un champ de blé entre nous et les boches qui sont à 350m. Il est tout en épis.
Avant-hier, j’ai goûté des cerises qui se trouvent à la lisière d’un bois où l’on était pendant 20 jours. Elles sont bien mûres. Le temps est magnifique. On a eu de l’orage pendant 2 jours, ce qui ne nous a pas fait de mal, malgré que nous ne demandions pas l’eau. A présent, il s’est remis à la chaleur.
Je termine en vous désirant une bonne santé à tous. Pour moi, je n’ai encore pas connu la guerre. Pour la santé, je suis aussi bien qu’avant de partir. Votre fils qui vous embrasse »
PS : « Bonjour à mes parents, aux voisins et à Raoul. »
16 juillet 1915
« Mes chers parents,
Hier au soir, j’ai reçu une lettre et le colis avec les pêches qui m’ont fait beaucoup plaisir malgré que toujours secouées quoiqu’elles aient été bien emballées, elles se trouvaient presque cuites. Ce matin, j’ai mangé le quartier d’oie qui était fameux. Mon camarade le sergent a trouvé ça à son goût, ainsi que les grillons de l’avant-dernier paquet. Vous direz merci à Maria de ses bonnes pêches.
C’est avec beaucoup de chagrin que j’ai appris la mort du pauvre Dupuy ; c’est bien malheureux surtout que Damon n’a pu être là. Enfin, je vois que la vie est bien dure. Que vont faire ces pauvres femmes ?
Tant mieux que vous ayez presque fini de rentrer les blés. Vous devez avoir beaucoup de travail pour aider les autres. Je suis au repos depuis hier matin. Je termine avec espoir que vous êtes tous comme moi en très bonne santé. Votre fils qui vous embrasse. »
Ps : « Bonjour à Raoul et aux voisins ainsi qu’à tous mes parents. »
10 août 1915
« Mes chers parents,
Hier j’ai reçu le bon colis que vous m’avez envoyé. Tout était en très bon état. Les gâteaux ainsi que le fromage étaient délicieux. L’eau de Cologne et la boîte de pâté y étaient aussi. La veille, j’avais reçu de ma tante Louise Fourgeau des pêches qui étaient très bonnes. Je lui ai écrit en même temps qu’à vous pour la remercier. Quant aux fruits, ne m’en envoyez pas, on est dans un pays où il y en a beaucoup ; on peut avoir ce qu’on veut, et pas cher.
Je suis bien content que tous mes oncles aillent en permission, moi aussi, je compte toujours partir.
Hier, j’ai par hasard rencontré le fils Chastanet Joseph. On a pu passer la journée ensemble. Nous, on se trouvait de faire une halte dans un bois où l’on est restés de 10h du matin à 8h du soir. Vers midi, j’étais en train de dormir à l’ombre d’un chêne quand il est venu me réveiller. Il avait demandé juste à des hommes qu’il a entendu parler le patois, s’il y en avait beaucoup de la Dordogne. Le premier qu’il a trouvé était de ma section et lui a donné mon nom. Voilà comment on se trouve à la guerre. On a été bien contents ; on a pu boire un litre de vin blanc ensemble. Lui est bien heureux, il est dans les aérostiers. Ce sont des ballons captifs qui se trouvent à une dizaine de kilomètres de la ligne, et qui servent étant dans l’air de postes d’observation. Au moyen de jumelles, ils aperçoivent tout ce qui se passe jusqu’à 20 km.
Je vais samedi dans le village où il se trouve. A l’instruction du tir où tous les hommes passent, on y reste 4 jours chacun. Si vous voyez ses parents, vous pouvez dire qu’il est en très bonne santé. Pas grand-chose à vous dire, je suis toujours en bonne santé. Votre fils qui vous embrasse. »
18 septembre 1915
« Mes chers parents,
C’est avec plaisir que ce matin j’ai reçu votre carte m’annonçant votre bonne santé. Moi aussi, je vais bien. Je me trouve en repos. Nous faisons des travaux et sommes relevés tous les deux jours ; nous sommes dans un bois où par un temps superbe comme nous avons, on est très bien. L’autre jour, j’ai très bien fait mon voyage. J’étais avec Nadal de la Tabate et le beau-frère de Lacueille qui demeure à Montanceix.
En passant à La Cave, j’ai pu voir Marie Vidal. A Périgueux, j’ai été voir Léody, on a bu un verre ensemble. Après avoir acheté mes guêtres aux Nouvelles Galeries, je lui ai repris mes molletières. J’ai pris ma montre chez Lestrade. Mon bras est complètement guéri. Il ne m’en est pas poussé d’autres. Ici, toujours la même chose, le secteur est calme. Pas grand-chose à vous dire si ça n’est que je vous désire une excellente santé à tous. Votre fils qui vous embrasse. »
Ps : « Bonjour à mes parents et aux voisins. J’attends toujours cette paix avec impatience. Envoyez-moi une chemise, celle que j’avais a été mangée par les rats pendant que j’étais en permission. »
24 décembre 1915
« Mes chers parents,
Voilà Noël qui arrive.
Ce soir, je vais à ma compagnie qui se trouve sortie des tranchées depuis 2 jours. Nous devons faire un petit réveillon et chanter Minuit chrétien ensemble. J’aimerais bien mieux être auprès de vous tous. Enfin, c’est ainsi. Espérons que ce beau jour viendra ; malgré la guerre, je ne suis pas malheureux de trop.
Ce soir, j’ai vu l’aumônier. Demain matin, je dois aller à la messe de 6h ½. Unissons nos prières et dieu nous protégera. Pas grand-chose, je suis en parfaite santé et espère que vous êtes tous de même. Votre fils qui pense à vous. »
Ps : « Aux cours, on a repos 48h. Pour remplacer la journée de Noël, on reste un jour en plus. Je rentre à ma compagnie mercredi soir. Bonjour à tous mes parents et voisins. De votre fils ses meilleurs baisers. »
28 décembre 1915
« Mes très chers parents,
A l’approche de ce nouvel an, je viens vous offrir mes meilleurs vœux de bonne année et de bonheur. J’espère que la nouvelle année va permettre d’avoir la paix et de nous réunir pour une vie heureuse. Je suis en parfaite santé et espère que vous êtes tous de même. Recevez mes meilleurs baisers. Votre fils »
31 décembre 1915
« Mes chers parents,
En ce dernier Jour de l’An, je viens vous donner quelques nouvelles qui sont très bonnes. J’espère que l’année 16 que nous allons commencer demain sera meilleure et plus gaie que celle que nous terminons aujourd’hui.
Ce qu’il faut demander à dieu, c’est qu’il nous donne cette paix attendue depuis si longtemps et qu'il nous protège comme on l'a déjà été. Ici, rien de nouveau, le secteur est calme ; le temps superbe pour la saison.
Je suis en parfaite santé et espère que vous êtes de même.
Votre fils pour la vie. »
3 janvier 1916
« Mes bien chers parents,
Je vais vous donner de mes nouvelles qui sont toujours bonnes.
J’espère que vous êtes aussi tous en bonne santé. C’est aujourd’hui la relève, nous allons au repos pour 6 jours. Nous avons un temps très beau, nous n’avons pas de froid ; ce qui est embêtant, c’est qu’il pleut un peu de trop ; mais voilà la lune qui va être nouvelle, peut-être que le temps va se mettre au froid, ce qui tout de même serait meilleur que la pluie. Le secteur est très calme.
Si on peut passer là l’hiver, on est bien tranquilles. Hier, nous avons fini le poulet ; il était très bon ; on était à quatre, car dans ma section, on est 3 sergents depuis 3 semaines et l’adjudant. Ils ont trouvé très bon et m’ont chargé de vous remercier pour eux.
Pour les pastilles, ne vous faites pas de mauvais sang ; je ne suis pas enrhumé, ce n’est que pour la nuit quand je suis de service, ça fait passer le temps. J’ai reçu celles que vous m’aviez envoyées et je n’avais encore pas fini la 1ère boîte. Toujours des bonnes nouvelles de mes oncles. Je pense que Paul doit arriver bientôt ; mais ça ne marche pas vite. Je ne pourrai jamais venir avant 3 mois, et encore il faut que ça aille bien. Enfin les permissions, c’est bien beau, mais il vaudrait encore mieux la paix. Je termine en vous désirant une bonne santé à tous.
Votre fils qui ne cesse de penser à vous tous, et vous embrasse. »
Ps : « Bonjour à mes parents, les voisins, et le brave Michet qui j’espère saura bien me remplacer en vous soulageant dans vos travaux.
Ma chère mère, tu voudras bien me dire si la bague d’Elia irait à ma marraine. Je pense qu’il faudrait plus grand. Nous avons demain soir un beau lièvre à manger. La veille du premier janvier, j’en ai fait tirer deux à mon lieutenant. Ils étaient à côté de mon gourbi le soir à la tombée de la nuit. Il a bien voulu nous en donner un. Ici, on ne voit que du gibier. »
31 janvier 1916
« Mes très chers parents,
Je réponds à votre lettre que j’ai reçue hier au soir, laquelle me donne toujours de bonnes nouvelles. Moi, la santé continue à être bonne. Depuis hier au soir, je suis revenu en 1ère ligne, pour 6 jours ; toujours même secteur calme.
Nous avons un temps merveilleux : il ne pleut ni ne fait froid.
Vous dites de faire attention à moi. Vous devez savoir que si j’ai eu des galons, je les ai acceptés ; mais jamais je n’ai exposé ma vie pour si peu ; car à mon point de vue, ce n’est rien du tout.
Je suis ici pour faire mon devoir jusqu’au bout ; mais non pour faire des bêtises, et avoir la folie d’une citation ou d’un bout de galon. Prenons le temps comme il vient.
C’est avec plaisir que je vois que vous m’annoncez un colis. Je vous remercie, mais vous m’envoyez beaucoup. Espérons que bientôt nous verrons arriver cette paix. Recevez de votre fils ses meilleures amitiés. »
Ps : Bonjour à mes parents et aux voisins.
1 février 1916
« Mes chers parents,
Je vais vous donner de mes nouvelles toujours bonnes ; j’espère que vous êtes de même en très bonne santé.
Il est 5h du soir. Voilà une journée en plus de passée. Combien en avons-nous passé déjà de ces journées tristes, et encore si l’on voyait une paix prochaine. Enfin espérons que ce sera bientôt.
Peut-être si les zeppelins revenaient de temps en temps faire leur visite, nos embusqués de Paris, au lieu de se ficher de nous, comprendraient ce que c’est la guerre. Malheureusement, c’est toujours de pauvres innocents qui vont attraper.
Je termine en vous désirant une bonne santé. Votre fils qui vous embrasse. »
Ps : C’est l’heure de la soupe, bonsoir. Le temps est un peu refroidi, mais pas de trop.
14 février 1916
« Mes chers parents,
C’est toujours en santé parfaite que je vous écris. J’espère que vous êtes tous de même. Hier au soir, j’ai eu votre lettre du 10.
Ici, c’est presque toujours calme ; si ce n’est que ce matin, de 4h30 à 6h nous avons lancé des gaz asphyxiants aux Boches. Je ne sais le résultat, car la patrouille qui devait aller reconnaître les tranchées ennemies n’est pas sortie, les Boches tirant à la mitrailleuse ; je pense qu’ils n’ont pas eu beaucoup de mal. Aujourd’hui le calme règne ; nous avons un peu de pluie mais il ne fait pas froid. Je crois que nous allons aller au repos pour quelques jours vers la fin de la semaine. Recevez de votre fils ses meilleurs baisers. »
2 mars 1916
« Mes chers parents,
Je viens vous donner de mes nouvelles toujours très bonnes. J’espère que vous êtes tous de même.
Depuis hier au soir, je me trouve en 2èm ligne ; nous sommes très bien, on est dans les bois, et par cette saison, c’est très gai. Il fait un temps merveilleux.
Vous me demandez si j’ai besoin de quelque chose. Je vous remercie ; j’ai pour le moment presque tout ce qui m’est nécessaire ; vous pourriez m’envoyer une flanelle.
Je désire que votre santé continue comme par le passé.
Votre fils qui ne cesse de penser à vous. »
Ps : Bonjour aux parents et voisins ».
11 mars 1916
« Mes chers parents,
Je réponds à votre aimable lettre datée du 4 que j’ai reçue hier au soir. Vous me dites que vous avez reçu de mes nouvelles du 27. Je vois que ça a beaucoup de retard, enfin si ça continue. Je vous ai donné un mot chaque jour. Toujours au même endroit.
Aujourd’hui, il fait un beau temps, hier, on avait de la neige, mais tout est fondu.
Hier au soir, les Boches ont voulu sortir de leurs tranchées, mais malheureusement pour eux que nos mitrailleurs ne dormaient pas. Ils ont dû se replier dans leurs trous en laissant grand nombre de cadavres.
Aujourd’hui, c’est assez calme. Je vois chaque jour le petit Colinet de Jaures. Il va bien.
Je vous remercie de la belle gravure sainte que j’ai reçue hier, je la conserverai précieusement, ayant confiance en la sainte famille qui m’a préservé jusqu’à ce jour. Toujours en santé parfaite, j’espère que vous êtes de même.
Recevez de votre fils qui pense à vous ses meilleurs baisers. »
7 avril 1916
« Mes chers parents,
Nous arrivons de l’exercice, il est 10h ; en attendant la soupe qui est à 11h, je viens vous donner de mes nouvelles qui sont toujours bonnes et espère que vous êtes de même. Je ne sais quand nous partirons d’ici.
Nous y sommes très bien ; on fait un peu d’exercice pour se distraire. La carte que je vous ai envoyée représente des tombes de soldats tombés pendant la bataille de la Marne. Vous voyez si c’est bien tenu.
On en voit un peu partout dans les champs.
Hier, j’ai été les visiter. Ce matin, j’ai assisté à la messe de 7h dite en l’honneur des camarades restés à Verdun.
Je ne vois plus grand chose. J’espère que vous êtes toujours tous en santé parfaite. Votre fils qui vous embrasse. Je me trouve tout près de l’endroit où j’ai été blessé. »
16 août 1916
« Mes très chers parents,
C’est étant toujours en bonne santé que je vous écris. J’espère qu’il en est de même de vous tous.
Aujourd’hui, nous avons repos, nous sommes cantonnés dans un bois, tout près d’un village et d’une rivière. Le pays est très beau.
Hier au soir, j’ai été visiter le champ d’aviation de nos alliés. Le secteur où nous devons aller devient calme. Je ne sais quand nous prendrons les tranchées.
Plus grand chose, je termine et vous envoie mes meilleures amitiés. Votre fils qui vous embrasse. Ps : Chastanet doit être tout près de moi.
22 aout 1916
« Mes chers parents,
Je viens de recevoir aujourd’hui votre lettre du 17. Merci de vos bonnes nouvelles et du billet. Ces jours-ci, l’argent ne m’est pas bien utile ; mais j’espère bien pouvoir m’en servir avant longtemps.
Nous ne sommes pas malheureux de trop. Le temps est merveilleux ; et puis, ces Boches n’existent pas à côté des Anglais qui toute la journée leur envoient des marmites sur la figure.
Malgré que ce soit des Boches, je les plains, car plus jamais, je n’avais entendu pareille chose. Ils ne répondent presque pas. Ils ne cherchent qu’à arrêter l’attaque au moment où on veut avancer. C’est bien moins dur que Verdun.
Je termine en vous désirant une bonne santé. Votre fils qui vous embrasse. »
7 septembre 1916
Mes chers parents « Après avoir fait une bonne nuit, et être nettoyé, me voilà frais, ne pensant plus à ces quinze jours de tranchées, parmi lesquelles il y en a eu de bien dures ; soit par le mauvais temps, car il s’est passé des journées de pluie ou le bombardement. Et encore, tout ça n’est rien à côté du moral, car su vous souffrez de ne pas me voir, moi, j’ai passé de bien tristes moments en songeant à vous. Enfin, tout ça est passé.
Dimanche dernier, ma brigade a attaqué à midi. J’étais 1ère vague. Nous avons fait 800m de progression en 15 minutes, sans pertes. Les Boches surpris dans leurs trous se rendaient sans tirer. Nous, pour le régiment, avons fait dans les 700 prisonniers.
Je suis très content de ma journée ; (même si je suis proposé pour une récompense, mais ne causez pas jusqu’à nouvel ordre, car souvent les propositions reviennent sans résultat. En tout cas, le commandant de la compagnie demande une citation. (*)
Ma division a très bien marché et chaque attaque a atteint le but désigné. Si l’autre qui se trouve aux tranchées en ce moment fait même chose, nous partirons de la Somme pour un secteur calme ; dans 10 jours, je le saurai.
Si vous voyez d’ici là le village de Combles pris, vous pourrez dire que nous ne reviendrons pas à la tranchée ici. En attendant, nous sommes très bien cantonnés. Je termine en vous désirant une bonne santé.
Votre fils qui vous embrasse et fera toujours tout pour l’honneur de ses parents. »
(*) La division a perdu environs 700 hommes tués, blessés et disparus durant cette attaque secteur Maurepas.
11 septembre 1916
« Mes chers parents,
Je viens de recevoir vos deux lettres datées des 7 et 8. Je vois que vous êtes inquiets sur mon sort. J’espère qu’à l’heure actuelle vous aurez reçu de mes nouvelles. J’ai eu avec plaisir la belle image de Notre Dame des Vertus, que je conserve précieusement avec espoir en sa protection. Je suis toujours en santé parfaite. Nous faisons un peu d’exercice pour nous distraire : 2 heures par jour, ce matin, de 7 à 9 heures. Ce soir, nous avons revue de cantonnement à 16h. Le temps est superbe, j’espère qu’il est pareil là-bas. Plus grand chose. Je désire une bonne santé à tous. Votre fils qui vous embrasse. »
15 septembre 1916
« Mes bien chers parents,
Je viens à l’instant de recevoir une lettre du 11, et c’est avec plaisir que je vois que vous êtes tous en bonne santé. Je vous remercie beaucoup des nouvelles que vous me donnez sur le pays. On est si heureux ici quand on sait un peu ce qui s’y passe. Nous n’avons par le fait que ce moment de plaisir.
Je vois que vous m’avez fait des achats d’hiver. Je viens vous renouveler de ne pas les envoyer avant que je vous les demande. En ce moment, je n’en ai pas besoin, et je suis bien assez chargé, surtout que d’ici peu, nous serons certainement relevés du secteur.
Avant-hier, nous devions revenir aux tranchées, même une brigade de ma division y est en réserve de l’autre division depuis deux jours ; mais aujourd’hui, on dit que nous, nous n’y reviendrons pas.
D’ici une petite semaine, il y a des chances qu’on soit sortis de cet enfer. Nous sommes toujours dans ce camp, très bien. Toujours même chose, un peu d’exercice pour se distraire. Question de permissions, dans le régiment, elles sont supprimées depuis un mois et je ne sais pas quand elles vont reprendre. En tout cas, je ne compte pas partir avant décembre.
Je termine en vous désirant toujours une bonne santé. Recevez de votre fils ses bonnes amitiés. Je vous embrasse.
Ps : Bonjour aux parents, les voisins et Julien ».
24 septembre 1916
« Bien chers parents,
C’est avec plaisir que je viens de recevoir vos deux lettres des 19 et 20 m’annonçant vos bonnes nouvelles. Mais je vois que vous vous faites des illusions bien trop tôt. Vous me croyez à la tranchée depuis le 16, ce qui est faux. Je pense à chaque fois que je fais quelque chose, ne pas vous le cacher. Je vous dis chaque jour exactement ce que je fais. Donc, vous pouvez croire mes lettres, elles sont vraies. Nous sommes toujours en réserve du régiment. Le temps est superbe. Nous sommes bien, bien mieux que la 1ère fois. Nous ne serons plus longtemps sans être relevés. Je vois que Ninou a eu un peu de blé. Vous me dites que mon imperméable est arrivé. Quand j’en aurai besoin, je vous le demanderai. (Je ne veux pas qu’il goûte de ce bon morceau de Somme.)
Je vois que mon ancien corps va arriver aussi par ici. Ils font bien même chose que nous. Ils en font leur part. Enfin, après la guerre, je ne pense pas que l’on puisse dire qu’on a été embusqué. Plus grand chose. Je désire toujours même santé. Recevez de votre fils les meilleurs sentiments d’amitié. Je vous embrasse. Ps : Mes amitiés à tous mes parents, voisins et Julien ».
Le courrier du 24 septembre 1916 sera le dernier courrier adressé à ses parents.
Joseph Gouzou est tué à l’ennemi le 25 septembre 1916 à la ferme le Priez près de Frégicourt, secteur de Combles (Somme), « par suite d’un obus sur le corps ». Joseph obtient la Croix de guerre avec étoile d’argent à titre posthume.
Il est enterré à l’extrémité de la tranchée de l’Hôpital à 21 heures du soir, mais son corps n’a jamais été transféré dans la nécropole de Rancourt située à quelques kilomètres.
Extrait fiche matriculaire de Joseph, un refuge, un trou d’obus à la ferme du Priez
Joseph Gouzou est cité sur le monument aux morts de Manzac au côté de Jean Neycensas, décédé quelques mois plus tôt, le 28 aout 1914 à Moislains dans la Somme.
L’acte est retranscrit à la mairie de Manzac le 2 février 1917.
Ils ont rencontré Joseph
Analyse des courriers de Joseph Gouzou
Seuls quelques courriers sont cités dans l’article présenté ci-dessus. L’analyse cependant concerne l’ensemble des lettres écrites par Joseph Gouzou, un soldat du Périgord pendant la Première Guerre mondiale à ses parents et proches. Joseph Gouzou, cultivateur de profession, a été mobilisé en 1912 et a servi comme caporal puis sergent dans différents régiments d'infanterie, notamment le 126ème et le 43ème régiment d'infanterie.
Ces lettres, écrites entre 1914 et 1916, offrent un témoignage poignant de la vie quotidienne d'un soldat pendant la Grande Guerre.
Contexte historique :
Les lettres couvrent une période allant du début de la guerre en 1914 jusqu'à la mort de Joseph Gouzou en septembre 1916.
Elles relatent les conditions de vie dans les tranchées, les déplacements, les combats, les permissions, et les relations avec ses camarades et sa famille.
Thèmes abordés :
Vie dans les tranchées : Joseph décrit les conditions difficiles, les bombardements, le froid, la boue, mais aussi les moments de calme.
Relations familiales : Il exprime son amour pour sa famille et son espoir de les revoir après la guerre. Il demande régulièrement des nouvelles de sa grand-mère et de ses proches, montrant son souci pour leur bien-être. Les lettres sont une source de réconfort pour lui, lui permettant de rester connecté à sa famille.
Foi et espoir : Il mentionne souvent ses prières et sa foi en Dieu pour protéger sa famille et lui-même.
Actualités militaires : Il parle des mouvements de troupes, des offensives, et des nouvelles du front.
Vie quotidienne : Il évoque les repas, les colis reçus de sa famille, les moments de repos, et les interactions avec ses camarades.
Événements marquants :
Joseph a participé à plusieurs batailles, notamment dans la Marne, Verdun, et la Somme.
Il a été blessé en 1914 mais est retourné au front après sa convalescence.
Il a été tué le 25 septembre 1916 lors de la bataille de la Somme, à la ferme du Prietz près de Combles, par un obus.
Style et ton :
Les lettres sont écrites dans un style simple et sincère, reflétant les émotions d'un jeune homme confronté à la guerre.
Malgré les difficultés, Joseph reste optimiste et encourage sa famille à garder espoir.
Hommage posthume :
Joseph Gouzou a reçu la Croix de guerre avec étoile d'argent à titre posthume.
Son corps n'a jamais été transféré dans une nécropole, mais il a été enterré sur le lieu de sa mort.
Importance du document
Témoignage historique : Ces lettres offrent un aperçu précieux de la vie d'un soldat pendant la Première Guerre mondiale, ses pensées, ses peurs, et ses espoirs.
Mémoire familiale : Elles témoignent de l'amour et des liens familiaux qui perdurent malgré la séparation et les horreurs de la guerre.
Hommage aux soldats : Elles rappellent les sacrifices des millions de soldats qui ont combattu et perdu la vie pendant ce conflit.
Dans ses lettres, Joseph Gouzou décrit la vie au front avec beaucoup de sincérité et de détails, alternant entre les moments difficiles et les rares instants de répit. Voici les principaux aspects qu'il évoque :
Premières Lettres et État d'Esprit
Dans ses lettres du 5 au 19 août 1914, il exprime son patriotisme et son espoir de revenir sain et sauf.
Il mentionne la mobilisation rapide et l'enthousiasme des soldats à défendre la France.
Blessures et Soins Médicaux
Le 10 septembre 1914, il est légèrement blessé à la jambe par un éclat d'obus lors de la bataille de la Marne. Il est évacué à Périgueux pour des soins, où il reste en bonne santé malgré sa blessure.
Il mentionne également un camarade, Jean Massoubro, qui est blessé en même temps.
Retour à Brive et Instruction des Soldats
Après sa guérison, il retourne à Brive en novembre 1914, où il attend de repartir au front.
Il est impliqué dans l'instruction de nouveaux soldats, espérant ne pas être envoyé au front immédiatement.
Il fait état de la formation de nouveaux bataillons et de l'absence de permissions en raison de l'épidémie de scarlatine.
Espoir de paix et retour à la vie normale
Gouzou exprime un désir constant de paix et de retour à la vie normale. Il évoque des moments de nostalgie, souhaitant participer aux vendanges et aux activités familiales.
Son espoir de retrouver sa famille et de vivre ensemble est un thème récurrent dans ses lettres.
Conditions de vie dans les tranchées :
Dureté du quotidien : Joseph parle souvent de la boue, du froid, de la pluie, et parfois de la neige. Il mentionne également les longues marches, les nuits sans sommeil, et les conditions insalubres.
Bombardements et dangers : Il décrit les bombardements fréquents, les attaques ennemies, et les pertes humaines. Il parle aussi de la peur constante et de la vigilance nécessaire pour survivre.
Abris rudimentaires : Il évoque les « gourbis » (abris souterrains) où il dort, parfois bien aménagés, mais souvent infestés de rats.
Ravitaillement et nourriture :
Joseph mentionne les repas simples fournis par l'armée, mais aussi les colis envoyés par sa famille, qu'il apprécie énormément. Il parle de pâtés, de boudins, de quartiers d’oie, et d'autres conserves qui améliorent son quotidien.
Il souligne parfois les difficultés de ravitaillement, notamment dans les zones de combat.
Moments de calme et de répit :
Repos en arrière des lignes : Lorsqu'il est en réserve ou au repos, il décrit des moments plus tranquilles, où il peut se laver, se raser, ou dormir dans un lit. Ces périodes sont rares mais précieuses.
Activités pour passer le temps : Il parle de jeux de cartes, de promenades, et de messes auxquelles il assiste régulièrement.
Relations avec les camarades :
Joseph évoque souvent ses camarades, avec qui il partage les repas et les moments difficiles. Il mentionne également des soldats de son village ou de sa région, ce qui renforce son sentiment de solidarité. Il mentionne des camarades de guerre, certains étant blessés, et se préoccupe de leur bien-être.
Il parle avec respect de ses supérieurs et de ses compagnons, soulignant parfois leur courage.
État d'esprit et moral :
Courage et résilience : Malgré les épreuves, Joseph montre un grand courage et une volonté de tenir bon. Il encourage sa famille à garder espoir.
Foi religieuse : Il prie souvent et assiste à des messes, trouvant dans sa foi un réconfort face aux horreurs de la guerre.
Espoir de paix : Il exprime régulièrement son désir de voir la guerre se terminer et de retrouver sa famille.
Perception de l’ennemi :
Joseph parle des Allemands (« Boches ») avec une certaine distance, les décrivant comme des adversaires redoutables mais parfois affaiblis par les offensives françaises et alliées.
En résumé
Joseph Gouzou décrit la vie au front comme un mélange de souffrance, de danger, et de solidarité. Il ne cache pas les difficultés, mais il met aussi en avant les moments de répit et son espoir de retrouver sa famille. Ses lettres témoignent de son courage, de son humanité, et de sa capacité à trouver de la force dans les petites choses du quotidien. En résumé, ce document est un témoignage émouvant et détaillé de la vie d'un soldat pendant la Grande Guerre, mettant en lumière les réalités humaines derrière les événements historiques.
En marge : Les courriers de poilus : les consignes de l’armée sont strictes.
5% des courriers des poilus soit 1 million de lettres sont ouvertes durant le conflit, quelques fois confisquées, lorsque la censure découvre des propos séditieux. La censure lit tout, déchiffre tout.
Saint-Astier
Pierre Neyssensas nait le 23 juillet 1879 à Saint-Astier, cultivateur, fils de Sicaire et Marie Bunlet domiciliés à Saint-Astier. Pierre est époux de Marie Bouchillou, mariés le 1er juillet 1902 à Chantérac.
Matricule 1190, 1 m 62, Pierre est inscrit Service Auxiliaire suite à une pointe de hernie à gauche et mobilisé seulement le 20 janvier 1915. Pierre part au front le 1er septembre 1915 au 27 mai 1918.
Pierre, 39 ans, est fait prisonnier le 28 mai 1918 lors de la seconde bataille de la Marne. Ce même jour, le 1er bataillon du 156ème régiment d'infanterie combat à Brenelle contre les troupes allemandes du 10ème Corps d'Armée. Submergé par le nombre et le manque de munitions, le bataillon se replie, vers 7 h du matin après une chaude résistance, vers Ciry-Salsogne et le moulin de Quincampoix.
Pierre est interné au camp de Cassel, puis transféré à Friedrichsfeld le 26 septembre 1918. Pierre est rapatrié le 16 décembre 1918, passe au 50ème régiment d’infanterie le 17 janvier 1919. Le 26 février Pierre est de retour en Dordogne, à Chantérac plus exactement.
Camp de Cassel – Niederzwehren
Situé dans la région de Hesse-Nassau, à proximité de Hanovre, le camp de Cassel peut détenir environ 19 000 prisonniers, ceux-ci y subissent, en 1915, deux épidémies de typhus. En mars 1917 on dénombre 9 153 militaires français détenus à l'intérieur du camp. Outre les prisonniers militaires, on compte aussi quelques prisonniers civils. Le camp se compose de plusieurs petits camps dont Niederzwehren. Il y a deux pénitenciers situés à Fulda et Cassel-Wehlheiden, 2 500 commandos sont rattachés à Cassel, 276 fermes, 148 fabriques et 14 mines (charbon, manganèse, argile, sels de potasse).
Camp de Friedrichsfeld
« Réveil à 5 h, départ pour le chantier à 6 h, repos de 8 h à 8 h 30. Pause à 12 h-13 h 30, 4 h-4 h 30 pause. Travail jusqu'à 6 h », le travail consistant à charger des pierres dans des wagons ou du poussier de charbon dans des bennes.
Saint-Astier
André Neyssensas nait le 2 janvier 1896 à Saint-Astier, carrier, fils de Joseph, cultivateur, et Marguerite Verninas, couturière, domiciliés à Saint-Astier. André est le 2ème fils du couple à partir au front. Le frère d’André, Paul, est décédé le 8 septembre 1914 à Vitry le François dans la Marne. Lors de son recrutement, André porte le matricule 64, sa taille est d’1 m 69, son degré d’instruction est de 2.
André est incorporé le 10 avril 1915, soldat de 2ème classe. André part sur le front le 2 décembre 1915, soit un peu plus d’un an après le décès de son frère. André passe au 106ème régiment d’infanterie le 16 avril 1916 et quitte le front après sa blessure le 24 juin 1916, à la batterie de Damloup dans la Meuse, lors de la bataille de Verdun, par éclat d’obus côté droit de la tête. La batterie de Damloup se situe à proximité du fort de Vaux. La batterie est constituée de 3 traverses édifiée en 1881. Elle peut être armée de 6 canons de 95 mais sert plutôt d'abri de combat.
André repart à nouveau pour le front le 28 juillet 1916, devient soldat de 1ère classe le 5 janvier 1918 puis caporal le 11 mars 1918 juste avant sa captivité le 31 mars 1918 à l’âge de 22 ans. André reste en captivité jusqu’au 10 janvier 1919, sans que la fiche, hélas, ne mentionne son lieu de détention.
André disparait lors de la bataille d’Amiens et la prise de Montdidier, le 30 mars 1918 à Mesnil Saint-Georges dans la Somme.
« Le 30 mars, dès l'aube, un violent bombardement de mines et d'artillerie précède une nouvelle attaque allemande. Devant Mesnil, le 106ème de ligne brise quatre attaques du 7ème Grenadiers allemand dans la matinée, mais dans l'après-midi, vers 17 heures, après que la gauche française a fléchi sous un bombardement effroyable. Les Allemands abordent le village par le nord. Les Français le défendent maison par maison et ne l'abandonnent an feu que vers 18h30 pour s'établir à 200 ou 300 mètres en arrière. Sur la droite, les 19ème et 154èmerégiments allemands s'emparent du Monchel et d'Ayencourt et ne peuvent en déboucher sons les feux du 132ème de ligne qui leur interdit les abords sud-ouest de Mesnil et les approches de Royancourt ».
André est rapatrié et arrive au dépôt des isolés de Limoges le 16 janvier 1919. Envoyé en congé illimité de démobilisation le 20 septembre 1919.
André, cultivateur, habite Jevah - Saint-Astier, lorsqu’il se marie le 29 avril 1920 à Saint-Astier, avec Élise Eclancher, cultivatrice, habitante de Jevah. Leur premier enfant, Robert nait le 24 janvier 1921, marié avec Anne-Marie Leconte.
Antonne
Neycensas Alphonse Henri, nait à Antonne le 2 aout 1887, cultivateur, fils de Germain et Marie David. Matricule 439, taille 1 m 75, degré d’instruction générale 2, appartenant au 154ème régiment d’infanterie à compter du 8 mai 1916, Alphonse disparait le 29 mai 1916 à Cumières lors de la bataille de Verdun à l’âge de 29 ans.
« Le 29 mai, un violent bombardement d’obus de tous calibres et principalement du 210, s’abat depuis le Mort-Homme jusqu’au village de Cumières. Les tranchées et boyaux considérablement endommagés par les tirs des jours précédents sont complètement nivelés. Plusieurs attaques d’infanterie allemandes sont repoussées. Vers 18 heures, une violente série d’attaques, menées par des troupes fraiches, depuis le Mort-Homme, le ravin de Chattancourt, le ravin des Caurettes et le nord-est de Cumières, combinée à une attaque de front à partir du bois des Corbeaux a raison des unités françaises de 1ère ligne dont les effectifs sont considérablement réduits. Le combat dure toute la nuit.
Le 30 mai, à 10 heures, après deux jours de bombardements continus, l’infanterie allemande attaque sur tout le front. Les troupes françaises, refoulées par des forces supérieures, sont obligées de se replier vers Chattancourt ».
Alphonse est détenu prisonnier à Stuggart. Victime d’un accident de travail lors de sa captivité le 22 septembre 1917, avec « voussure de la colonne vertébrale », Alphonse est dirigé, après avril 1918, vers Montana, étape vers sa libération.
La Convention de Genève du 6 juillet 1906 stipule que les belligérants peuvent échanger et rapatrier des blessés et des malades ou les remettre à des pays neutres pour les interner jusqu'à la fin des hostilités. Conformément à cette convention, les deux camps se mettent d'accord en 1915 pour un échange des grands blessés ou malades, mais il n'en est pas de même pour ceux qui sont moins gravement atteints, comme Alphonse. Les accords de Berne du 26 avril 1918 règlent enfin la question du transfert des prisonniers les moins atteints. Alphonse est interné en Suisse, dans la station climatique de Montana, afin d’y être soigné.
 |
| Alphonse arrive en gare de Sierre près de Montana et se dirige vers |
 |
| vers le funiculaire puis parvient au sanatorium de Montana |
 |
| L’Express du Midi du 8 aout 1918 |
Alphonse est rapatrié le 7 décembre 1918 et passe au 50ème régiment d’infanterie le 11 janvier 1919.
Alphonse, sans profession, domicilié aux Garennes à Antonne, se marie avec Jeanne Etienne, sans profession, domiciliée à l’Arsault à Trélissac, le 21 décembre 1920, à Trélissac. Le couple habite l’Arsault en 1921. (Recensement 1921).
Mensignac
Laurent Neycenssas nait le 11 février 1884 à Mensignac, cultivateur, fils de Laurent et Anne Ducher, matricule 691, taille 1 m 67, affecté au 50ème régiment d’infanterie le 3 aout 1914, passé au 153ème régiment d’infanterie le 2 juin 1915.
Laurent disparait le 7 avril 1916 à Haucourt dans la Meuse lors de la bataille de Verdun à l’âge de 32 ans.
Le 153ème à Haucourt « Combat de la cote 304 : le 31 mars, la division, après un court repos dans la région de Saint-Dizier, près de Bar-le-Duc, reçoit l'ordre de tenir le secteur de la rive gauche de la Meuse, entre Malancourt et Béthincourt. On s'attend à une nouvelle ruée allemande.
Le 5 avril, le 153ème se met en roule pour relever le 69ème régiment d'infanterie vers Haucourt et l'ouvrage de Palavas. A Esnes, il apprend que l'ennemi a attaqué, s'est emparé d'Haucourt et de Palavas, et que 7 officiers du régiment partis en reconnaissance, ont disparu. Après une pénible contre-attaque, le régiment relève le 69ème aux ouvrages de Peyron et de Vassincourt. A peine est-il installé qu'une forte attaque se déclenche le 7, à 17 heures. Elle est arrêtée. Une demi-heure après, elle recommence, et grâce à un effroyable bombardement, elle prend pied dans Vassincourt et Peyron. Puis, après deux jours de bombardement, les Allemands tentent d'en déboucher et de prendre le bois Camard. Ils ne peuvent avancer. Une nouvelle tentative échoue, et une troisième également est enrayée le 10 avril. Lorsque, le 13, le 153ème est relevé, il tient le bois Camard et laisse la cote 301 intacte au 2ème bataillon de chasseurs à pied.
La terre de Verdun devenait un champ de mort effroyable, où les deux Armées s'écrasaient sur place. Et il devait en être ainsi huit mois encore ».
Laurent est prisonnier à Darmstadt à compter du 24 mai 1916
 |
 |
| Laurent au camp de Darmstadt le 24 mai 1916 - archives de la Croix Rouge |
 |
| Présence de Laurent au camp de Darmstadt le 12 aout 1916 |
 |
| Présence de Laurent au camp de Darmstadt le 7 février 1917 |
Rapatrié le 8 décembre 1918 en France, le 22 mars 1919, Laurent est de retour à Mensignac.
Léguillac de l’Auche
Pierre Neycenssas nait le 1er février 1885 à Léguillac de l’Auche, manœuvre, fils de Jean et Anne Doche, tous domiciliés à Saint-Astier. Pierre se marie 6 décembre 1910 à Montrem avec Marie Beau.
Pierre porte le matricule 715, sa taille est d’1 m 57, son degré d’instruction de 2, rappelé à l’activité le 1er aout 1914 au 108ème régiment d’infanterie et arrivé au corps le 3 aout 1914. Pierre est fait prisonnier le 4 octobre 1914 à l’âge de 29 ans et dirigé vers le camp de Senne I en Allemagne.
Les trois camps de Senne pour prisonniers de guerre sont situés en Westphalie, au Sud-est de Münster (Senne I ou Sennelager, Senne II et Senne III).
Pierre, sur la fiche de la Croix Rouge, appartient au 308ème, en réalité le 308ème régiment d'infanterie est constitué en 1914 avec les bataillons de réserve du 108ème régiment d'infanterie. Le 24 mai 1916 Pierre est présent sur les listes du camp de Senne I.
Pierre est rapatrié le 8 octobre 1918, après 4 années passé en captivité, puis affecté au 50ème régiment d’infanterie le 8 décembre 1918 et envoyé en congé illimité de démobilisation le 12 mars 1919.
Razac sur l’Isle
André Neycensas nait le 27 octobre 1898 à Razac sur l’Isle, cultivateur, fils de Guillaume et Marie Castaing, domiciliés à Saint-Astier. André, soldat de 2ème classe, porte le matricule 553, taille 1 m 59, degré d’instruction 2, lorsqu’il incorpore le 73ème régiment d’infanterie le 3 mai 1917. André est au front à compter du 3 janvier 1918, passe au 127ème régiment d’infanterie le 14 mai 1918 puis disparait au front à Port-Fontenoy lors de la 3ème bataille de l’Aisne à l’âge de 20 ans.
L’offensive allemande du 24 mai 1918 - la bataille de l’Aisne
« C'est alors que l'ennemi décide une fois de plus d'en finir par une ruée colossale. Il franchit l'Aisne, atteint la Marne, attaque sur l'Oise et bientôt cherche à atteindre Paris.
Le 127ème est embarqué en camions - Cba et transporté dans la Région de Berny-Rivière, Horse, Roche, et Fontenoy.
Le 29 mai, l’état-major français quitte les grottes de Tartiers. Alors que le fanion du général commandant la 151ème division flotte encore sur le château de Fontenoy, un bataillon du 127ème entre dans le village le 30 mai à 10 heures du matin par un temps radieux. Mais, devant l’ampleur de l’offensive allemande le général évacua à la hâte son PC vers 6 heures du soir.
Le lendemain, sur ordre du quartier général, la population civile doit partir. Après avoir enlevé Tartiers, les Allemands entrent dans Fontenoy vers 18 heures et se battent avec les soldats du 127èmequi se repliait vers Roche ». La rupture du Chemin des Dames est engagée…
Les Allemands, en 3 jours, font 35000 prisonniers, parmi eux André qui est dirigé vers le camp de prisonniers de Soissons, le 31 mai 1918 - fiche matriculaire. Dans les jours qui suivent, les longues colonnes de prisonniers français marcheront vers Marle puis Hirson, d’où des trains vinrent les chercher pour les conduire dans des camps de prisonniers en Allemagne ». André resta-t-il à Soissons ou fut-il acheminé vers un camp en Allemagne comme celui de Lamsdorf en Haute Silésie ?
André sera libéré le 6 décembre 1918 et dirigé vers le dépôt des isolés de Limoges.
Après 1920, André est classé dans l’affectation spéciale comme homme d’équipe à la Compagnie d’Orléans. Les 17 mai 1921 et 25 aout 1927, André est domicilié à Juvisy. Entre temps, André se marie à Saint-Astier avec Maria Colinet le 17 juin 1922. Après le décès de Maria en 1931, à l’âge de 29 ans, André se remarie avec Noémie Maillard, décédée en 1955 à l’âge de 53 ans.
André décède le 2 mai 1972 à Blain en Loire Atlantique à l’âge de 73 ans et sera inhumé à la Souterraine dans la Creuse.
Prisonniers au front en 1914-1918
Moyenne d’âge des prisonniers : 28 ans
Fernand Neyssensas,
Frère de Paul décédé en 1914
Fernand est affecté au 21ème Régiment de Chasseur en octobre 1912, chasseur de 1ère classe le 11 novembre 1913, Sapeur le 18 novembre 1913 puis détaché à la Compagnie du Paris - Orléans en qualité d’homme d’équipe à la Gare de Périgueux. Fernand participe à la 1ère guerre mondiale du 2 aout 1914 au 16 aout 1919. Fernand est cité à l’ordre du régiment 401 du 4 février 1919. « Excellent cavalier, a fait toute la campagne et a rempli avec bravoure et dévouement toutes les missions qui lui ont été confiées. Croix de guerre avec étoile de Bronze ». Carte du combattant numéro 3410. Fernand habite successivement Périgueux en 1919, Bergerac le Buisson en 1928 et Poitiers, hameau Belair en 1933. (Fiche matriculaire)
 |
| Les grades cités sur les fiches matriculaires |
 |
| Les Neyssensas décorés |
2ème Guerre Mondiale
Sont relatés quelques parcours de vie de membres des familles Neyssensas lors des évènements historiques situés entre le 14 septembre 1939 et le 2 septembre 1945. Un Neyssensas décède lors de la guerre d’Algérie.
Jeudi 14 septembre 1939 - Nord des Açores, à bord du cuirassé Dunkerque
Par le hublot tout proche, un peu d’air frais vient jusqu’à moi et je vois fuir les nuages, le ciel… pas le temps. La fumée d’un voltigeur, la musique…. Et déjà mon être s’abandonne au charme ineffable et depuis longtemps ignoré du repos. Était-ce la guerre ? Douceur, douceur, rythmes changés, harmonies délicates et nuancées qui bercent mon corps, qui bercent mon âme et déjà font errer de chers rêves sous mes paupières closes. Souvenir, souvenir, qui nait et voici les chères images, les visages aimés qui me visitent. Souvenirs, maman, vous tous mes chéris…. Marcel…. Là-bas….
La sonnerie du poste de Combat m’arrache au Bonheur…. »
20 avril 1943, départ vers l’inconnu
Robert, déporté-résistant à Mauthausen en Autriche
Neyssensas Robert André nait le 24 janvier 1921 à Jevah, commune de Saint-Astier, fils d’André Neyssensas et Elise Eclancher. André est descendant de Charles, originaire de Léguillac de l’Auche, Astérien par mariage en 1677.
Robert, 22 ans, est garçon de café lorsqu’il est déporté dans le cadre de l’opération « Meerschaum ». Robert est dirigé vers Compiègne puis détenu au camp de Royallieu. Le camp est composé de personnes arrêtées par mesure de répression : résistants, politiques, raflés, otages, et parfois droit commun, quelle que soit leur nationalité.
Au départ de Compiègne, six convois quittent la France entre les 24 janvier et à fin juin 1943. Robert quitte le camp de Royallieu le 20 avril 1943 vers l’inconnu.
 |
| Camp de Royallieu - Baraquement - Arrivée au camp - Départ du camp |
Environ 35 000 hommes vont être transportés et c’est 4000 hommes qui quittent Compiègne en une dizaine de jours vers Mauthausen et Sachsenhausen au printemps 1943.
La grande majorité des convois des premiers mois de 1943 est composée de main d’œuvre de circonstance ; c’est la tentative de quitter le territoire, essentiellement à partir de 1943 et l’instauration du service du travail obligatoire qui est à l’origine de la moitié des arrestations, tous concernés par les lois vichystes des 4 septembre 1942 et 16 février 1943.
Le numéro matricule de Robert est le 28375. Ce sera son unique identité pendant l’incarcération.
 |
| The Arolsen Archives |
Robert est affecté le 19 juin 1943 à Wiener Neustadt (usine d’armement - environ 1000 déportés). C’est le début de l’atroce travail de la carrière, le revier, sans soin, où l’on bat les malades.
Robert est à nouveau déplacé le 30 octobre 1943 pour Schlier-Redl-Zipf (production de fusée V et atelier de faux monnayage - environ 1488 déportés), puis Ebensee le 4 mars 1944, (construction de galeries, production d’armements - 18437 déportés), le Camp central le 30 mai 1944, puis Linz III (usine d’armement - 5615) le 31 aout 1944.
Robert est libéré le 5 mai 1945 et quitte le camp de Linz III pour un rapatriement sur Mulhouse le 24 mai 1945. Robert est alors dirigé vers un sanatorium du Puy de Dôme.
 |
| Fiche présente sur le site Mauthausen |
Robert Neyssensas est mentionné dans le livre mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de répression et dans certains cas par mesure de persécution. Volume 4 de Michel Reynaud - Fondation pour la mémoire de la déportation - 2004.
En 1947, Robert Neyssensas est cité dans le Bulletin des Déportés Politiques de Mauthausen, en traitement depuis 2 années dans un sanatorium du Puy de Dôme.
« Robert Neyssensas, Gesland et Le Galleu, ces trois camarades, souffrent terriblement d’être immobilisés sur leur lit de douleur, loin de la vie active et de leurs camarades, Nous lançons, une nouvelle fois, un appel plus particulier à ceux qui ont vécu avec eux les moments difficiles de Mauthausen ou de ses kommandos afin qu’ils leur apportent le soutien moral et l’amitié qui n’a jamais fait défaut à aucun de nous là-bas. Ces camarades nous ont écrits, ils sont affreusement seuls ! Rendez-leur visite aussi souvent que possible puisque vous connaissez vous-même les bienfaits que représente la présence d’un camarade de combat près de celui qui a été blessé dans la lutte menée en commun ».
L’article cite Jean-Adolphe Le Galleu, peintre en bâtiment, décédé à l’âge de 27 ans. En 1941 engagé dans les F.T.P.F., il est l’un des responsables de la cellule communiste clandestine du Quartier du Fort. Le 2 septembre 1941, il est arrêté par la police française à son domicile et écroué à la prison de la Santé, puis Fresnes. Après une condamnation à 5 ans de travaux forcés, il est déporté le 1er avril 1944 à Mauthausen et libéré le 29 avril 1945. Il participe à l'organisation de la résistance clandestine dans le camp. Il est hospitalisé à son retour, dans un hôpital Parisien. Le 24 décembre 1947, il décède, malade et très affaibli suite à sa déportation.
Le 20 avril 1943, 7 périgordins quittent Royallieu en compagnie de Robert, le plus jeune d’entre eux. Fernand Barbut de Brantôme, 33 ans, Vincent Chasseing, de Bergerac, 47 ans, Gabriel Cornu d’Issigeac, 51 ans, Henri Debat de Terrasson, 42 ans, Charles Delerm de Nontron, 39 ans, André et Henri Lacoste de Chantérac, 32 ans.
Sur les 997 déportés, tous de sexe masculin, on dénombre 4 Polonais, 1 Belge, 1 Anglais, 394 décèdent dans les différents camps, 7 s’évaderont, 27 sont portés disparus, et 517 rentrent de déportation.
Le 18 juin 2015 est inauguré à Saint-Léon sur l'Isle un mémorial dédié aux 81 déportés des 22 communes de la vallée de l'Isle.
La Communauté de Communes Isle-Vern-Salembre et les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation de la Dordogne (A.F.M.D.), portent la réalisation du projet en partenariat avec le Souvenir français.
La stèle, fabriquée par l'entreprise locale Martrenchard et installée en bordure de l'Isle, porte sur de lourdes plaques noires les noms des quatre-vingt-un déportés gravés en lettres d'or. Ils étaient communistes, résistants, juifs ou simples citoyens et ont connu l'enfer des camps.
Certains en sont revenus, la plupart ont été condamnés par l'enfer concentrationnaire. Tous étaient originaires d'Annesse-et-Beaulieu, Beauronne, Chantérac, Coursac, Douzillac, Grignols, Jaure, La Chapelle-Gonaguet, Léguillac-de-l'Auche, Manzac-sur-Vern, Mensignac, Montrem, Neuvic, Razac-sur-l'Isle, Saint-Aquilin, Saint-Astier, Saint-Germain-du-Salembre, Saint-Jean-d'Ataux, Saint-Léon-sur-l'Isle, Saint-Séverin-d'Estissac, Sourzac, Vallereuil.
 |
| Parmi ces déportés, dix-huit étaient nés à Saint-Astier |
Robert se marie le 16 septembre 1949 avec Anne-Marie Leconte, infirmière. Vu dans l’Auvergnat de Paris du 15 octobre 1949 page 8.
 |
| Signature du père de Robert, André en 1921 |
Robert décède à Menton le 20 septembre 1983.
Références des dossiers de Robert à Vincennes et Caen
20 avril 1943, départ vers l’inconnu
Neycenssas Pierre, nait le 11 novembre 1920 à Cours-de-Monségur, lieu les Gauchers, en Gironde, fils de Louis, facteur, 36 ans et Jeanne Marguerite Régimon, 27 ans.
 |
| Signature de Louis |
Pierre, 23 ans, matricule 33136, meurt en déportation le 17 octobre 1944 à Melk (Autriche).
Melk est localisé à environ 100 km de Lintz en Autriche. Le camp, environ 8000 prisonniers, fournit la main-d’œuvre pour la réalisation de plusieurs tunnels dans les collines composées de sable et de quartz. (Tunnels pour usines - 10414 déportés).
Melk et le projet Quartz
La garde du camp est assurée par des hommes de la Luftwaffe.
Les déportés partagent avec leurs gardiens la caserne von Birago. Les troupes occupent les bâtiments en dur, les détenus occupent les garages et baraques construites dans l’enceinte de la caserne clos par une double rangée de barbelés électrifiés.
Le 8 juillet 1944, le camp sera bombardé par méprise : les victimes se comptent par centaines.
Une partie des détenus est affectée à la construction de l’usine souterraine d'armements et de roulements à billes du chantier de Roggendorf, à 7 km, en direction de Vienne. Une liaison ferroviaire assure huit navettes par jour.
Le 23 avril, en même temps que s'achève la pose des miradors et la double rangée de barbelés électrifiés délimitant le camp, les premiers coups de pioche sont donnés dans la colline de Roggensdorf. Il faut construire des usines souterraines d'armements.
Les déportés travaillent par équipes de 12 heures jour et nuit, dans le froid, sans sécurité, au percement de tunnels. L’effectif moyen du camp, à partir de Juillet 1944, tourne autour de dix mille détenus. Les pertes sont sévères.
En janvier 1945, mille morts sont dénombrés. Les blessés et les malades sont évacués vers le camp central de Mauthausen. Un crématoire entre en service le 1er novembre 1944. Trois médecins, Le Mordant (français), Szucs (hongrois) et Zora (autrichien), médecin de la Luftwaffe, font preuve d’un remarquable dévouement pour tenter de porter secours aux malades.
Le camp est évacué entre le 15 et le 20 Avril 1945, en partie vers le camp central, en partie vers Ebensee, libéré le 6 mai : évacuation et changement de camp entraînent encore de lourdes pertes dans les dernières semaines. Au total, entre quatorze et quinze mille déportés passent au camp de Melk, parmi lesquels quatre mille huit cents périssent, dont six-cent-soixante-trois Français.
Bulletin de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
No 37 Avril 2003
Par arrêté du 4 avril 1995, l’acte de décès de Pierre porte la mention « Mort en déportation », peut-être des suites d’une pneumonie ?
Service historique de la Défense, Caen : Dossier individuel de personnel de Neycenssas Pierre - AC 21 P 520424
La liste officielle des prisonniers de guerre français, d'après les renseignements fournis par l'autorité militaire allemande, note la présence de 3 autres membres des familles Neyssensas, prisonniers de guerre.
« L’autorité Militaire Allemande fera tous ses efforts pour que les familles françaises soient renseignées rapidement sur le sort de leurs prisonniers. Aussitôt que le service postal fonctionnera, les communications écrites entre les prisonniers et leurs familles existeront, conformément aux dispositions des Conventions Internationales. L’envoi de courrier ou de colis avant la date qui sera fixée est absolument inopportun et ne fait que surcharger inutilement les services postaux. Les visites aux prisonniers sont interdites ».
Neycensas André nait le 28 janvier 1914 à Saint-Léon sur l’Isle de Gaston François Sicaire, 31 ans, et Marie Emilie Neycensas, 24 ans, cultivateurs au lieu-dit Puypinssou à Saint-Léon sur l’Isle.
André est 2ème classe au 63ème Régiment territorial mobilisé à partir du 3 septembre 1939 dans la région de Clermont-Ferrand. Stationné en Alsace en mai 1940, la division tente de retraiter vers le Sud mais la retraite des troupes de l'Est est bloquée par la Wehrmacht et les dernières unités de la division sont capturées le 22 juin 1940 à Bussang.
L’information fournie par l’autorité Allemande le 19 septembre1940 n’indique pas le lieu de déportation d’André.
André décède en juin 1965 à Saint-Michel de Double.
Neyssensac Gaston, nait le 2 novembre 1908 à Saint-Laurent sur Manoire, des époux Louis, 36 ans et Marie Papon, originaire du Change, 34 ans, cultivateurs à Malivert, mariés en 1872 à Boulazac.
L’autorité Allemande le 23 septembre 1940 déclare Gaston, 2ème classe aux 22èmes sections d'infirmiers militaires (22ème S.I.M.), prisonnier, sans lieu de détention mentionné.
 |
| Cantonnement du 22ème SIM - Caserne Mortier à Paris |
Gaston décède le 2 janvier 1980 à Périgueux.
Neycensas ou Neyssensac Laurent nait à Saint-Sulpice de Faleyrens le 23 septembre 1911, lieu-dit Bertinat, des époux Jean, cultivateur nait en 1872 à Montpon, et Marie à Saint-Emilion en 1883, cultivatrice. Un autre enfant, Roger, est né en 1909 à Saint-Emilion.
Une autre famille Neyssensas est installée à Saint-Sulpice de Faleyrens vers 1926. Jean et Marie n’habite plus Saint-Sulpice en 1926.
L’information fournie par l’autorité Allemande, le 2 janvier 1941, mentionne le grade, le régiment et le lieu de détention de Laurent.
Laurent est 2ème classe au 77ème régiment d’infanterie lorsqu’il est fait prisonnier et dirigé vers le Stalag III B.
Le Stalag III-B est situé dans l'actuelle ville d’Eisenhüttenstadt (anciennement Fürstenberg-sur-Oder), en Allemagne, à l'actuelle frontière polonaise. C'est un camp de travail pour les prisonniers de guerre américains, britanniques, italien et français. Le Stalag III-B comptait annuellement 20.000 français. Seuls 10% environ demeuraient au stalag dans le camp de Fürstenberg sur Oder.
Les 18000 autres étaient disséminés dans les 600 kommandos de travail dans le Brandebourg et la Forêt de la Sprée.
Les prisonniers du camp sont libérés par la 33ème Armée de l'Armée Soviétique courant février 1945.
Les « oubliés » du 3 juillet 1940
Bataille de Mers El Kébir - Oran (Algérie)
A bord du cuirassé Dunkerque
1939 - 1940
Par Maurice Neycensas
2) Extraits des conférences sur le drame de Mers El Kébir, présentées entre 2019 et 2020, par Monsieur Martial Lehir, ancien de la Royale, auteur avec Hervé Grall, historien et géographe de "La mémoire de Mers El Kébir de 1940 à nos jours".
4) Extrait du journal personnel de Maurice Neycensas (1940)
Etat des Services et récit des évènements du 3 juillet 1940 par Maurice Neycensas,
Marin, second-maître canonnier à bord du cuirassé Dunkerque.
Pierre Maurice Neycensas naît à Saint-Astier le 25 janvier 1917, fils d’Henri et de Germaine Royer.
Après quelque mois en qualité de stagiaire élève-maître à l’école de Saint-Médard de Mussidan, en octobre 1936, Maurice Neycensas est nommé instituteur stagiaire à l’école de Mussidan le 4 janvier 1937.
Le 1er septembre 1937, Maurice Neycensas devance l’appel. Il est incorporé « matelot sans spécialité de 2ème classe » au 5ème dépôt des équipages de la flotte à Toulon sous le matricule 528 - R - 37 en attente d’embarquement.
Etats des services
Du 1er septembre 1937 au 4 octobre 1937 - présent au 5ème dépôt de Toulon
Du 5 octobre 1937 au 1er avril 1938 - cuirassé Paris - école de canonnage
Du 1er avril 1938 au 1er octobre 1938 - croiseur Foch
1er octobre 1938 au 12 juin 1939 - croiseur Tourville
19 juin 1939 au 29 juin 1940 - cuirassé Courbet
30 juin 1940 au 17 juillet 1940 - cuirassé Dunkerque
Le 1er avril 1938, Maurice Neycensas est promu « quartier-maître canonnier » à bord du cuirassé Paris, puis « second-maître canonnier » ou pointeur d’artillerie, le 1er avril 1939. (Annexe : le métier de canonnier).
Le 2 avril 1938, c’est à bord du croiseur Foch que
Maurice Neycensas perfectionne son apprentissage,
« Mardi 13 juin 1939, parti en permission Vendredi soir. En arrivant à Saint-Astier, je trouve un télégramme de rappeler. Permission brisée, désirs naissants refoulés, Laurent, les parents. Mais retour dimanche - lundi 19 je débarque au dépôt et c’est le Courbet et la promesse d’un assez joli voyage, Oran, Casablanca, Quiberon, cette perspective détruit une partie de mes regrets, revoir l’Afrique …. La Bretagne accueillante… » Extrait journal de bord sur le Courbet.
Le 19 juin 1939 affectation sur le Courbet jusqu’au 29 juin 1940
Dernière affectation sur le cuirassé Dunkerque du 30 juin 1940 au 17 juillet 1940
La durée du service militaire, dans les années 40 est de 2 années. Maurice Neycensas doit terminer son service militaire le 31 aout 1939 lorsque la mobilisation générale est décrétée.
Nous sommes le 1er septembre 1939
Maurice Neycensas est maintenu à bord du Dunkerque. Le cuirassé se destine à contrer les cuirassés de poche allemands, jusqu’au 3 juillet 1940, date où il sera gravement endommagé par la flotte anglaise à Mers-el-Kébir en Algérie.
Nota : Mers El Kébir (département d'Oran) est un port depuis l'époque romaine. En 1937 le projet d'y implanter une base navale se dessine. Les travaux de construction débutent en 1937 et continuent jusqu'en 1945.
En 1939 la rade de Mers-El-Kébir est définitivement mise à la disposition exclusive de la Marine de guerre.
Après des réparations provisoires le Dunkerque rejoint Toulon par ses propres moyens et se saborde lors du coup de force allemand du 27 novembre 1942.
Le 16 juillet 1940 Maurice Neycensas est « renvoyé dans ses foyers » rue George Clemenceau à Saint-Astier.
Le cuirassé Dunkerque et la Force de Raid
Le cuirassé Dunkerque est lancé à Brest le 2 octobre 1935. D’une longueur de 215 mètres, d’une largeur de 31 mètres, il porte un équipage de 1 365 hommes et 66 officiers.
La Force de Raid a été dissoute après la bataille de Mers el-Kébir. La zone de responsabilité de la Force de Raid était la zone à l'est de la ligne Ouessant-Açores et Cap-Vert. Début avril, elle passe en Méditerranée, en raison de la menace de guerre avec l'Italie, revient très vite à Brest au moment de l'attaque allemande en Norvège et retourne fin avril en Méditerranée.
L'attaque britannique contre les navires de ligne de la Force de Raid basés à Mers el-Kébir, marque la fin de la Force de Raid en tant qu'unité opérationnelle de la Marine nationale française.
1er extrait des conférences présentées par Martial Lehir entre 2019 et 2020
Introduction
Les 1297 morts ou disparus de Mers el Kébir, les 350 blessés, les centaines de veuves et orphelins représentent une proportion infime au regard des millions de victimes du nazisme ou de celles des bombardements des villes anglaises, mais les morts d’Oran furent causées non par des ennemis mais par des compagnons d’armes, des alliés de la veille.
Les 3 et 6 juillet 1940, la Royal Navy tua plus de marins que la Krieg marine durant toute la guerre.
L’attaque de la flotte française hante encore les mémoires. La blessure dans le cœur des rescapés et des proches des marins disparus ne s’est jamais refermée. Assimilés à des vaincus, Vae-Victis, ils ont été traités comme les complices d’une défaite honteuse. Leur silence, interprété comme de la pudeur, n’était en fait que le résultat d’un véritable ostracisme à leur égard, et ce encore de nos jours. Il faisait revivre en eux les effets du terrible traumatisme qu’ils avaient subi pendant ce drame impensable.
Le sujet est resté longtemps un véritable tabou dénoncé en son temps par l’amiral Gensoul lorsqu’il rapporta, lors de sa déposition devant la commission Sablé, en mai 1946 : « Le souvenir de ces morts dérange tout le monde parce que l’événement échappe à la logique. Il est à part des tragédies de la guerre. Personne n’a intérêt à ce qu’on en parle de trop ».
Pourquoi les médias, vecteurs essentiels de l’information, susceptibles de toucher un large public, ne couvrirent pas l’évènement. Ce silence n’est pas anodin et a été volontairement entretenu entre 1945 et 1970, date de la mort du général de Gaulle. Un seul débat le 4 décembre 1979, aux Dossiers de l’écran se limitant à un affrontement franco-français.
Récit des événements de Mers El Kébir
Par Maurice Neycensas - 1992
« Le 30 juin 1939 suivant j’embarquai sur le « Dunkerque ».
Le vingt-deux octobre, ordre d’appareiller dans l’après-midi. J’écris en hâte à mes parents. C’est dimanche, une mini escadre formée du « Dunkerque », de deux croiseurs légers et de trois contre-torpilleurs, prend la mer à quatorze heures ».
Communication
2) Un cuirassé de poche est signalé dans l’Atlantique.
3) Ennemis possibles : Deutschland et sous-marins.
4) Au retour discrétion absolue.
A environ deux mille kilomètres de nos côtes, après un parcours sans alerte notable, nous rejoignons un convoi de vingt-cinq cargos escortés de trois croiseurs anglais et de trois contre-torpilleurs, le tout représentant une force imposante. Nous sillonnons l’océan, tout autour du convoi, à vingt nœuds. Nos contre-torpilleurs, vrais lévriers, chassent les sous-marins qui ont vite compris et s’éloignent. Deux pétroliers anglais, signalés, sont vite pris en charge et amenés au sein du convoi. Retour sans encombre.
Un mois après, jour pour jour, ravitaillement complet. Ordre d’appareillage à dix-neuf heures trente, accompagné de deux croiseurs légers - « Montcalm » et « Georges Leygues » - et deux de nos plus rapides contre-torpilleurs - « Volta » et « Mogador ».
Proclamation : Nous sommes chargés, de concert avec la Home Fleet, de traquer le paquebot « Bremen » et le cuirassé « Deutschland » (toujours lui). La Marine est divisée en groupes d’exploration. Le cuirassé « Hood » est sous nos ordres. Ennemis : sous-marins et bateaux de surface.
De mémoire de marin, c’était l’ouragan le plus dangereux jamais vu. Les croiseurs et les contre-torpilleurs étaient secoués comme fétus de paille et tout le monde tremblait pour son sort. C’était un spectacle d’une grandeur indescriptible et sans nul doute le plus effrayant qui soit pour ma jeune expérience de marin. Vous ne pouvez pas imaginer l’impression produite par une gîte de soixante degrés, lorsqu’on se trouve à quarante mètres de hauteur, dans la tour du Dunkerque. C’est tout simplement angoissant.
Quand il fallait prendre les repas, c’était tout autre chose. Plus de vent, mais des craquements prolongés et sinistres, le heurt brutal des vagues énormes brisant sur la coque, et une autre inquiétude nous prenait : on ne songeait plus au « Deutschland », mais à la capacité de résistance de notre maison d’acier soumise à des pressions colossales. La preuve, c’est qu’un secteur du premier pont s’est affaissé et il a fallu placer trois épontilles de soutien, l’infirmerie a été défoncée. Vraiment, personne n’était tranquille devant un tel déchaînement des éléments. J’ai beau chercher un mot qui puisse exprimer cette violence extrême, je n’en trouve pas ; je suis donc impuissant à vous faire partager les émotions qui naissaient de la colère du ciel et des eaux en furie.
L’escadre n’avançait plus qu’à quatre ou cinq nœuds et le froid s’accentuait d’heure en heure. Le 28 nous dépassions la latitude des Shetland et retardions nos montres d’une heure. A 61 degrés de latitude Nord, nous abordions la limite des glaces flottantes, pays légendaire aux mers chargées de mystère, aux tempêtes effrayantes et longues, aux brumes opaques, régions inhumaines où se jouaient le sort des bateaux et des vies humaines, lieux au silence lourd et insupportable, aux flots perfides, qui alimentaient les légendes et, pourquoi pas, la poésie des récits de Pierre Loti. Ici, la nature entière vous paraît hostile et pour corser cette impression, il ne fait jamais jour. Les matins ressemblent aux crépuscules et vous noient dans leur grisaille lugubre.
Et notre tragique équipé s’est poursuivie sans résultat. Même lorsque les grandes houles ont remplacé la tempête, le pessimisme ne nous a pas quittés. Cinq heures de veille avec le casque sur les oreilles pour cinq heures de repos (si l’on peut dire). Et chaque jour monter là-haut sans transition, par un froid sibérien. Un peu de vertige, mal à la tête, grande lassitude et il faut redescendre sous les gifles du vent. J’avais quand même le courage de résister au sommeil et j’écrivais un mot sur mon journal, un mot pour mes parents sans nouvelles : « Je vous parle pourtant chaque jour et jamais ma pensée ne vous quitte ». J’ajoutais un peu plus loin : « Pour la première fois, depuis plus d’une semaine, j’ai assisté à un semblant d’aurore, à une naissance de jour sans gloire, sans éclat, le pauvre soleil n’arrivant pas à percer les brumes de la nuit », et cette note : « Plus de beurre, mais des patates et des conserves ». Le premier Décembre, sur le chemin du retour, lui aussi, sans gloire, le « Hood » nous quitta pour rejoindre l’Angleterre. Ainsi, tout au long de ce qu’on a appelé la bataille de l’Atlantique, nos deux marines ont toujours agi de concert et une grande fraternité d’armes s’était créée, aussi bien chez les officiers que chez les marins.
Communication : La mission du « Dunkerque » est terminée. « Deutschland » repoussé vers le Nord-Est. Retour à Brest.
Le temps s’améliora progressivement et la douceur revint à mesure que nous nous rapprochions de nos côtes. Nous étions las, si las et nos jambes en flanelle qui réclamaient un grand moment de repos ! Pourtant, lorsque nous eûmes longé l’île d’Ouessant et que nous contournâmes la pointe Saint-Mathieu, un sourire béat éclaira tous les visages :
Brest et la France nous accueillaient de nouveau. Le Dunkerque fut ramené à quai, dans l’enceinte de l’arsenal, pour des réparations rapides et, une fois de plus, nous comprîmes que Noël était à l’eau.
A peine une semaine de détente et nous voilà mobilisés pour une corvée de légumes très spéciale : sous forme de caissettes, nous embarquons pour cinq milliards de lingots d’or fin (100 tonnes).
Le douze Décembre 1939 : destination Halifax, au Canada.
Route vers le nord des Açores, avec le croiseur « Gloire » et les contre-torpilleurs Volta, Mogador, Triomphant, Indomptable, Vauquelin. Avec une escorte de cette trempe, nous ne risquions rien des sous-marins. Mer d’huile, temps splendide. Après quarante-huit heures de mer et environ 1 800 kms parcourus, nous continuons seuls avec l’unique « Gloire », la traversée de l’Atlantique.
Le 13 Décembre, on apprend que le cuirassé de poche allemand « Graf Spee » est intercepté par trois croiseurs anglais et que, touché sérieusement, il s’est réfugié dans la rade de Montevideo. Je me rappelle que la presse, trompée par les services allemands, révélait que le « Dunkerque » participait à la bataille navale. Folle inquiétude des parents. C’était faux.
Après une traversée de 7000 kms, vraiment sans histoire, nous arrivons le 17 en vue des côtes canadiennes.
Une chose m’a frappé : presque tout notre voyage s’est effectué par beau temps et surtout par une température idéale, ceci tant que l’océan s’abreuvait du Gulf Stream, courant tiède. Sans transition aucune, dans la nuit du 15 au 16 Décembre, le froid survint et le thermomètre afficha zéro degré. Nous venions de pénétrer dans la zone d’influence du courant froid venu du Labrador. Donc le 17 à dix heures, nous entrions dans le port d’Halifax, grand port regorgeant d’activité. De nombreux paquebots et un grand mouvement de cargos. Des quantités de bois en dépôt, des silos à grains avec de grands élévateurs.
La presse, une nouvelle fois et à dessein, pour abuser la population, annonce que le « Graf Spee » va sortir de Montevideo, attendu par le « Dunkerque » et « L’Arc Royal », porte-avions anglais. Ni l’un, ni l’autre de ces navires n’étaient sur les lieux, le « Dunkerque » se reposant à Halifax.
Le 18 nous avons appris que le « Graf Spee » s’était sabordé et que son commandant s’était fait sauter la cervelle.
Le « Dunkerque », conduit à quai, s’empressa de se défaire de sa cargaison insolite et précieuse, sous l’étroite surveillance des nôtres et de la police canadienne.
Des cinq jours passés à Halifax, je n’ai pas gardé un souvenir impérissable. Rien ici ne correspondait à l’idée qu’on peut se faire du Canada, surtout du Québec. En réalité, nous étions dans un port véritablement anglais, vivant au rythme de la vie anglaise. Pour s’amuser, on s’y est essayé. A seize heures, thé avec cake. A dix-huit heures, cinéma, à vingt et une heures, au restaurant, assiette anglaise.
On ne comprenait pas grand-chose aux conversations, alors on lançait des vannes, on charriait la serveuse qui était sans doute ce que l’on avait vu de plus joli dans cette ville triste ; on pensait et on disait qu’elle était bien trop brune pour être anglaise. Par moments, elle souriait … A la fin du repas, elle prit son air le plus espiègle et nous gratifia d’un : « Messieurs les marins français, êtes-vous satisfaits ? Désirez-vous autre chose ? » Un peu moqués mais beaux perdants, nous répondîmes en chœur : « Un baiser ». Mutine, elle acquiesça gentiment et nous donna un baiser retentissant, au milieu des rires évidemment. Bien sûr, elle ne pouvait être que canadienne française et elle eut plaisir à causer un moment avec nous, ce qui lui manquait beaucoup.
Un autre soir, j’étais avec deux copains. Un canadien du cru, qui avait fait la guerre précédente - c’est ce qu’on a fini par comprendre - nous dit sa grande joie de revoir enfin des marins français et tint absolument à nous offrir un drink bien tassé (je crois qu’on dit un long drink). En vrais gentlemen, nous avons remis ça trois fois et l’ancien soldat canadien de la guerre 14-18 est parti content. On voyait bien qu’il avait chaud au cœur, après l’arrosage intempestif de cette rencontre sûrement mémorable.
Le troisième soir, nous avons eu le privilège de nous rendre au Forum, assister à deux rencontres de hockey sur glace. Là, je puis vous dire que nous avons partagé l’enthousiasme des spectateurs. Sport méconnu pour nous, il nous passionna par les qualités exigées : puissance, rapidité, adresse et souvent élégance dans les évolutions de patineurs virtuoses. Une ombre au tableau : des chocs un peu rudes qui frisent parfois la brutalité.
Que dire des environs ? Le pays m’a laissé une impression de tristesse. Sortis de la ville, nous avons vu des conifères et encore des conifères, quelques chemins défoncés avec des masures en bois misérables. C’était en 1939.
Le dernier jour, en bon touriste qui se respecte, j’ai acheté trois fanions aux armes d’Halifax et plusieurs broches dorées ornées de la feuille d’érable, symbole du Canada.
Le 22 décembre au matin, le ciel se couvrit jusqu’à devenir sombre et plombé et les premiers flocons se mirent à danser. En temps normal, je suis toujours heureux de saluer la première neige et bien, en ce moment, pas du tout ; mon attention est absorbée par une agitation insolite.
A 13 heures trente très précises, cinq destroyers appareillaient vivement et partaient en reconnaissance.
Au passage de chaque paquebot, les milliers de mouchoirs et de petits drapeaux s’agitaient éperdument et, dans une réponse muette et navrante, les soldats se décoiffaient et brandissaient leurs calots longtemps, longtemps, dans les flocons qui s’épaississaient peu à peu.
Ce départ prenait des allures d‘exode sublime ; l’angoisse gagnait tout le monde, angoisse qui devint insupportable lorsqu’au départ de chaque nouveau vaisseau, s’élevait le chœur lugubre et lancinant des klaxons d’autos. Mon émotion était à son comble et je peux bien avouer que mes derniers instants à Halifax furent d’une tristesse poignante. Mes yeux s’embuaient malgré moi ; je voyais bien que tous les soldats, en rang serrés sur tous les ponts, sur toutes les passerelles, fixaient désespérément leur terre aimée et les mouchoirs lointains qui fuyaient, fuyaient pour s’évanouir enfin dans la brume et la neige.
Quand le « Dunkerque », resté le dernier, a quitté le quai, j’ai entendu l’appel ou l’adieu envoûtant des cornes et des klaxons, je l’ai entendu longtemps, longtemps comme une obsession sonore et pathétique qui ne pouvait se résigner à mourir. Si vous saviez comme je souhaitais à tous ces exilés, une traversée paisible et sans alertes. Mais l’océan a ses caprices et nul n’y peut rien. Le troisième jour, il commença à soulever les paquebots dans un mouvement lent et puissant de grande houle. Pauvres fantassins.
Dans l’après-midi du 24 décembre, le commandant souhaita un « Joyeux Noël » à l’équipage.
Joyeux ? C’est un terme coutumier mais la vérité c’est que personne n’était heureux, surtout pas les canadiens serrés comme des sardines et sûrement secoués par le mal de mer. On n’aurait pas dit que c’était dimanche, plutôt un jour comme les autres, avec les veilles intermittentes, avec la fatigue, avec une mer qui se fâchait, sous un ciel bas d’où tombait sans relâche une neige mouvante. Ce ne sont pas de vagues souvenirs que je vous raconte, c’est, mon cœur à nu, ce que j’écrivais sur le vif, dans mon journal de bord.
Quand, le service terminé, je rejoignais le cœur du navire, dans les tranches où nous vivions ou au mess, l’atmosphère changeait du tout au tout : il faisait doux, les bâbordais nous cédaient la place et, à notre tour, nous nous laissions bercer par les chants connus, par des musiques tour à tour rythmées et nostalgiques que nous prodiguaient les radios de bord. On oubliait la fatigue, certains se mettaient à danser, d’autres, comme toujours, envoyaient des plaisanteries qui volaient souvent au ras des pâquerettes, mais qui avaient le don de dérider les plus endurcis. Et puis, nous étions sur le chemin du retour et déjà quelques bouffées d’espoir, secrètement, nous ravigotaient et chassaient le spleen. Nous n’étions plus qu’à cinq mille kilomètres de chez nous !
Le 24 avril 1940, après ravitaillement complet, toute l’escadre appareille. Route au sud.
Jusqu’à ce jour, c’était maman qui, après avoir été ma fidèle accompagnatrice, était devenue ma correspondante attitrée. Durant deux ans et demi, ponctuelle, attentive à tous mes états d’âme, elle n’avait cessé de m’apporter, avec son amour et sa tendresse, toutes les nouvelles de la famille et aussi des bouffées d’air vivifiant du pays. Voilà que, décachetée, l’enveloppe me livrait une grande page avec l’écriture énergique et élégante de papa ; ma main trembla comme une feuille, oh ! pas de peur, mais d’une émotion venue de plus profond de mes entrailles.
« Avoir tant lutté pour la liberté et la justice, être au vingtième siècle et voir ce déferlement de haine qui peut nous conduire à l’esclavage, cela paraît impensable et pourtant … Maurice, pense à nous, pense à la liberté et surtout ne perds jamais courage, ne perds jamais espoir. Toi et moi savons bien qu’après la nuit, le jour se lève toujours et pourquoi pas un jour qui chantera ».
Au lieu de s’apaiser, mon émotion croissait à la lecture de ma précieuse lettre (elle est tellement précieuse, qu’elle est toujours là, dans mon journal). Avec elle, il y avait un petit papier portant quelques mots de maman ; vous pensez bien qu’elle ne pouvait s’empêcher de me dire son affection :
« Mon petit Maurice - Tu vois, papa a pu satisfaire ton envie d’avoir quelque chose de lui. Tout ce qu’il te dit lui tient tellement à cœur, son inquiétude à ton sujet, qu’il tient secrète, est tellement grande que je l’ai vu pleurer en écrivant sa lettre. Surtout n’en parle jamais. Tu sais, sous ses dehors un peu brusques, il est bon et très sensible ».
Ah ! Ces mamans : Ce sont des interprètes de première force, mais je suis sûr qu’elle avait oublié de me dire quelque chose, vous savez quoi ?
Que sur son petit papier il y avait des traces de larmes. Et moi, fier marin, qu’ai-je fait ? J’ai pleuré, par petits sanglots étouffés, comme un enfant tout chaviré par tant d’amour qui me submergeait. Ah ! J’oubliais, dans leur lettre à tous les deux, il y avait un brin de muguet au parfum évanescent et délicat, vrai message d’espoir ».
Echos de la Guerre
Heureusement, nous consultions la presse et j’ai retrouvé dans mon journal de nombreux articles de « L’Echo d’Oran » que j’avais découpés et une carte des opérations sur le front français où je notais jour après jour l’évolution de la situation militaire. L’inaction et le doute commençaient à peser sur les équipages.
Quelques articles de presse commençaient à parler de la drôle de guerre où il ne se passait rien et s’étonnaient de la passivité du commandement. Gamelin était alors chef d’état-major. Que faisaient nos troupes pendant que les allemands s’escrimaient à conquérir la Finlande et la Norvège ? Pourquoi ne pas en profiter pour porter la guerre en territoire allemand avec l’appui de nos plus proches alliés ? Mais qu’attendions-nous donc ? Et bien, tout simplement, on attendait que les allemands victorieux se retournent contre nous, ce dont ils ne se sont pas privés. J’avais la carte sous les yeux.
 |
| (Maxime Weygand, Paul Baudouin, Paul Reynaud et Philippe Pétain en mai 1940) |
Dès ce moment, les évènements se précipitent. La Hollande s’incline. Le 18, Paul Reynaud, président vice-président du conseil. Le général Gamelin est remplacé par le général Weygand. Le 27, le roi des belges capitule sans condition, mettant nos armées du nord dans une situation désespérée. Nos troupes sont acculées à la mer et c’est l’épopée tragique du rembarquement anglais, puis français à Dunkerque.
Ce n’est pas une victoire, mais sauver plus de 200.000 anglais et plus de 100.000 français, sous un déluge inimaginable d’obus, de bombes et de mitraille, sous des vagues incessantes d’avions ennemis, constituait l’exploit le plus extraordinaire de la guerre.
En même temps, le front français cédait de toutes parts sous la pression des tanks et des avions allemands. Chaque jour nous apportait des désillusions nouvelles et, au doute, fit place un déchirement sans nom, né de notre impuissance manifeste et du désordre offert par notre gouvernement qui croyait faire face en changeant quelques têtes. Bien sûr, il appela De Gaulle au ministère de la guerre après son exploit d’Abbeville où il fît souffrir les allemands, mais il était déjà bien trop tard (5 juin). Les vieilles barbes comme Gamelin ou Pétain en étaient encore à la guerre de grand-père alors que, dès le départ, il nous eût fallu des militaires au fait de la guerre moderne. Le 10 juin, l’Italie ayant compris que la France était perdue, nous déclara la guerre. On parlait de « coup de poignard dans le dos », mais Mussolini qui croyait avoir toutes les chances de son côté, qui pensait récolter les fruits de la victoire sans combats, se trompa lourdement. En effet, dès le lendemain, le Canada, l’Union Sud-Africaine, l’Australie et la Nouvelle-Zélande lui déclaraient la guerre.
Pour nous qui étions là, à attendre et à nous morfondre, alors que notre plus cher désir aurait été d’en découdre avec la marine italienne, perdre Paris était un drame et les mauvaises nouvelles se succédant à la même vitesse que les panzers allemands avançaient, nous étions pris par l’angoisse, vraiment perdus. Que ma famille et que la France puisse tomber sous la coupe d’Hitler me brisait l’âme. Si vous saviez comme dans ces moments de désespoir passager, ma famille qui était ma vraie patrie, se confondait avec l’autre, la grande et comme je les unissais dans le même amour immense et déchirant parce que, brusquement, j’avais peur de les perdre.
(Le 21 juin 1940, Ribbentrop, Keitel (de profil), Göring, Hess, Hitler, Raeder (caché par Hitler) et Brauchitsch, devant le wagon de l'Armistice)
Moi je pensais à Robert mon frère, à Marcel mon beau-frère, à Robert mon ami d’Eymet, et à tous mes camarades. Qu’étaient-ils devenus ? Etaient-ils vivants, ou prisonniers, ou marchaient-ils, sans chef, vers leurs familles ?
La force de raid (c’est notre escadre) restera donc momentanément à Mers El Kébir, en attendant de se soumettre aux conditions de l’armistice qui, aussitôt, inquiétèrent les anglais. Qu’allait devenir notre flotte, belle et quasi intacte ? Ce fût un tourment pour les anglais qui craignaient la mainmise des allemands sur elle.
« Hélas, nous ne les avons pas rejoints ».
L’enfer de Mers El Kébir
« En effet, nous sommes restés dans notre souricière, car la rade de Mers El Kébir en était une. Bien protégée du côté terre par les contreforts du Djebel Santon et par quelques forts, elle était trop largement ouverte du côté mer, et on la jugeait indéfendable face à une autre attaque venue du large.
Seule, une digue inachevée était juste assez longue pour abriter, s’il l’on peut dire, notre escadre. Ajoutez à cela que les forts de Mers-El-Kébir et du Santon ne disposaient que d’une artillerie hors du temps et inefficace, à côté des canons modernes à très longue portée des bâtiments de guerre. D’ailleurs une escadre au mouillage est toujours une cible de choix pour des navires ennemis. Distants d’une centaine de mètres les uns des autres, dans l’ordre : « Dunkerque », « Provence », « Strasbourg », « Bretagne » et « Commandant Teste », ces bâtiments étaient mouillés, l’arrière à la jetée, pour faciliter l’appareillage, mais l’artillerie pointée vers la terre, d’où grosses difficultés d’utilisation.
Mon poème commençait ainsi :
C’était le trois Juillet, devant Mers El Kébir.
Une aurore tranquille aux couleurs de l’Afrique
Eveillait doucement l’escadre pacifique.
C’était le trois Juillet, ô brûlant souvenir !
Sous le soleil d’Oranie, dans ce dernier matin,
Dieu qu’elle était belle notre flotte au mouillage !
Son image en nos cœurs reste comme un mirage,
Mirage d’orgueil et d’adieu pour les marins.
« C’est vrai qu’elle était belle notre escadre, c’est vrai que les matins étaient délicieux sous le soleil d’Oranie, c’est vrai que la mer s’éveillait doucement presque en silence, soyeuse, reflétant comme un vrai miroir toutes les lueurs de l’aube, du bleu profond au bleu pastel et, tout là-bas, à l’horizon, tous les roses de la brume marine. Chaque matin était un enchantement, surtout lorsque j’étais là-haut, sur la grande tour et que la brise à peine fraîche venait caresser mon visage. Chacun se disait : aujourd’hui, il va faire très chaud.
On allait appareiller, continuer la guerre avec les anglais, sans doute Hitler avait-il enfreint l’armistice. Hélas, nos amis les anglais pointaient leur artillerie sur l’escadre française, hélas, ils étaient chargés de la mission la plus ingrate qui soit : détruire notre flotte, si l’amiral Gensoul refusait les termes de l’ultimatum. Et pourtant, nous savons tous que les officiers et les marins anglais étaient nos camarades de guerre, nous savions tous qu’ils étaient contre cette intervention honteuse. Jusqu’à l’armistice, sur chaque bâtiment important, il y avait un officier de liaison anglais, et des liens très étroits s’étaient tissés entre eux et les nôtres. Mais voilà, chez eux, comme chez nous, la discipline est inflexible et la marine britannique est tenue d’obéir à son chef de gouvernement : Churchill ».
Pour mémoire, voici, à peu près résumés, les termes de l’ultimatum :
1 - Rejoignez-nous jusqu’à la victoire finale.
2 - Conduisez vos navires avec équipage réduit dans un port des Antilles
Ou aux Etats-Unis.
3 - Sabordez-vous sur place.
« Gensoul ne peut que répondre et répéter : « Jamais les allemands ne prendront nos bateaux, nous les saborderons avant ». Dialogue de sourds. Churchill et son état-major ont peur que notre flotte soit, d’une façon ou d’une autre, utilisée par Hitler. On saura plus tard que l’armistice prévoyait justement le retour du « Dunkerque » et du « Strasbourg » à Toulon où ils seraient désarmés (?). On saura aussi, toujours plus tard car on apprend beaucoup de détails mais plus tard, que l’amiral Gensoul n’arrivait pas à se mettre en rapport avec son chef naturel Darlan, ministre de la marine. Avouez que c’est un comble, dans des circonstances aussi dramatiques de ne pas avoir l’avis du grand patron.
Alors Gensoul n’avait qu’une idée, faire durer les pourparlers pour que l’escadre soit prête à appareiller et gagner du temps pour essayer d’avoir des ordres de son chef.
A quoi bon épiloguer. Les dés étaient jetés, pourtant, je vous répète que jusqu’au dernier moment les officiers ont cru qu’il s’agissait d’un moyen de pression mais que jamais, au grand jamais, les britanniques s’abaisseraient à ce forfait monstrueux.
On a vu arriver le destroyer « Foxhound » avec, à son bord, le commandant Holland chargé de parlementer avec l’amiral Gensoul. Il n’est pas huit heures. D’interminables pourparlers ont lieu mais l’amiral français reste ferme.
Moi, je suis là-haut avec le capitaine et les servants de télémétrie. Ne recevant toujours aucun ordre, on regarde et je vous assure que de notre perchoir on voit tout ce qui se passe. L’escadre britannique effectue des allers et retours, se protégeant parfois de notre vue, derrière le cap Kébir. Elle a l’air de nous narguer pendant que, rongés par l’attente interminable, nous faisons encore des suppositions, toutes plus folles les unes que les autres : et si on partait avec eux, et si on appareillait tout de suite, et si on descendait ces mouchards d’avions insolents qui renseignent le chef de l’escadre anglaise. Mais non, il ne fallait pas tirer ! On se croyait revenu aux temps héroïques de la bataille de Fontenoy où le maréchal de Saxe invitait les anglais à tirer les premiers.
Les minutes, les heures s’égrenèrent avec une lenteur désespérante et pleine d’interrogations alarmantes. On sentait une inquiétude sourde nous envahir, insidieusement, créant en nous comme un état second que nous ne contrôlions plus à cause de l’usure d nos nerfs. Maintenant, nous savions que l’amiral Gensoul, à contrecœur, était déterminé à répondre à la force par la force. Toutes les cheminées des navires laissaient échapper les panaches de fumée caractéristiques du proche appareillage.
A 17 heures 55, au moment où le soleil commençait à décliner, l’escadre anglaise lança sa première salve.
Là, sans rien dire, nous avons mesuré la terrible efficacité des obus de 380, plus grands qu’un homme et pesant près de 900 kg, et imaginé l’ampleur des dégâts qu’ils pourraient occasionner en faisant mouche. Pas le temps de respirer que déjà la deuxième salve s’écrasait sur la jetée, provoquant une déflagration énorme avec jets puissants de blocs de béton et d’une nuée de pierres qui tombent comme grêle sur les navires, blessant les marins occupés à larguer les amarres.
Le « Dunkerque » et le « Provence », malgré leur mauvaise position, entrent dans la danse. A partir de cet instant, ce fut l’apocalypse. Le vacarme devint terrifiant.
Tout le monde, la peur au ventre, attendait et espérait l’appareillage, car nous savions bien qu’ici, chaque seconde représentait beaucoup de vies humaines.
 |
| Photo prise du Dunkerque |
C’était titanesque, déchirant. Des témoins, sur le « Commandant Teste », voisin du « Bretagne », diront que, pendant que l’incendie et les explosions internes faisaient rage, des corps humains déchiquetés étaient projetés en l’air, avec des débris de toute sorte. Spectacle hallucinant. Le cuirassé prend de la gîte à tribord. Son salut, enfin le salut de ce qui en restait, aurait été qu’il s’échoue, mais il était encore en eau profonde et, comble de malheur, tandis qu’il coulait par l’arrière, deux obus, juste avant le « Cessez le feu », le frappaient en plein milieu. Une explosion d’une force inouïe, un nouveau jaillissement de flammes qui crevait le ciel, un bruit strident de vapeur libérée et le « Bretagne », vrai martyr, s’enfonça inexorablement, la gîte croissant en même temps. La chaleur était insupportable, vite à l’eau ! Hélas, la moitié, sinon plus, des marins ne savaient pas nager (quelle hérésie !) Et avec le mazout en plus, que de cris à vous glacer la moelle, que de noyés ! La gîte dépassant le point d’équilibre, l’énorme bâtiment, entraîné par le poids de ses superstructures, tourna sur lui-même et coula en quelques secondes, entraînant les derniers survivants dans un gigantesque remous et un bouillonnement de fin du monde. Du bon vieux cuirassé, seule la quille émergeait, oui la quille, rien que la quille, à pleurer toutes les larmes de son corps.
Au moment où j’écris ces lignes un sanglot, malgré moi me secoue, et je pleure tout seul. Rien ne peut effacer cette vision poignante, ni les jours, ni les mois, ni les années. Cela fait maintenant cinquante-trois ans. C’était hier, c’est toujours hier, et toute ma vie j’ai traîné cette image lugubre et bouleversante. Je ne le dis à personne et, rançon implacable d’un souvenir gravé dans ma chair, elle ne s’éteindra jamais. Alors oui, criez-le : « Quelle connerie la guerre ! ».
Moi qui, à dix-sept ans rêvait d’une mort propre, j’étais servi.
Songez que la canonnade n’a duré que dix minutes, même si nous avions eu l’impression de vivre un drame plus long que l’éternité, songez qu’au moins deux cents obus ont labouré la rade jusqu’à en faire une forêt de gerbes gigantesques, mêlée à des incendies coupés d’explosions meurtrières, songez qu’une dizaine seulement de coups au but ont suffi pour mettre hors de combat trois cuirassés et un contre-torpilleur qui avait comme nom « Mogador ». Seuls, le « Strasbourg », notre frère jumeau, et les lévriers de la mer ont réussi à quitter la rade et nous avons compris que les anglais n’avaient aucun intérêt à les affronter. Ces miraculés ont réussi à rejoindre Toulon, mais pour quel destin ?
Cependant, les secours s’organisaient, tandis que le mazout continuait à envahir une partie de la rade. Le silence, qui paraissait presque anormal après la canonnade, n’était plus troublé que par les gémissements des matelots et officiers qui essayaient de nager ou qui barbotaient désespérément dans la glu noire. Des dizaines d’embarcations, celles des pêcheurs du port de St André et celles du miraculé « Commandant Teste », récupéraient le maximum de ces gars tous noirs et tous gluants qui suffoquaient pour avoir avalé du mazout. Transportés dans les hôpitaux d’Oran, beaucoup mourront en cours de transport ou les jours suivants.
Le soir, jusqu’à huit heures où fut donné l’ordre d’évacuer le navire, je suis resté là, nous sommes restés là, prostrés, les yeux secs, les yeux chavirés au point que nous n’osions plus nous regarder. Avant de quitter le bord, j’ai vu pour la dernière fois la quille du « Bretagne » et j’ai pensé à la détresse, à la souffrance sans borne, du jeune de Mussidan qui, un jour, était venu à l’école avec sa mère me demander de lui donner des leçons pour lui permettre d’entrer à l’école des apprentis mécaniciens de la marine, à St Mandrier. Je l’avais fait avec joie ; c’était un enfant doux et attachant. Je ne savais pas alors que je serais marin, je ne savais pas que je serais le témoin impuissant de la fin de son propre navire et surtout de la sienne, puisqu’en tant que mécano, il était resté prisonnier de son cercueil de ferraille. Il n’avait pas dix-huit ans. Pauvre gosse, pauvre maman, pauvre de moi !
Rassemblés sur le quai, nous avons assisté à des scènes insolites, plutôt chargées d’émotion explosive. Quelques-uns, très choqués, le visage hagard, perdus dans leurs rêves fous, allaient et venaient comme bêtes en cage, muets, absents. D’autres retrouvaient leurs copains, moi c’était le grand Morvan, et c’étaient des gestes désordonnés, des embrassades sans nom, vous savez des embrassades d’après cataclysme, tellement violentes qu’elles se terminaient par des sanglots ou des crises de nerfs.
Manquait mon brave ami Herrebrecht, le petit horloger, qui avait sauté avec sa tourelle. Vous voyez bien que le monde était fou et cette odeur écœurante de mazout et de mort (il fait très chaud) qui ne vous lâchait pas. Pourquoi étions-nous vivants ? Grâce à Dieu disait les uns. Mais à la question : pourquoi tant de morts ? Il n’y avait plus de Dieu et c’était la faute à pas de chance.
Les officiers nous divisèrent en plusieurs groupes ; les plus nombreux furent parqués, comme du bétail, sur des paquebots dont le « Champollion ». J’ai su plus tard qu’ils s’étaient rebellés devant un tel état de fait et que certains, redoutant une nouvelle attaque, s’étaient réfugiés dans la montagne ou même chez l’habitant. Les derniers groupes furent dispersés dans différentes écoles de la ville.
 Moi, j’ai échoué à l’école Jules Ferry. Parfois, le hasard ou le destin est favorable. En effet, j’eus vite fait de connaître Madame Clément, originaire de l’Ariège, directrice, qui comme son nom l’indique, était une femme merveilleuse et des plus gentilles.
Moi, j’ai échoué à l’école Jules Ferry. Parfois, le hasard ou le destin est favorable. En effet, j’eus vite fait de connaître Madame Clément, originaire de l’Ariège, directrice, qui comme son nom l’indique, était une femme merveilleuse et des plus gentilles.
En même temps, je fis la connaissance de sa fille Lucette. Témoin attentif de mon désarroi et, comme une mère au grand cœur dont je serais devenu le grand fils, elle s’était mise à mon entière disposition et d’abord, le plus pressé et le plus important : prévenir mes parents qui devaient mourir d’angoisse. Toutes les deux, durant une douzaine de jours, ont essayé d’atténuer ma peine en m’entourant d’une véritable et merveilleuse sollicitude, faite de douceur et d’affection. Pour finir de nouer et de corser nos relations, et me trouvant dans un état de réceptivité presque maladif, il se trouva que Lucette était jolie et si tendre avec moi que je croulais sous une avalanche de sentiments réconfortants et troublants.
Cependant, le lendemain de notre évacuation, comme nous l’avions décidé la veille, Morvan vint me rejoindre et, tous les deux, nous nous rendîmes à l’hôpital d’Oran dont je ne me souviens plus du nom. D’autres marins, comme nous, effectuèrent le même et douloureux pèlerinage. Nous avons croisé dans les couloirs des êtres qui erraient comme des âmes arrachées à notre pauvre monde.
D’abord, nous avons retrouvé des copains presque méconnaissables, le visage tuméfié et sanguinolent ; ils gémissaient le plus doucement possible, interminablement, et nous deux, raides comme des cierges, incapables de prononcer un mot, nous cherchions leur main pendante pour la serrer, signe de sympathie impuissant et dérisoire. Vraiment cet hôpital résumait à lui seul toutes les souffrances de la guerre et tous les maux de la terre. En arrivant aux « mazoutés », nous avons failli craquer. C’était l’antichambre de la mort, avec ces visages révulsés qui révélaient l’énorme difficulté à respirer de ces pauvres créatures et ces efforts pour déglutir qui torturaient leur pauvre corps. Une mousse grise remontait sans cesse à leurs lèvres. Beaucoup étaient près de l’asphyxie. Tous ceux qui avaient ingurgité trop de mazout, et malgré tous les soins assidus du personnel hospitalier, mourront au cours de la nuit suivante.
Le cœur douloureux, très émus, nous avons terminé notre voyage aux enfers, par la visite des brûlés. Nous sommes entrés dans le domaine le plus inhumain, le plus horrible aussi. Après le spectacle de la veille qui nous avait déjà ébranlés, entendre à nouveau cette plainte multiple et déchirante qui montait de tous les lits - supplications désespérées, cris, hurlements bouleversants - était propre à vous rendre fou. Il y avait des brûlés à cent pour cent dont la peau se détachait par pans entiers et qui ne vivraient plus bien longtemps. Tous ces corps à vif ne supportaient aucun contact. Pour eux, à la nudité brûlante, pour eux dont les bras étaient attachés verticalement dans une attitude lamentable de prière, où était le bon Dieu ? Oh ! Ces visages horriblement dénaturés, ces regards d’épouvante qui vous glaçaient jusqu’aux os !
Morvan et moi, complètement démolis, n’avons su que pleurer à la sortie de l’hôpital ; nos yeux, nos pauvres yeux avaient vu tant d’horreur, nos cœurs avaient tant souffert, que tout notre être semblait détruit à jamais. Sous le soleil implacable d’Oranie, nous sommes rentrés chacun dans notre école. Sur le moment, j’ai été incapable de donner des nouvelles de nos pauvres blessés à madame Clément et à Lucette. Elles ont respecté mon émoi. « Vous savez, Maurice, car elle m’appelait Maurice, à l’heure qu’il est, votre famille doit savoir que vous êtes sain et sauf ». Chère femme, elle savait bien que mon amour pour mes parents était encore le meilleur réconfort, la chose à laquelle on s’accroche toujours en dernier ressort. Et nous avons causé un long moment, moi de ma famille, elles de monsieur Clément, officier dans la coloniale. Nous avons bu l’apéritif. Lucette m’a raccompagné. Nous descendions le grand escalier, côte à côte, nos mains se sont frôlées puis, allez savoir pourquoi et comment, elles se sont données l’une à l’autre puis se sont nouées. A l’avant dernière marche, nous nous sommes arrêtés et c’est là, précisément, que son regard, à la fois naïf et pénétrant, m’a enveloppé d’une grande tendresse et, le croiriez-vous, nos lèvres se sont jointes dans un fervent baiser. Lorsqu’on s’est quittés, elle était pâle et avait l’air « toute chose », comme si son innocente candeur s’étonnait brusquement de notre hardiesse à tous les deux. Ainsi, elle était ravissante. Très émue et un peu perdue, elle remonta l’escalier précipitamment, comme si son nouveau secret lui brûlait le cœur.
Ce soir-là, le souvenir des morts, le regard terrifiant des brûlés et leurs cris, mes parents rassurés et, pour finir, Lucette et ce baiser imprévu, cela faisait tellement de choses, tellement d’émotions à la fois, que ma pauvre tête et mon pauvre cœur n’en pouvaient plus. Je ne savais plus ce qui m’arrivait. Je n’avais qu’une certitude : j’étais vivant, mais j’étais fatigué, fatigué. Cet état de délabrement, surtout mental, dura plus d’une semaine. De voir que les camarades étaient dans la même situation de fragilité que moi ne m’apportait aucun réconfort. Pourtant, j’avais été heureux dans la marine, c’était mon souhait. Je me suis aperçu que c’était pire qu’ailleurs. Quand je pense au gars du « Bretagne » et du « Dunkerque » qui sont morts murés vivants, je me dis : à terre, ils auraient pu se déplacer et respirer, respirer. Moi, là-haut, je respirais mais, même inutile chacun devait rester à son poste et attendre le pruneau qui le faucherait. Discipline oblige. Quand enfin, est venu le moment de réfléchir, j’ai pensé et j’ai dit : « J’essaie de comprendre Churchill, mais jamais je ne pardonnerai ce massacre ».
Ce qui est vraiment lamentable dans cette histoire, c’est que la plus grosse partie de notre belle flotte, au lieu de servir l’honneur du pays, rejoindra Toulon - les anglais avaient vu juste - où elle se sabordera. Flotte inutile !
Il faut quand même parler du bilan de ce tragique épisode de guerre. Si plus de deux cents obus ont été tirés, seuls dix d’entre eux ont touché leurs cibles, coulant le « Bretagne » et mettant hors de combat le « Dunkerque », le « Provence » et le contre-torpilleur « Mogador ».
Les conséquences politiques de ce drame furent d’une grande importance. Mers El Kébir et son deuil ne profitèrent qu’aux ennemis de la République et au tandem Laval-Pétain, en premier lieu. Celui-ci eut beau jeu de fulminer contre les anglais et leur lâcheté. La propagande et la radio matraquaient les français avec des slogans qui faisaient apparaître la Grande Bretagne comme notre pire ennemie. Cet événement a fait basculer les indécis et les déçus dans le camp de Vichy. Même Darlan, qui n’était pas anti-anglais au départ, na pardonnera jamais ce crime et se rangera aux côtés des collaborateurs. En somme, les allemands en ont tiré profit ».
L’après Mers El Kébir
« Pendant treize jours exactement, j’ai eu le privilège de vivre avec mes deux amies, la mère et la fille, des moments inoubliables de compréhension et de réconfort. Chaque matin et chaque après-midi, j’étais enveloppé d’une atmosphère vraiment familiale. Je ne sais plus comment était née cette sympathie instinctive qui, dès le premier moment, dès le premier regard, avait créé des liens profonds et d’une rare qualité. Dois-je dire que Lucette avait pour moi les yeux de Chimène et que nos regards exprimaient sans doute plus qu’une grande amitié. Je crois bien qu’elle m’aimait. Moi, si près de la quitter, j’étais tiraillé entre notre idylle naissante et l’émotion que me promettait ma libération prochaine.
Le seize Juillet en effet, je reçus la plus précieuse des feuilles de déplacement qui avait valeur d’ordre de démobilisation. Elle portait la date d’Oran et ce mot : « Embarque à bord du paquebot « Sidi-Bel-Abbès » à destination de Marseille. Se rend à St-Astier, rue Clemenceau. Voyage gratuitement. Ne rallie pas ».
La séparation et les adieux, malgré la promesse de se revoir en France, furent des plus attendrissants et je vis bien que Lucette, après un baiser amical, baissait les yeux pour cacher une larme. Elle sentait que mon émotion, bien que sincère, en appelait une autre peut-être plus grande encore et qui, après les dernières épreuves, me poussait irrésistiblement vers d’autres regards, vers d’autres étreintes : là-bas, il y avait l’appel lancinant des miens.
Et le « Sidi-Bel-Abbès » nous a pris, passagers et marins, dans le soir serein qui glissait sur la mer si douce, si bleue. Nous étions pourtant heureux de partir, mais quand la côte africaine s’est évanouie dans la brume, comme dans un songe, une grande tristesse a voilé nos regards. Nous savions bien qu’au pied du Djebel, nos frères d’armes, nos amis reposaient dans le cimetière de Mers El Kébir, je savais bien que le « Bretagne » dormait avec ses marins engloutis, et puis il y avait ces deux femmes au cœur d’or qui m’avaient accueilli sans arrière-pensée.
Vers onze heures, une descente à la salle à manger où le couvert était déjà mis, me révéla qu’une grande partie des voyageurs était prise de malaise. Le mal de mer faisait des ravages et je vis des femmes et leurs enfants cramponnés aux lavabos, essayant de se soulager, parfois en vain. Le repas n’en fut pas moins servi à l’heure dite et la moitié des tables restèrent désespérément vides, ce qui permit aux marins de s’approprier des rations supplémentaires de « pinard » qui s’évacuèrent progressivement en chansons et en plaisanteries. Plaisirs dérisoires, sans doute, mais qui montraient la fragilité de tous ces êtres à la recherche de leur sérénité. Je ne les juge pas, j’étais avec eux.
Les heures se mariaient aux heures et, pour moi, s’écoulaient dans une somnolence à éclipses. A mesure que le soir poussait le soleil vers le couchant, mon énergie refaisait surface et déjà les noms familiers, liés à des paysages bien connus, éclataient à mes oreilles et à mes yeux redevenus attentifs : Montpon, Mussidan, Neuvic et puis, brusquement, Saint-Astier.
J’étais crevé et comblé. Des instants comme ceux-là et vous vous dites que la vie, malgré tout, vaut la peine d’être vécue. Nous avons parlé, parlé, moi toujours nerveusement. Marcel, qui était dans les groupes de reconnaissance, avait hérité de la croix de guerre, moi aussi d’ailleurs, avec médaille de bronze s’il vous plaît et avec une citation élogieuse à l’ordre de la Marine nationale et de la nation. Je ne m’en suis jamais vanté. La porter ou s’en glorifier me paraissait d’un goût fort douteux ; je pensais même que cela aurait été déplacé. Tout de même, ces anglais abhorrés de tous, étaient les seuls à combattre encore et à s’opposer au déferlement des hordes nazies. Pour tout dire, je n’étais pas fier de ma décoration, sans doute par simple honnêteté et parce qu’au fond de moi-même, je jugeais qu’elle avait été acquise sans mérite particulier. Curieusement, notre « ennemi », lui, se battait héroïquement pour sa liberté… Et pour la nôtre.
Quand les draps reçurent enfin mon corps éprouvé par tant de veilles, leur fraîcheur douce et propre m’enveloppa d’un bien-être sans pareil, vous savez ce bien-être divin qu’on n’éprouve qu’une ou deux fois dans toute une vie, surtout lorsque le baiser tremblant d’une maman le précède, invite maternelle à la paix et au repos bienfaisant. Dans ma tête, un instant, se bousculèrent des souvenirs et des pensées contradictoires, mais le sommeil tant désiré finit quand même par s’imposer.
Le calme de la maison et celui de ma campagne, mes visites chez Jean et Louise, les promenades à pied ou à vélo dans mes bois retrouvés, les soirées près des miens, constituèrent la meilleure des médecines pour remonter la pente dépressive où les évènements m’avaient conduit. Il paraît que je suis resté quelques mois à utiliser un langage un peu trop « fleuri », réminiscence de la vie de marin sans doute ».
Développement des évènements par l’image
12 juin 1940
La bataille de France vire au désastre. Paul Reynaud demande à Weygand de capituler. Refus de ce dernier qui ne veut pas être tenu comme le seul responsable de la défaite et propose d’envisager l’armistice : convention qui est une négociation politique, ratifiée entre les états concernés mettant fin aux hostilités.
La capitulation est un acte militaire de reddition imputable au chef militaire Le territoire est alors livré au contrôle intégral de l’ennemi ce qui signifie saisie de toutes les armes y compris de la Flotte. Il est surprenant de constater que hier comme aujourd’hui, des historiens, les médias, de Gaulle lui-même n’ont cessé de parler de capitulation et non d’armistice.
Pourquoi ? 15 juin Départ vers Bordeaux L’obsession de Darlan est alors de sauver la flotte. Il fait accélérer les préparatifs d’appareillage.
16 juin 1940
Darlan devient ministre de la Marine. En siégeant au conseil des ministres, il ne veut laisser à personne le soin de discuter des problèmes maritimes dans le cadre d’une future convention.
Lors du Conseil des ministres, le 16 juin 1940. De gauche à droite, Maxime Weygand, Paul Baudouin, Paul Reynaud et le maréchal Pétain. Photo Keystone France
22 juin 1940
3 juillet 1940
17 h 25 - Le Captain Holland est reconduit à la coupée. Livide, il quitte définitivement le Dunkerque profondément ému par l’échec des négociations. Holland et Davies remontent dans leur vedette. En passant devant l’étrave du Bretagne, ils aperçoivent l’officier de quart qui leur rend les honneurs réglementaires et des matelots qui leur font des signes d’amitié. Ces marins ignorent que, dans une demi-heure à peine, ils vont mourir. En montant sur sa passerelle, Gensoul : « J’ai fait tout ce que j’ai pu. C’est fini. Je ne peux rien faire d’autre ». Le drame est proche.
17 h 59 - La troisième salve britannique est tirée. La situation de l’escadre de Gensoul est dramatique : bâtiments immobiles, entassés, incapables de rendre leur artillerie battante, passe bloquée par le mouillage des mines. La Force H anglaise est libre de sa manœuvre, elle dispose en outre des avions de surveillance et de conduite de tir de l’Ark Royal. La force de Raid était une cible idéale, écrira Ted Briggs, timonier du Hood « Shooting a fish in à barrel (Tirer sur du poisson dans un tonneau) » C’est le début d’un véritable carnage. Le cuirassé Bretagne est touché une première fois à la hauteur des tourelles arrière.
Le Mogador, au moment de franchir la passe, est frappé par un obus de 380 mm qui lui déchiquette complètement l’arrière et fait exploser ses grenades sous-marines. Il flotte cependant et reste mouillé avec sa poupe arrachée qui brûle, devant la jetée.
Le Volta l’évite de justesse en abattant rapidement. Il fonce vers la sortie, à la tête de la ligne des contre-torpilleurs, malgré les obus qui pleuvent.
18 h 03 - Le sort le plus cruel est réservé au Bretagne. Une nouvelle salve frappe le navire. Une immense gerbe de flammes ravage tout le bâtiment, de l’avant au mât arrière. L’évacuation est ordonnée.
18 h 13 - Le Dunkerque, endommagé, mouille dans la rade, par 15m de fond, à l’abri de la colline de Santon devant le village de St André.
18 h 30 - Un Swordfish confirme que c’est le Strasbourg qui double la pointe de l’Aiguille suivis du Tigre, du Lynx et du Volta.
18 h 40 - Le Hood se lance à la poursuite du Strasbourg avec les croiseurs Arethusa et Enterprise et plusieurs destroyers. Les appareils de l’Ark Royal interviennent à leur tour.
19 h 05 - Le Strasbourg subit pendant 2 heures, les attaques aériennes britanniques. En vain, grâce à des manœuvres ou abattées brutales, le cuirassé évite bombes et torpilles.
2ème extrait des conférences présentées par Martial Lehir entre 2019 et 2020
Conclusion
Une vérité paradoxale
Lorsqu’au matin du 3 juillet 1940 à Mers-el-Kébir, mais aussi en Grande-Bretagne, des milliers de marins français furent confrontés au drame, on peut imaginer quelle fut leur stupéfaction en constatant soudain que leurs frères d’armes de la veille s’étaient transformés en ennemis. Comment alors assumer cette contradiction et quelle explication rationnelle peut-on donner à une situation aussi improbable ?
Pour répondre à cette question dérangeante, il faut tout d’abord constater que dans une guerre, la première victime est la vérité. Car à l’occasion des conflits modernes, la propagande constitue une arme redoutable, mais, contrairement aux autres, les idées semées par elle, du moins celles des vainqueurs, se maintiennent après les hostilités.
L’interprétation du drame de Mers-el-Kébir s’inscrit dans ce processus implacable entretenu par un débat franco-français le plus souvent stérile et partisan, qui n’a jamais permis de laisser la place à la sérénité nécessaire pour qu’un réel travail historique puisse être entrepris sur un sujet aussi atypique.
Il n’est pas moins paradoxal de constater que bien souvent, la mise en perspective de cette tragédie maritime est beaucoup mieux comprise dans le monde anglo-saxon en général, si l’on veut bien se donner la peine de consulter les ouvrages consacrés à cet événement, même si l’on peut regretter que peu d’entre eux aient été jugés dignes d’être traduits en français. Mais est-ce un hasard ?
Pourquoi la Marine de juin 1940, devrait-elle être chargée des crimes qu’on a commis contre elle ?
L’Histoire appartient aux historiens, mais ces investigateurs du passé ne sont ni des juges ni des thérapeutes. Laissons-les travailler dans le calme. Qu’ils aient la volonté d’apporter la lumière sur ces évènements passés, même si l’Histoire officielle doit en souffrir.
Depuis 1990, grâce à de nouvelles investigations, des historiens anglo-saxons et français apportent un éclairage nouveau sur les actions controversées ou sur les rôles déterminants de Churchill, de Gaulle ou Darlan en juin et juillet 1940.
On ne peut se contenter des Mémoires des protagonistes. Il est aisé de gommer les zones d’ombre et de réécrire l’Histoire après un travail de recomposition. Churchill dans ses Mémoires, écrit « Donnez-moi les faits, je les tordrai pour qu’ils conviennent à mes arguments ».
Ainsi, il fut demandé au Commander Stitt, historien naval distingué, de rédiger un chapitre sur Mers el Kébir pour figurer dans l’historique officiel de la guerre en Méditerranée. Churchill jugea ce rapport trop favorable aux Français. Le document fut classé aux oubliettes et remplacé par un texte plus conventionnel rédigé par le Major General Playfair.
On ne peut s’empêcher de penser, 80 ans après le drame, à la perversité du silence imposé qui vise à effacer les déchirures, les choix, et la crise morale engendrée au sein de la Marine : n’y-a-t-il pas nécessité au contraire de regarder le passé en face pour effacer toute incompréhension afin d’apaiser l’amertume des uns ou la rancœur des autres ?
La Marine Française aujourd’hui, a commencé à y contribuer à l’image de la Royal Navy.
Cette conférence n’est qu’un modeste jalon de la relation de cette période si complexe de notre histoire. L’accélération des événements exige qu’ils soient appréhendés et scrutés au jour le jour, voire même d’heure en heure, sans que l’on puisse être certain de bien saisir qui a fait ou décidé quoi, qui a dit la vérité ou l’a « arrangée » à son avantage.
La réalité des faits peut apparaître contradictoire et difficilement compatible avec la vision de cette période qu’affectionnent souvent les médias, c’est-à-dire une version édulcorée, lissée, perçue comme « officielle » donc moins dérangeante.
Le temps d’une vision apaisée de cet événement adviendra sans doute un jour. Puisse cette conférence y contribuer en montrant que nos marins, emportés dans l’une des plus grandes tempêtes de l’histoire, n’ont pas démérité. L’exemple de leur souvenir aujourd’hui fondé sur la mémoire et le pardon, doit aussi être perçu comme un appel à préserver la Paix.
Puisse cette conférence leur rendre leur honneur et leur dignité afin de les sortir de la poussière de l’oubli où l’Histoire, trop souvent ingrate à leur égard, veut les confiner à jamais.
En juillet 1940, l’Allemagne n’avait préparé aucune stratégie vis-à-vis de la Flotte. Elle fut élaborée en décembre et définie dans le plan Attila. Cette opération sera rebaptisée Anton, le 11 novembre 1942 et déclenchée le 26 sous le nom de Lila L’objectif était de s’emparer de l’escadre de Toulon ce qui conduisit à son sabordage, le 27 novembre.
ANNEXES
Métier : second-maître canonnier à bord du Dunkerque
1939 - « Il était surtout question de guerre et tout le monde la disait inéluctable et même imminente. Mes quinze jours furent vite usés et cette fois, quand je quittai St Astier, maman pleura en me berçant un peu contre elle. Papa et moi étions très émus. Robert repris le chemin de La Rochelle où il servait dans les batteries de côte. Quant à moi, je rejoignis mon palace de bateau.
Un mot sur mes fonctions à bord du Dunkerque : d'abord, poste de veille au Poste Central de conduite de tir, au cœur du navire, où il faisait très chaud. Placé devant un grand tableau qui portait des voyants lumineux et beaucoup de maquettes mobiles, je devais, d'après les renseignements fournis par le Télépointeur, les orienter en gisement, en direction, tout en notant la distance, la vitesse probable du but, etc.…, ceci durant quatre heures avec les écouteurs sur les oreilles.
Si, par malchance, le branle-bas de combat intervenait, je devais quitter ce poste en vitesse pour rejoindre le télépointeur 2, en haut de la grande tour, où j'avais mon poste de combat comme servant d'ordre de feu. Mon rôle, sur instruction du chef télépointeur, consistait à donner l'ordre de tir aux pièces de tir contre avions. L'hiver, c'était un sport et une épreuve terrible pour mon corps qui, du poste de veille où il faisait 25 degrés, passait au zéro en haut de la tour où le vent me saisissait, me glaçant jusqu'aux os. Monter les échelons qui me conduisaient à presque quarante mètres ne suffisait pas à me réchauffer ». Maurice Neycensas
Le Dunkerque et son sister-ship le Strasbourg furent les premiers navires français à disposer d'une direction du contrôle de tir centralisée pour l'artillerie principale et l'artillerie secondaire.
La conduite de tir de l'artillerie principale était assurée par un télémètre optique de 12 mètres qui fût remplacé en 1940 par un modèle de 14 mètres, un autre de 8 mètres en secours tandis que chaque tourelle pouvait se diriger elle-même puisqu'elles disposaient chacune d’un télémètre de 12 mètres.
Pour ce qui est de l'artillerie secondaire, la conduite de tir était assurée par un télémètre de 6 mètres et un autre de 5 mètres installés sur la tour avant, un autre télémètre de 6m sur la tour arrière tandis que chacune des tourelles de 130mm quadruple disposait de son télémètre de 6 mètres, la rendant de fait autonome.
Les télémètres relevaient la distance et la direction de la cible qui étaient transmises à des calculateurs puis transmises aux postes de tir de chaque tourelle. Les tourelles de 330 et de 130 mm étaient équipées d'un début d'automatisation qui permettait en théorie à la tourelle d'être manœuvrée via les données des postes de tir sans intervention humaine directe. Cependant, ce système n'était guère au point et bien souvent une intervention humaine était nécessaire.
En l'absence de radar, le tir de nuit s'effectuait à l'aide de sept projecteurs de 120 cm, trois installés sur la tour de commandement et les quatre derniers sur la cheminée, pouvant être contrôlés soit depuis un local dédié ou depuis les tourelles.
Extrait - Forum-marine - 2010
En marge des événements
Drôle d’escapade
Par Maurice Neycensas
« La même année je me rendis à Hyères pour un stage d’éducation physique de trois semaines, ce qui me permit de jouir d’un climat plus agréable, mais surtout d’être près de Toulon où Laurent déjà prévenu, attendait ma visite. Je garde peu de souvenirs du stage, sinon qu’avec les restrictions alimentaires, nous mangions souvent des cœurs de fenouil, que je n’appréciais pas vraiment. Par contre, est restée vivante dans ma mémoire, une sorte d‘expédition que je qualifierai d’exceptionnelle. Figurez-vous que, le stage terminé et sur invitation de Laurent, je passai mon dernier dimanche à Toulon. Mon presque frère m’attendait à la gare. Nous prîmes le tram pour nous rendre à sa chambre, au Mourillon, dans la plus jolie banlieue de la ville. C’est là qu’il me fit part de son plan, que je trouvai des plus osés mais dont le caractère casse-cou me séduisit et m’amusa jusqu’à en rire aux éclats.
Les gestes suivent aussitôt la parole. Je change de peau et, en moins une, devant la glace, je souris au marin Neycensas. Je mets la casquette, au poil ! et je salue mon complice, car il faut tout prévoir, même la rencontre probable de quelques supérieurs. Nous voilà dans le tram ; malgré notre joie de lurons en vadrouille, je sentais en moi une légère inquiétude. Il allait falloir affronter le contrôle d’identité à l’entrée de l’arsenal et tout le monde sait qu’en période d’hostilités, le port illicite de l’uniforme militaire est passible du conseil de guerre. Excusez du peu ! Vous voyez bien que la jeunesse a toujours son petit grain de folie mais, l’opération étant engagée, il n’était pas question de faire machine arrière.
Peu avant l’arsenal, une surprise (pas pour eux) : Catherine nous attendait, hilare. Et me voilà, second maître Neycensas, encadré de mes deux joyeux drilles, passant devant le garde qui, devant ma tenue impeccable et plus vraie que nature, fut à mille lieux de se douter de la supercherie. La porte franchie, bras dessus, bras dessous, nous éclatâmes de rire en chantant comme autrefois : « Avoir un bon copain, c’est plus fidèle qu’une blon-onde ! ». J’en souris encore et, en pensant à nous trois, fidèles parmi les fidèles, j’oublie mes quatre-vingts berges et c’est comme si une eau de Jouvence coulait en moi, me ragaillardissant le temps d’un rêve, le temps d’un radieux retour en arrière.
Sur le « Commandant Teste », la table était mise. Ce fut comme une réception de l’amitié en mon honneur. Ils avaient bien fait les choses les coquins, et je me retrouvai, éberlué et ravi, au milieu d’anciens « seconds » du « Dunkerque », du « Strasbourg » ou d’autres bâtiments, vieilles connaissances.
Avec tous ces braves gars, jeunes et moins jeunes, debout, nous avons levé nos verres à l’amitié et à l’espoir. Le repas, succulent, d’abord empreint de cette sorte de ferveur qui accompagne les grandes retrouvailles, s’anima progressivement et ce fut une vraie fête. Des adieux chaleureux, ô combien, des accolades à n’en plus finir, des mains qui se serrent et se lâchent à regret, moments émouvants et forts.
Sortir de l’arsenal n’était qu’une formalité. Laurent, Catherine et moi-même, comblés et heureux, délicieusement excités par les vapeurs euphoriques d’après repas, nous prîmes instinctivement, la direction du quai Cronstadt. Comme autrefois, nous l’avons arpenté sur toute sa longueur. Un peu de nostalgie flottait tout au fond de mon cœur.
La voix de Rina Ketty s’était tue et même si, de-ci de-là, on entendait encore les trémolos de Tino, un autre phénomène éclatait qui semblait réveiller les ardeurs assoupies : Trenet et ses rythmes syncopés entretenaient un peu de joie dans la morosité générale. Tard dans la soirée, je suis redevenu un civil authentique et, c’est drôle, à mesure que je me débarrassais de la tenue militaire, je sentais mon corps et tout mon être se libérer de toute contrainte, je me sentais plus léger. Vraiment je n’étais pas fait pour l’armée.
Extrait du journal personnel de Maurice Neycensas
Quelques jours avant l’attaque Anglaise …….
16 au 23 avril 1940
Séjour à Brest sans histoire, mais j’ai vu des départs qui ne sont pas sans grandeur tragique, départs de paquebots chargés de « sang Français ».
Depuis le retour d’Oran qui marquait l’envahissement de la Norvège, je pense que 15 à 20 paquebots soit 50 à 60 000 mille soldats sont déjà partis vers leurs tragiques Destin. Si d’autres départs ont eu lieu dans d’autres ports, la contribution française est d’importance. Les Anglo-Canadiens font de même et les engagements alliés ont déjà lieu.
23 avril 1940
Reçu lettre de Robert et Suzanne, deux voix très chères et vibrantes.
24 avril 1940
Après avoir fait la garde nous avons appareillé, route au Sud.
25 avril 1940
Route sur Mers El Kébir, tournée de prestige ? ou Italie ? Escadre Anglaise pas loin ???
27 avril 1940
29 avril 1940
Reçu lettre émouvante de papa et maman plus muguet, larmes irrésistibles. Quelques sorties à Oran, espoir d’aller à Alger et lettre à Gisèle.
5 mai 1940
Sortie radieuse à Ain El Turc, plage, soleil avec Marrassé, Herrebrecht, Morvan, photos, tournée en ville !!!
9 mai 1940
Appareillage, tirs d’exercices, pourquoi Gamelin n’a-t-il pas attaqué pendant que les Allemands étaient en Norvège ? La Hollande, la Belgique, le Luxembourg sont envahis, la guerre commence, ruée Allemande. Les villes du Nord de la France sont bombardées, Lille, Pontoise plus Lyon.
12 mai 1940
Tanks, avions Germaniques, 400 avions descendus en 4 jours, Vicky je lui écris ???, inquiétude pour Marcel.
15 mai 1940
La Hollande capitule, sauf la flotte qui part vers l’Angleterre.
16 mai 1940
La bataille de la Meuse fait rage, Sedan choc trop dur, Liège seule a tenu, les Allemands sont à Namur, choc du Luxembourg puis Longwy.
20 mai 1940
Révolution intérieure pour parer aux erreurs d’où discipline avec Reynaud, grand chef, Weygand remplace Gamelin, Pétain vice-président, Mandel à l’Intérieur, révocations de préfets et maires.
22 mai 1940
Mers El Kébir - Discours de Paul Reynaud « La Patrie est en danger ». Surprise angoissante démesurément. Discours au Sénat au moment où les Allemands atteignent, après 9 jours d’avance irrésistible, Amiens et Arras. Des fautes des erreurs, des trahisons sont dévoilées …… mais des milliers de frères sont morts de ces négligences monumentales et notre Foi un instant ébranlée renaîtra s’élèvera sur l’élan héroïque des instants graves.
24 mai 1940
Bilan, accident, Pluton contre Railleuse, Doris et Centaure coulés, Chacal coulé.
28 mai 1940
Boulogne, Calais sont atteint par les Allemands, Léopold III de Belgique dépose les armes et c’est un coup terrible dans notre organisation.
Retraite grandiose, héroïque de Blanchard et Prioux.
3 juin 1940
Mers El Kébir, pour nous attente angoissée de l’attitude Italienne, attente et doute qui se précisent et deviennent certitude car malgré les avertissements de Roosevelt, Mussolini a dit qu’il tiendrait ses engagements envers Hitler. L’intervention Italienne apparaît comme fatale et ce sera l’embrasement colossal, le choc titanique le plus terrible de l’histoire. Et dans le Nord « Dunkerque » continue son martyre et Prioux et Blanchard qui reculent vers le camp retranché essaient de sauver leurs hommes au prix de manœuvres et de l’héroïsme les plus sublimes. Pertes Allemandes immenses.
Embarquement de troupes pour l’Angleterre bombardée par l’artillerie et aviation Allemande.
Cent bateaux de guerre - Abrial et 200 bateaux de commerce - avions.
Enfer, déluge terrible, Marseille Toulon bombardés….
10 juin 1940
Veillée d’armes,
« Mes tous chéris,
Je ne sais quel sort sera fait à ce petit mot ni quand il vous parviendra mais je veux quand même lui confier toute mon âme, tout mon amour, tout ce que j’ai nourri pour vous de fervente tendresse et de secrète reconnaissance.
Je donne un suprême baiser à ce léger feuillet, un baiser amer mais ferme, sans pleurs. Nous sommes tous décidés dans cette première veillée d’armes, tous unanimes dans notre résolution de nous donner corps et âme pour vaincre, pour châtier…ou pour fermer les yeux en enfants sages qui aimaient leur France et leur douce famille chérie par-dessus tout.
A bientôt petite maman et courage…. Courage comme ton petit Maurice qui te porte dans son cœur et de dis d’espérer. Mille baisers à tous ».
12 juin 1940
France Allemagne, nous sommes débordés en nombre et matériel, deux millions d’Allemands avec engins motorisés perfectionnés. Le front n’est pas percé mais nous reculons en infligeant le maximum de pertes.
Rouen, Soissons, Senlis, Marne, jamais la France n’avait subi pareille souillure. Donc la situation se présente sous un aspect angoissant. Paris ???
Raison d’espérer, le front se stabilise, les Allemands envoient des tanks, la ruée atteint son maximum, pertes effroyables, les Usa envoient du matériel.
Les faits : Après ces deux jours d’hostilité le peu d’enthousiasme des Italiens se révèle et l’hésitation parait subsister. Sur le front pas encore d’attaque.
Survol : Malte, bombardement, survol Alger, bombardement, Bizerte, représailles, Bombardement dans le Nord de l’Italie, Lybie bombardée, marine, 27 bateaux de commerce sont séquestrés. Engagements Ethiopiens et armées alliées, les Italiens de Marseille s’engagent également.
Raisons d’espérer : nous sommes forts, nous gagnerons s’ils envoient 70 destroyers et matériel.
Mers El Kébir, aujourd’hui 13 mai 1940 à 7 heures du soir.
Je viens de lire le journal, et après notre randonnée au poste d’alerte, j’ai senti en regardant la carte, toute l’ampleur de notre malheur, toute l’immensité du courage surhumain de nos soldats. J’attends l’angoisse au cœur ces mesures dont Weygand parlait il y a un mois !!! ???
Le quart d’heure final quand ? où ? Paris presque investit (30 km) et l’Italie qui nous tombe dessus.
Appareillés hier soir à 11h00. DK-SB-P.B. et 3 C + 8 Dct + 3 T
14 juin 1940 - Mers El Kébir
Le journal de ce matin est là sans commentaire. Paris est prise, notre situation est presque désespérée, appel de Reynaud révèle la grandeur du péril dans toute son ampleur.
Faut-il douter ? un instant, mais le cœur de la France bat dans le nôtre propre, et nous sentons que l’opprobre est plus grand, plus insupportable que le grand, le total sacrifice. Oui ce matin, les visages sont tendus mais il ne faut pas abandonner. L’Angleterre donne tout, on va tenir peut-être en attendant les Etats-Unis.
Trois alertes ce jour et 1’alerte de nuit hier soir.
18 juin 1940
La France est perdue. Les négociations de paix sont en cours mais la bataille continue, continue, semble-t-il jusqu’à l’effondrement, celui qui nous obligera à accepter tout : la paix allemande.
Oh ! ces jours 15, 16, 17, 18 juin, où nous avons vécu l’attente suprême et sans doute fatale, où nos cœurs ont enduré et présenté les conjectures les plus folles, les plus douloureuses, toutes aboutissants à l’Impasse tragique au dilemme angoissant : on ne peut continuer la guerre, on ne peut accepter la paix.
Les Anglais ont quitté la France, les troupes métropolitaines sont scindées en quatre. Toute résistance est presque vaine si la France est seule. Quelques espoirs côté Russie !!!
22 juin 1940
L’Armistice est près d’être signée et le ton général de la presse, je crois, tend à préparer l’opinion à l’acceptation de la Paix, car la France est meurtrie, elle est si lasse, elle a sacrifié tant de Jeunesse et usé tant de sa magnifique volonté. Il faut cesser le feu, vite car ses vies s’éteignent encore. Bordeaux, Marseille, Toulon continuent à être bombardées. Notre « carré » sublime des Vosges subit le feu meurtrier de l’ennemi. Clermont-Ferrand est atteint.
Hitler a fait traîner les pourparlers et lorsque la signature surviendra, il aura tellement avancé, tant de notre pays sera envahi qu’il pourra, le couteau sous la gorge, nous extirper la paix la plus cruelle.
Ne vivra-t-on jamais heures plus déchirantes. La France exténuée ne peut plus continuer. Mais l’Empire tremble pour lui et l’Afrique du Nord et l’Algérie surtout voudraient continuer à combattre pour conjurer le spectre monstrueux de la domination allemande.
Notre marine trop belle désormais voudrait se battre avec ces Français d’outre-mer… mais le drame se joue là dans toute sa tragique étendue…. Continuer ! mais alors la misère de la France n’aura plus de Bornes, tout sera rasé.
Nous ne pouvons pas l’accepter.
A moins que les exigences de Hitler soient trop grandes.
Familles essaimées par la France, familles errantes et mutilées qui menacent encore le feu et déjà la famine.
Et toi cher Marcel qu’est tu devenu ? Il faudrait pourtant que tu vives pour Lulu.
Maxime, Valentin ? Vous tous, chers amis qui avez vu la Mort mille fois errer sur vos têtes autour de vous, votre odyssée pathétique a-t-elle une heureuse fin ?
Même jour, le soir : Saint-Malo, sud d’Angers, Clermont, Gannat, Lyon, Tarare, Valence, Nantes, Brest et Lorient, bombardées.
Je n’avais jamais senti si intimement jusqu’à quel point peut aller l’identification de nos sentiments familiaux et patriotiques. Je l’avoue, jusqu’à aujourd’hui ma ferveur patriotique a été constante et très haute. Venger mes frères, réparer la souillure de l’envahissement continuer la guerre coûte que coûte, vaincre enfin malgré les hécatombes effrayantes….
Mais maman, mais Marcel, mais Lulu et Robert et tous mes « amours » parlent plus fort maintenant.
Je sens ma détresse croître et je redeviens ce Maurice aimant de toujours qui veut vivre pour sa famille, qui veut que sa famille vive…. Et la détresse de la France parle plus fort aussi…. Oh ! cette voix déchirante du malheur, cette supplication de milliers de femmes qui s’élève, immense de tout un Pays meurtri et vaincu, tous ces sanglots qui demandent grâce enfin dans la lassitude extrême dans le désespoir qu’ils expriment, dans l’impuissance tragique des grandes fins.
Ils dépassent en tristesse poignante et en réalité plus humaine plus inéluctable la volonté dernière qui appelle vengeance et gloire… mais sans être soutenue par l’Espoir.
Il faut arrêter pour panser la plus béante et la plus saignante qu’une Patrie, qu’un peuple n’ait jamais enduré.
J’ai toujours été un élément de grand et haut Moral à tout et j’ai relevé beaucoup de volontés chancelantes en expliquant la possibilité des derniers espoirs et le devoir à être dignes et égaux aux frères martyrs.
23 juin 1940
Ce soir : pris connaissance que l’Armistice était signé avec l’Allemagne, hier à 22 heures mais n’entrera en vigueur que 6 heures après la signature avec l’Italie.
Les Italiens attaquent du Mont-Blanc à la Mer, le dernier coup porté avant la signature.
3 juillet 1940 à 5 h 45 du soir
Concerne l’assassinat de Mers-El-Kébir. J’ai vu tout le combat du haut de ma tour, les premières gerbes autour de la digue, le phare, la tourelle 2 percée, la 3ème crevée et la machinerie perdue…
Bruit d’enfer, vision tragique, oreilles bouchées, j’assiste à la mort horrible de la Bretagne….
Incendiée et le cercueil de feu et d’eau se retourne sur lui-même… ensevelissant 100 marins qui hurlent et …….
La rumeur inhumaine qui déchire le cœur, de ces milliers de poitrines clamant leur détresse retentit toujours à mes oreilles.
Vision, incendie, fumée…. Rade enflammée, le Mogador !
6 juillet 1940, vide entre temps. Catastrophe, à bord du Champollion - Oran
Je ne sais qu’écrire ni que penser. Après trois jours d’une atmosphère titanesque de combat de géant, de fatigue et de visions d’horreur, après deux exodes, à l’Ecole et à bord du Champollion, nous sommes là, les rescapés, vidés, las, toujours sous le coup du grand assassinat.
Ce matin le Dunkerque bombardé à nouveau et nouvelle tuerie, nouvelle hécatombe. Deux torpilles aériennes, le pont mitraillé, l’Angleterre inique.
Vengeance - Gibraltar cuirassé coulé ?
La France est assassinée de toute côté.
Souvenir accueil de la Directrice, inquiétude angoisse, mes parents, maman, baisers.
9 juillet 1940
L’angoisse intérieure est presque passée car on s’habitue à cette idée qu’un bombardement est possible, qu’une autre boucherie est possible.
On s’habitue à l’idée de la mort, malgré l’Espoir du grand Bonheur de revoir les absents.
Accueil chaleureux de la Directrice Madame Clément et « Lucette » un ange de douceur, projets futurs… devant son adorable simplicité et sa tendresse mâtine.
A bord du Champollion.
11 juillet 1940
« Richelieu » le plus beau du monde attaqué et touché au mouillage à Dakar, Pasteur et Ile de France saisis.
Lettre à Jean Baume
« Je t’envoie mes pensées les plus fraternelles et les plus émues. Je suis sorti indemne de l’Enfer gigantesque…. Mais ma chair, mais mon cœur gardent à jamais l’empreinte angoissée et saignante de ce spectacle titanesque que mes pauvres yeux ont vu se dérouler seconde après seconde. Nous ne savons plus ce que l’Avenir nous réserve et si loin de mes tous chéris, derrière une mer désormais hasardeuse et menaçante, j’attends-je ne sais quoi, la mort ou le Retour ».
17 juillet, Mers-El-Kébir, Sidi Bel Abés, les Baléares.
Parti hier soir 16 juillet.
Pensées tristes au départ, Adieu fraternel et touchant à ceux qui restent, première vraie séparation.
Départ à 5 heures du soir
Emotion mélangée et très forte. Je ne savais plus si c’était un chant d’allégresse qui soulevait mon être ou le Regret prenant qui serrait mon cœur. Après ma dernière visite à Lucette, après les dernières pressions de main à ces femmes exquises et à mes grands amis, j’ai senti que je laissais trop de tendres pensées derrière moi pour pouvoir n’être qu’heureux de repartir vers ma petite patrie.
Les matelots chantaient, criaient leur joie de revoir Marseille et la France mais je ne parvenais pas les suivre sans arrière-pensée, sans cet élan vers la terre désirée. Je me suis laissé jusqu’à une heure avancée, alors que les voix commençaient à se taire, à la vie secrète et lente de la belle nuit, au murmure chuchotement humide et pressé des vagues repoussées…. Et tout ce que mon cœur appelle avec ferveur et tout ce qu’il venait de de perdre un peu se fondait dans le même trouble émouvant dans le même grand amour, rêve aimée…. Je vous souhaite la France et le Bonheur retrouvé avec le retour de Madame Clément et vous, mes sentiments aimants.
Lettre à Madame Clément à bord du Champollion
Je ne sais pas résister à la joie de vous remercier de suite. Vous ne m’en voudrez pas de prendre cette liberté dites.
Je suis si heureux voyez-vous de pouvoir écrire avec plus de sécurité à petite maman et à mes tous chéris que, votre dernière attention à mon égard m’a profondément touché.
La longue lettre que j’envoie à mes parents est presque assurée de les joindre… et pour avoir pensé à eux aussi délicatement vous m’êtes devenu plus qu’une bienfaitrice.
A ma reconnaissance s’ajoute désormais un sentiment profond et très doux qui ressemble à l’émotion chérie qui naît du Souvenir des mamans.
Je ne sais pas dire mieux ce que j’éprouve mais c’est un peu de moi-même que vous avez pris.
Lettre du 27 juillet 1940 à Mesdames Clément de Saint-Astier
« Mes deux amies (me permettez-vous de vous appeler ainsi)
Même au milieu de l’ardent Bonheur que je bois comme un fou depuis quatre jours je n’oublie pas cette autre joie très douce elle aussi que me valut votre chère présence. Je vous avoue que ce n’est pas le soleil d’Oran que je regrette, celui de ma Dordogne retrouvée est plus clément et jamais implacable, mais vos voix et votre accueil m’avaient pris un peu et déjà me retenaient.
Je peux bien vous dire que mon émotion fut très forte et mélangée au moment de quitter l’Algérie. Je ne savais plus si c’était un chant d’allégresse qui soulevait mon (cœur) être ou le Regret prenant qui serrait mon cœur.
Après ma dernière visite, après les regards d’adieu et les dernières pressions de main les vôtres et celles de mes amies, j’ai senti que je laissais trop de tendres pensées derrière moi pour pouvoir n’être qu’heureux.
Les matelots criaient bien leur joie de revoir Marseille et la France mais je ne parvenais pas à les suivre sans arrière-pensée dans cet élan vers la terre désirée…. J’ai souri pourtant de voir un marin retardataire se jeter à l’eau pour nager vers le Sidi-Bel-Abbès et vers la France. Des hymnes d’espoir, l’enthousiasme et le vin aidant ont retenti longtemps sur ce petit paquebot qui s’enfonçait doucement dans la paix de la mer.
Alors que les voix commençaient à se taire, je me suis livré jusqu’à une heure avancée à la vie secrète et lente de la nuit au chuchotement humide et pressé des vagues repoussées et tout ce que mon cœur appelait avec ferveur et tout ce qu’il venait de perdre un peu se fondait sans le même rêve aimé.
Ces mêmes pensées m’ont accompagné durant toute la traversée mais lorsque Marseille est apparue c’est la joie qui a parlé avec le plus de force. J’étais heureux déjà. Que notre pied fût léger sur le sol de France, notre cœur l’était encore davantage. Avec deux amis nous avons terminé la soirée au cinéma et « Cavalcade » avec ses chants de bohême avec ses violons prodiges a fait de mon arrivée à Marseille un rêve musical et séduisant au possible.
Mais jamais le sommeil durant ces sept jours de voyage - sur le paquebot ou dans le train - n’est venu clore, mes paupières énervées. Je n’aurai de cesse qu’à mon arrivée là-bas, je le sentais bien et mes heures d’attente se passèrent à marcher. Je ne pouvais pas lire ni m’asseoir.
Et le dimanche à mon arrivée j’ai connu le plus indicible des Bonheurs, tous en provoquant la plus belle des surprises, la plus émouvante explosion de tendresse.
Petite maman dans mes bras, incapable de proférer la moindre parole et tout son joli visage secoué par une joie douloureuse par une joie trop grande tout à coup et que seules les larmes ont calmé peu à peu.
Et j’ai retrouvé mon beau-frère celui pour qui j’ai eu le plus de pensée fervente durant toute la guerre parce qu’il fut toujours en contact avec les Allemands. Il revient intact et avec la croix de guerre. Mon frère est là aussi échappé aux bombardements aériens et parents et jeunesse retrouvé et famille par les « dieux comblés » vivent à nouveau leur espoir d’autrefois dans la plus charmante des unions.
« Idée que j’ai confiée jusqu’à ce qui rêve de plus cher en moi…. Mais je ne le regrette pas. Vous avez toujours cette même douceur compréhensive de l’accueil passé, cette même Bonté et vous avez ma confiance ».
11 septembre 1940 - Saint-Astier - Dordogne
« Long abandon de mon journal, depuis le retour à Saint-Astier, je me suis livré sans arrière-pensée au Bonheur d’avoir retrouvé ce que j’avais de plus cher : petite patrie et grande famille.
Un lien cependant me ramène souvent vers le Passé tragique et proche où ma vie s’écoulait à Oran et à Mers-El-Kébir.
La petite et discrète idylle qui s’ouvrit aux jours de malheur dans l’accueillante maison de Madame Clément, prend mon cœur parfois et l’éclaire longtemps du plus charmant des souvenirs. Idylle où naissaient toute une floraison d’heureux sentiments, esquisse de la vie familiale retrouvée grâce à la présence de deux femmes délicieuses et toutes de bonté de délicatesse et de fervente douceur…. Naissance d’un sentiment plus nuancé plus tendre entre Lucette si « gentille » et moi-même. »
En ces mêmes moments…… en Périgord
1944 - Juin - Réquisitions du groupe Franc-Roland à Léguillac de l’Auche, auprès de Jean Neycensas, de 110 litres de vin rouge et d’une bêche.
Guerre d’Algérie
Neycenssas Jack né le 26 juillet 1935 décède en Algérie le 16 juillet 1957 à l’âge de 21 ans, 11 mois et 21 jours.
Monument aux morts de
Saint-Laurent des Combes - Gironde




































































































































































































































































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire